JRRVF - Tolkien en Version Française - Forum
Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Annonce
Pages : Précédent 1 2 bas de page
#76 26-04-2020 01:18
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Pour le point de traduction, après un premier essai où j'avais traduit par des « actes de luxure », c'est effectivement la p.228 qui m'avait finalement fait opter pour des « actes de convoitise », en m'appuyant sur la polysémie de lust (que je remettais de toute façon entre parenthèses, comme partout où l'original me paraît essentiel). J'avais aussi à l'esprit la convoitise de Celegorm et Curufin à l'égard de Lúthien, qui devait leur permettre de gagner du pouvoir.
NB : je ne traduis, pas plus que Tolkien ne composait, avec une grille du catéchisme en regard ;). Mais ceci est en lien avec la suite :
Il y aurait quelque-chose de paradoxal, selon moi, à atténuer dans la forme ce qui s'apparente de plus en plus à une mise en relief de fond (sans surprise pour moi, je dois bien l'admettre). Des textes comme « Laws and Customs among the Eldar » dans HoMe X reflète clairement, entre autres, une volonté de plus en plus explicite chez Tolkien, dans les dernières décennies de sa vie, de faire coïncider son œuvre littéraire avec ses préoccupations religieuses : que cela apparaisse plus ou moins clairement dans ses écrits, a fortiori ceux publiés seulement après sa mort, n'a rien d'étonnant, et en ce sens, je crois qu'il ne faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat vis-à-vis des mots employés, même si je regrette, bien sûr, le résultat obtenu, semble-t-il, de toute façon sur le fond, à savoir une sorte de "lewisisation" (ici catholique) du Légendaire a posteriori, via éventuellement le fameux "enrobage de sucre" dont Tolkien lui-même n'avait pas voulu faire consciemment usage (contrairement à Lewis).
Tout cela n'est évidemment pas nouveau... mais tu m'as écrit naguère toi-même qu'il ne fallait pas avoir peur de la vérité, quelle qu'elle soit : en dehors des certitudes religieuses, montrons-la donc sans fard, cette vérité (des faits, et ici de l'emploi des mots), au point où nous en sommes, même si je ne cacherai pas que le tableau, à mes yeux, est (inévitablement ?) de plus en plus gris (sur le fond)... Bref, comme j'ai déjà pu l'écrire précédemment, ne tournons pas (trop) autour du pot. :-)
Je comprends ce que tu veux dire. Toutefois, d'après moi, Tolkien n'a pas, à la force du poignet de la « volonté » si je puis dire, cherché à « faire coïncider son œuvre littéraire avec ses préoccupations religieuses ». Rien, dans son écriture, ses notes ou sa correspondance, ne me paraît aller en ce sens. Il me semble vraiment que l'on a un développement « inhérent » et « naturel » de sa subcréation, qui prend de plus en plus d'épaisseur et de consistance sur le plan spirituel, certes, mais aussi de lien et d'unité. Mais cela n'a pas été le fait d'une volonté calculée. Prenons l'exemple de la modalité de la ré-incarnation des Elfes, que j'ai mentionnée dans ce fuseau. Cette idée a été retravaillée encore et encore jusqu'à coïncider avec la doctrine catholique, c'est vrai. Mais elle n'a pas été retravaillée pour coïncider avec la doctrine catholique (voir entre autres sa réponse à Peter Hastings). C'est de lui-même, à cause de la cohérence de sa subcréation, qu'il l'a remodelée jusqu'à ce qu'elle lui paraisse intrinsèquement congruente.
Ceci étant dit, quand tu écrit qu'il n'y aurait "nul besoin de disserter sur la figure du (saint) roi chez Tolkien" s'agissant d'un personnage comme Tom Bombadil, simplement parce que la correspondance serait "parfaite" avec une vision totalement chrétienne des choses et en particulier de ce personnage, je crains que le tableau devienne, là aussi, de plus en plus gris... mais alors que, pour le coup, ce ne serait nullement justifié ! Tom Bombadil est une "anomalie" qui empêche justement de tout ramener à une grille de lecture univoque (ici chrétienne) : parce que l'on ne sait même pas qui il est ou ce qu'il est, il est selon moi comme une porte de sortie face à l'esprit de système, tout simplement parce qu'il ne rentre pas dans les cases, même si l'on cherchait à tout prix à l'intégrer parfaitement dans une supposée cohérence d'ensemble. Du moins est-ce mon avis. :-)
Pour ma part, Tom serait au contraire le meilleur de tous pour un saint roi. Car la sainteté, justement, n'est pas un esprit de système. Et « l'anomalie » Bombadil a beaucoup à voir avec « l'anomalie chrétienne » (ou ce que celle-ci devrait être). Mais, de ce côté, tout cela a à voir avec ce que chacun de nous mettons derrière ce qui est censé être chrétien.
J'avoue que je ne suis pas sûr, a fortiori avec le recul, que tu ne savais pas où cela conduirait lorsque tu as ouvert le présent fuseau, Jérôme. ;-) Mais que l'on ne se méprenne pas, ceci dit : j'ai conscience de tes efforts pour jouer honnêtement le jeu de la découverte du chercheur et du partage, au prix d'un lourd travail de compilation et d'écriture qu'encore une fois je ne peux que (sincèrement) saluer.
Et je t'en remercie. Ta courtoisie fait plaisir, Benjamin, et je salue sincèrement ton endurance à me suivre sur un chemin que je sais n'être pas le plus agréable pour toi.
Quant à savoir où j'allais en démarrant ce fuseau, je n'en suis pas aussi sûr que vous semblez l'être, chers Hyarion et Sosryko :). Encore qu'il est possible que je me leurre moi-même !! L'essentiel me semble réellement s'être fait au fur et à mesure, même si j'avais quelques points de repère en tête (dont un embryon de qui arrive au prochain post). Pour tout vous dire, ce fuseau est né de la rencontre de deux événements : d'une part, la réflexion que je mène actuellement, en bioéthique, sur la notion d'« autonomie » ; d'autre part, la demande qui m'a été faite de contribuer à un dossier Tolkien. De là, je me suis demandé comment Tolkien voyait le « libre arbitre ».
En revanche, il est vrai que, si je ne savais pas d'avance le chemin, la plupart de ses étapes se sont révélées familières.
@ Elendil : entièrement d'accord.
Jérôme
Hors ligne
#77 26-04-2020 09:27
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Cher Yyr, je n'ai jamais dit que tu connaissais « le chemin », mais tu « savais évidemment plus ou moins où il allait », nuance. Celui qui se qui se met en route avec une boussole ou une carte (ou Gandalf comme guide) découvre certes le chemin avec ses étapes annoncées et ses surprises mais sait où il va...
C'est en ce ses que j'affirmais que tu n'étais pas « égaré dans des chemins qui ne mènent nulle part » : )
S.
Hors ligne
#78 26-04-2020 10:02
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Je m'incline :)
Hors ligne
#79 27-04-2020 02:30
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
NB : je ne traduis, pas plus que Tolkien ne composait, avec une grille du catéchisme en regard ;).
J'entends bien. ;-)
Mais comme je l'ai dit précédemment en ces lieux à propos de la Somme Théologique de Thomas d'Aquin, ce n'est pas parce que la référence n'est pas directement à portée de regard qu'elle ne fait pas partie de l'horizon mental de l'esprit qui crée (ou subcrée, dans le cas de la fantasy). ;-) Parler ici de luxure me parait en tout cas davantage adéquat pour les raisons que j'ai évoqué.
Il ne s'agit pas pour moi de surinterpréter les intentions de Tolkien, même si c'est un risque que nous pouvons tous prendre, toi y compris, en affirmant : « Tolkien a voulu faire ceci ou cela et dans tel ou tel état d'esprit ». ^^'
Cependant, il me semble que nous devons simplement tenir compte du caractère évolutif de la pensée de l'écrivain, et du stade de sa propre vie au moment où il écrit tel ou tel texte (cela vaut pour tout artiste, bien sûr). Quand je parle de volonté de plus en plus explicite chez Tolkien de faire coïncider son œuvre littéraire avec ses préoccupations religieuses, je pense en particulier à l'âge qu'il avait quand il a écrit « Laws and Customs among the Eldar » : la soixantaine bien avancée s'il s'agit de la fin des années 1950, comme l'estimait Christopher T., soit 1958 pour la version A du texte, et 1959 pour la version B de celui-ci. Tolkien n'était pas dans le même état d'esprit à cet âge qu'il l'était trente ans plus tôt, y compris à mon avis sur un plan religieux. Son esprit n'est certes pas sujet à une totale obsession religieuse en matière de création : semble notamment en témoigner le fait qu'il retravaille, durant cette même décennie des années 1950, une histoire comme celle des Enfants de Húrin, dont on n'a rappelé précédemment que c'était peut-être le récit de Tolkien le plus éloigné (toutes proportions gardées) d'un horizon chrétien en matière d'inspiration directe. Cependant, je pense que « Laws and Customs among the Eldar », pour ne citer que lui, est un texte à nette coloration chrétienne, et rien dans ce que Tolkien a pu écrire ou déclarer par ailleurs, ne me parait aller dans le sens d'une minimisation de cette constatation (que je n'aurais d'ailleurs peut-être pas faite moi-même, si tu ne m'avais pas toi-même, Jérôme, mis la puce à l'oreille dans tes écrits ;-)...), constatation qui ne parait pas, en tout cas, relever de la simple coïncidence.
Tout le reste ne me parait être qu'histoire de conscient et d'inconscient... terrain glissant (on le sait) sur lequel je ne m'aventurerai qu'avec beaucoup de prudence. Tolkien a-t-il cherché « à la force du poignet de la « volonté » », pour reprendre ta formule, à truffer son texte de christianisme ? Je ne sais pas au juste, mais a priori j'en doute. Encore une fois, il n'est pas C. S. Lewis. Par volonté de plus en plus explicite, j'entends plutôt une sorte de besoin, pas forcément exprimé consciemment certes. Un esprit religieux n'explicite pas toujours la motivation profonde de ses actes : parfois, il agit, et c'est tout, car les actes parlent pour lui. Si dans le cadre d'une écriture fictionnelle, il imagine quelque-chose que, de toute façon, il n'imagine pas autrement que dans les clous de ce qu'il estime être satisfaisant et « bon », ici chrétiennement parlant, eh bien, l'œuvre produite aura la coloration correspondante, quelle que soit la part de conscient ou d'inconscient en jeu. Les « coïncidences » que tu pourras relever, à cette aune, n'en sont donc peut-être pas vraiment. Tu évoques souvent la cohérence de l'œuvre, volontiers de façon méliorative alors que l'on pourrait pourtant en discuter, mais que devient l'esprit du concepteur dans tout cela ? Fonctionne-t-il de manière automatique, neutre, seulement au nom d'une cohérence supposée « naturelle » ? Prenons précisément le cas de « Laws and Customs among the Eldar », et de la dimension anthropologique, philosophique, voire politique de ce texte : Tolkien est-il capable d'envisager, chez ses Elfes, des cas d'adultères, de divorces, d'avortements, de prostitution, de libertinage, de pornographie, d'homosexualité(s), d'euthanasie, etc., bref, toute situation posant forcément problème au catholique conservateur qu'il fut ? Poser la question, c'est bien sûr y répondre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de volonté forcément calculée, que cette volonté n'est pas « cadrée » d'une manière ou d'une autre. Il peut donc être là moins question de cohérence d'architecture ou de « développement « inhérent » et « naturel » de sa subcréation » que de volonté (consciente, inconsciente, qui sait ?) a minima de ne pas sortir des clous du système de pensée auquel on adhère, et qui compte de plus en plus pour soi au fur et à mesure que l'on avance vers la destination finale (du moins ici-bas)... ce qui peut certes aboutir à une forme de cohérence à l'arrivée, mais qui n'est pas forcément liée à un processus « neutre » en matière de volonté créative, comme tu sembles le suggérer. Du moins est-ce mon point de vue. :-)
Pour ma part, Tom serait au contraire le meilleur de tous pour un saint roi. Car la sainteté, justement, n'est pas un esprit de système. Et « l'anomalie » Bombadil a beaucoup à voir avec « l'anomalie chrétienne » (ou ce que celle-ci devrait être).
Si la sainteté n'est pas un esprit de système, la notion en procède, me semble-t-il, dans le contexte du christianisme catholique, lequel me semble être une manifestation (parmi d'autres) de l'esprit de système, ne serait-ce que par ses dogmes. Or Tom Bombadil me parait simplement se situer au-delà de tout cela. Bien entendu, compte tenu du caractère total du christianisme (dans le sens où l'entendait Albert Camus), on pourra toujours y annexer ce brave Tom, mais je ne pense pas que « l'anomalie » qu'il peut représenter ait tant de choses à voir avec « l'anomalie chrétienne » (vaste sujet, notamment au regard de l'histoire humaine), sauf à vouloir absolument tout ramener au christianisme chez Tolkien, jusqu'à ce personnage dont tout le charme me parait résider dans son identité indéfinie, ce qui fut, pour le coup, une volonté explicite de l'auteur, rappelons-le.
Mais, de ce côté, tout cela a à voir avec ce que chacun de nous mettons derrière ce qui est censé être chrétien.
Oui... Et cela pourrait nous emmener très loin, et même trop loin probablement, mais c'est bien sûr un sujet autour duquel, au-delà même de Tolkien, nous tournons finalement souvent ici.
Après l'avoir un temps oubliée, je me souviens de la conclusion de Jacques Ellul à la fin de son ouvrage Changer de révolution. L'inéluctable prolétariat (1982), une conclusion dans laquelle, avec des accents religieux presque messianiques après s'être pourtant livré dans l'ouvrage à toute une rigoureuse analyse marxisante du monde comme il va (ou du moins comme il allait à l'époque), Ellul énonce comme solution universelle plus ou moins tout ce qui serait selon lui censé être chrétien pour le bien du plus grand nombre : désacralisation de tout ce que l'homme se donne à lui-même comme idoles (la Révélation de Dieu en Jésus-Christ n'est pas concernée), relation humaine totalement désintéressée, esprit total de Non-Puissance, espérance, exigence du changement (avec le Saint-Esprit), liberté, réalisme (en reconnaissant le « péché »), justice (d'exactitude, de paix, soumise à l'amour), vérité (pratiquée dans la transparence des relations et le don de la personne, et elle aussi soumise à l'amour). Ellul, protestant, ayant de lui-même mis de côté l'autorité pontificale et l'Église de Rome, essayons d'aller jusqu'au bout de la logique, et mettons donc également de côté la coloration religieuse que l'on donne à des notions suffisamment universelles pour ne pas dépendre de certitudes religieuses (y compris l'amour), mettons aussi de côté la Révélation, Jésus-Christ conçu comme Fils de Dieu, le Saint-Esprit, le « péché », le Dieu personnel de la Bible même : ceci fait, on pourra constater que rien dans ce que Ellul propose là comme essentiel n'a vocation, en soi, à spécifiquement être chrétien. C'est toute une appréhension du réel qui est donc en question ici.
Qu'est-ce qui est donc censé être chrétien ? C'est une question me parait plus difficile qu'on pourrait le croire, en tout cas...
J'ai déjà parlé ailleurs, en ces lieux, de mon rapport personnel à la religion chrétienne catholique, rapport ni totalement intérieur, ni totalement extérieur. Je me souviens de cet échange houleux dans un autre fuseau, l'année dernière, avec Elendil, au cours duquel j'avais évoqué, avec écœurement, les abus sexuels dans l'Église envers les femmes religieuses. Elendil avait réagi, dans le feu de la confrontation, en me disant que j'avais un train de retard en évoquant ce sujet, pensant probablement que je ne faisais qu'attaquer le Vatican en parlant d'un phénomène connu publiquement depuis longtemps, mais il se trompait : je ne parlais pas des abus sexuels de prêtres sur mineurs, effectivement connus depuis maintenant très longtemps, et pour lesquels l'Église catholique est justement appelée régulièrement à rendre publiquement des comptes ; je parlais de « l'autre scandale » de l'Église, celui des abus sexuels de prêtres sur majeurs et notamment envers des religieuses, un scandale dont la révélation publique, à l'époque où j'en avais parlé dans notre discussion, était alors toute récente. Je n'avais donc pas un train de retard, mais pour autant, moi qui d'ordinaire suis loin de pratiquer l'indignation permanente comme certains, pourquoi ai-je été si écœuré dans ce cas ? Probablement parce que je pensais, sans doute encore naïvement (malgré les années qui passent et tout mon esprit critique pourtant largement développé par ailleurs à l'égard du Vatican et des certitudes religieuses en général), qu'il y avait quelque-chose d'encore un peu « sacré » dans l'engagement religieux chrétien, a fortiori dans « les ordres » et le sacerdoce. Je me disais que depuis, disons, une bonne cinquantaine d'années, après déjà des siècles de sécularisation des sociétés, ce type d'engagement religieux était devenu un choix vraiment libre, c'est-à-dire non dicté par les conventions sociales et culturelles du passé à l'aune desquelles nous pouvons juger, par exemple, des représentations sexuées et sexuelles des prêtres, religieux et religieuses tels que pouvaient les représenter, par exemple, les enlumineurs au Moyen Âge ou un artiste comme Jean-Jacques Lequeu pendant la Révolution française. Je me disais qu'il n'y avait plus de contraintes extérieures matérielles à choisir d'intégrer le clergé et « les ordres », et que par conséquent, toutes ces histoires de vœux de chasteté, de vie consacrée à Dieu, etc., tout cela ne pouvait plus (ou alors seulement exceptionnellement) n'être que de vains mots, et que ces engagements n'avaient plus le caractère potentiellement subi ou hypocrite (et de fait critiquable) du passé, et qu'ils représentaient des options de vie a priori sûres quant au respect élémentaire de la dignité de la personne humaine. Et voila que, comme si nous n'en avions pas déjà assez avec les abus sur mineurs, voila qu'à travers ce film documentaire (« Religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église » de Marie-Pierre Raimbault et Éric Quintin) diffusé sur la chaîne Arte en mars de l'année dernière (et que Sorj Chalandon avait dignement évoqué à l'époque dans Le Canard enchaîné), je découvre ces histoires dramatiques, horribles, de religieuses violées par des prêtres, trahies par leur Église, détruites jusque dans leurs âmes (que l'on accorde ou non un sens religieux au terme)... Et là, soudainement, les mots manquent, quand bien même je n'ai jamais idéalisé la figure de la religieuse (laquelle, précisément, reste une femme, un être humain, à considérer et respecter comme tel)... C'est dans ces moments-là que l'on se dit que, décidément, l'humanité aura toujours des raisons de décevoir, et que les idéaux... restent des idéaux. Mais ce que je peux au moins dire, cher Jérôme, c'est que, selon moi, du modeste point de vue critique qui est le mien, ce qu'il y a derrière ce qui est censé être chrétien, a minima, ça ne devrait pas être « ça ». Et je sais bien que tu en conviendras avec moi, comme Sosryko ou Elendil du reste. Mais si je prends la peine d'écrire tout cela, c'est pour donner une idée de toutes les considérations qu'il peut y avoir derrière nos échanges et nos confrontations de points de vue, même seulement autour d'une œuvre littéraire, ce qui vaut pour moi valant évidemment pour les autres.
Alors oui, c'est vrai, Jérôme, le chemin que tu proposes n'est pas des plus agréables à suivre pour moi, mais saches simplement que je mesure la dimension « partie émergée de l'iceberg » qu'il y a dans chacune de nos participations respectives, et que même si je ne comprends pas toujours le ton ou l'intention de certains messages, je n'oublie pas qu'aucun d'entre-nous, individus, n'est en soi le représentant d'une Idée avec un grand « I » ou d'un système de pensée. « Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux » reste ma devise, et cela vaut donc aussi pour ce qui est d'appréhender le travail d'autrui. :-)
Je me permets de terminer cette réponse par une question ouverte qui me parait être au cœur du sujet de ce fuseau, et qu'il serait peut-être possible (utile ?) d'intégrer à la réflexion générale : quelle place accorde l'auteur au libre-arbitre du lecteur quant à l'appréhension de son univers de fiction ? Dans quelle mesure et jusqu'où le lecteur doit faire « comme si », a fortiori dans le cadre d'une subcréation ? (N.B.: se contenter de me renvoyer à l'essai Du conte de fées serait une solution de facilité... ;-)... car il me semble qu'il serait intéressant aussi de réfléchir au-delà de ce texte)
B.
EDIT: correction suite à une remarque de Sosryko à propos d'Ellul (voir plus bas).
Hors ligne
#80 27-04-2020 11:11
- Elendil
- Lieu : Velaux
- Inscription : 2008
- Messages : 1 200
Re : La question du Libre Arbitre
Cependant, il me semble que nous devons simplement tenir compte du caractère évolutif de la pensée de l'écrivain, et du stade de sa propre vie au moment où il écrit tel ou tel texte (cela vaut pour tout artiste, bien sûr). Quand je parle de volonté de plus en plus explicite chez Tolkien de faire coïncider son œuvre littéraire avec ses préoccupations religieuses, je pense en particulier à l'âge qu'il avait quand il a écrit « Laws and Customs among the Eldar » : la soixantaine bien avancée s'il s'agit de la fin des années 1950, comme l'estimait Christopher T., soit 1958 pour la version A du texte, et 1959 pour la version B de celui-ci. Tolkien n'était pas dans le même état d'esprit à cet âge qu'il l'était trente ans plus tôt, y compris à mon avis sur un plan religieux. Son esprit n'est certes pas sujet à une totale obsession religieuse en matière de création : semble notamment en témoigner le fait qu'il retravaille, durant cette même décennie des années 1950, une histoire comme celle des Enfants de Húrin, dont on n'a rappelé précédemment que c'était peut-être le récit de Tolkien le plus éloigné (toutes proportions gardées) d'un horizon chrétien en matière d'inspiration directe.
Je profite de cette digression pour signaler mon accord avec ton point de vue, Hyarion. Il est manifeste qu'à cet âge Tolkien voit la religion bien différemment de la façon dont il la considérait dans sa jeunesse. Il n'est besoin que de comparer les récits ou, mieux, les listes de vocabulaire et les discussions linguistiques, pour se rendre compte du changement de perspective. C'est assez naturel et c'est aussi valable dans d'autres domaines bien éloignés du religieux. Tolkien aborde notamment l'histoire de Túrin d'une manière bien différente de celle des Contes perdus : la psychologie des personnages y est non seulement bien plus fouillée, mais aussi profondément modifiée.
Elendil avait réagi, dans le feu de la confrontation, en me disant que j'avais un train de retard en évoquant ce sujet, pensant probablement que je ne faisais qu'attaquer le Vatican en parlant d'un phénomène connu publiquement depuis longtemps, mais il se trompait : je ne parlais pas des abus sexuels de prêtres sur mineurs, effectivement connus depuis maintenant très longtemps, et pour lesquels l'Église catholique est justement appelée régulièrement à rendre publiquement des comptes ; je parlais de « l'autre scandale » de l'Église, celui des abus sexuels de prêtres sur majeurs et notamment envers des religieuses, un scandale dont la révélation publique, à l'époque où j'en avais parlé dans notre discussion, était alors toute récente.
Je l'avais bien compris, mais c'est un scandale — tout aussi répugnant que l'autre — dont il était question depuis pas mal de temps aussi, même si cela a commencé à se savoir vingt ou trente ans après les premiers cas de pédophilie, qui sont sortis dans les années 1970. Il est fort possible néanmoins que la presse grand public s'en soit moins fait l'écho et que cela explique que tu n'en aies entendu parler que récemment.
Probablement parce que je pensais, sans doute encore naïvement (malgré les années qui passent et tout mon esprit critique pourtant largement développé par ailleurs à l'égard du Vatican et des certitudes religieuses en général), qu'il y avait quelque-chose d'encore un peu « sacré » dans l'engagement religieux chrétien, a fortiori dans « les ordres » et le sacerdoce. Je me disais que depuis, disons, une bonne cinquantaine d'années, après déjà des siècles de sécularisation des sociétés, ce type d'engagement religieux était devenu un choix vraiment libre, c'est-à-dire non dicté par les conventions sociales et culturelles du passé à l'aune desquelles nous pouvons juger, par exemple, des représentations sexuées et sexuelles des prêtres, religieux et religieuses tels que pouvaient les représenter, par exemple, les enlumineurs au Moyen Âge ou un artiste comme Jean-Jacques Lequeu pendant la Révolution française. Je me disais qu'il n'y avait plus de contraintes extérieures matérielles à choisir d'intégrer le clergé et « les ordres », et que par conséquent, toutes ces histoires de vœux de chasteté, de vie consacrée à Dieu, etc., tout cela ne pouvait plus (ou alors seulement exceptionnellement) n'être que de vains mots, et que ces engagements n'avaient plus le caractère potentiellement subi ou hypocrite (et de fait critiquable) du passé, et qu'ils représentaient des options de vie a priori sûres quant au respect élémentaire de la dignité de la personne humaine.
C'est ce qui devrait être le cas, en effet. Malheureusement, même dans les engagements logiquement les plus altruistes renaît inlassablement la passion pour le pouvoir et l'abus de celui-ci, y compris pour satisfaire les appétits les plus égoïstes, au détriment d'autrui. Outre l'Église et les hiérarchies religieuses en général, on pourrait citer les engagements associatifs et humanitaires, la presse, le syndicalisme, la médecine, sans parler bien sûr de la politique démocratique (en partant du principe que la politique non démocratique est rarement d'essence altruiste)... Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour convenir que plus la cause défendue est noble, plus les écarts avec les objectifs poursuivis sont condamnables, quelles que soient les circonstances atténuantes qu'on puisse invoquer pour leurs auteurs.
Dans quelle mesure et jusqu'où le lecteur doit faire « comme si », a fortiori dans le cadre d'une subcréation ? (N.B.: se contenter de me renvoyer à l'essai Du conte de fées serait une solution de facilité... ;-)... car il me semble qu'il serait intéressant aussi de réfléchir au-delà de ce texte)
Tolkien en parle aussi dans les Lettres. 
E.
Hors ligne
#81 27-04-2020 12:53
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Ellul énonce : [...] justice (de rétribution, de paix, soumise à l'amour),
Il y aurait trop à dire, ce n'est pas le lieu & le temps manque, mais à propos de la justice selon Ellul, un contresens à éviter :
La justice : non pas juridique ou de rétribution, mais d'exactitude et de paix.
J. Ellul, Changer de révolution, Seuil, 1982, p. 290.
S.
Hors ligne
#82 27-04-2020 17:44
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
À nouveau je te rejoins en bien des points, Benjamin. Et c'est un grand plaisir d'avoir cet échange de façon beaucoup plus apaisé qu'autrefois.
Je ne répondrai pas ici et maintenant à tout, entre autres parce que cela impliquerait de te contredire et de débattre en plusieurs points de ce qu'est et ce que comprend le christianisme ; nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement et ailleurs pour notre intérêt commun.
Quant à la question de l'évolution chrétienne du Légendaire, pour résumer pour l'instant l'une de nos divergences, et en forçant le trait à dessein, quitte à être provocateur, je dirais que les réflexions de Tolkien sont devenues plus densément chrétiennes à cause de sa mythopoésie et non l'inverse. Son exploration de Faërie était en même temps une exploration du réel, et ce qu'il y a découvert a résonné dans son cœur. Si ce qu'il avait découvert n'avait pas été chrétien, il aurait plutôt rejeté la foi que ce que sa raison, son cœur et sa nature lui montraient. Aussi d'après moi n'y-a-t-il jamais eu « lewisisation » de Tolkien (ce qui ne serait pas péjoratif pour autant en ce qui me concerne).
Enfin, ta « question ouverte » est parfaitement dans le sujet, que je ne prétendais pas épuiser. Je la note ! :)
Hors ligne
#83 27-04-2020 18:15
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Excursus : la loi naturelle
Comme le précédent excursus reliait la liberté du Créateur à toute puissance divine (à communiquer pleinement le bien), ce nouvel excursus (à peine plus grand :)) se propose de relier la liberté du subcréateur à sa nature.
Nous avons vu de la liberté du subcréateur que celle-ci a comme origine et comme fondement l'inclination de la nature humaine au bien et à la vérité, c’est-à-dire à Dieu. Cette disposition à la « concréation » pour saint Thomas, à la « subcréation » pour Tolkien, est inscrite dans la nature même de nos facultés spirituelles, intelligence et volonté, qui sont à la racine de l’agir libre. Elle est l’œuvre la plus précieuse de Dieu dans l’homme, l’émanation de la loi éternelle, c'est-à-dire une participation directe et unique à sa sagesse, à sa bonté et à sa liberté.
Cette émanation de la loi éternelle, c'est ce que saint Thomas appelle « la loi naturelle ». L'idée de loi naturelle ne date pas de saint Thomas. Elle est un héritage de la pensée grecque et chrétienne. Il faut remonter, pour les premiers, à Cicéron, aux stoïciens, aux grands moralistes de l'antiquité, et à ses grands poètes, Sophocle en particulier : « Antigone peut être considérée comme l'héroïne de la loi naturelle, elle qui était consciente du fait qu'en transgressant la loi humaine et en se faisant écraser par elle, elle obéissait à un commandement meilleur, à ces lois — comme elle disait — qui sont non écrites et ne sont pas nées d'aujourd'hui ni d'hier, mais qui vivent pour toujours et dont aucun homme ne sait d'où elles tiennent leur origine » (Maritain). Et, pour les seconds, à saint Paul, puis aux Pères de l'Église, à saint Augustin en particulier. Mais c'est bien saint Thomas qui donnera toute sa cohérence à la doctrine :
Or, parmi tous les êtres, la créature raisonnable est soumise à la providence divine d'une manière plus excellente par le fait qu'elle participe elle-même de cette providence en pourvoyant à soi-même et aux autres. En cette créature, il y a donc une participation de la raison éternelle selon laquelle elle possède une inclination naturelle au mode d'agir et à la fin qui sont requis. C'est une telle participation de la loi éternelle qui, dans la créature raisonnable, est appelée loi naturelle [...] [:] c'est-à-dire que la lumière de notre raison naturelle, nous faisant discerner ce qui est bien et ce qui est mal, n'est rien d'autre qu'une impression en nous de la lumière divine. Il est donc évident que la loi naturelle n'est pas autre chose qu'une participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable.
Somme théologique, Ia-IIæ.91.2
C. S. Lewis pouvait la résumer ainsi :
L’idée était la suivante : de même que tous les corps sont gouvernés par la loi de la gravitation et les organismes par les lois biologiques, la créature appelée homme a aussi sa loi. Cette dernière est pourtant très différente : alors qu’un corps ne peut choisir d’obéir ou non à la loi de la gravitation, un homme peut choisir d’obéir ou non à la Loi de la Nature Humaine.
Les fondements du christianisme, LLB, 2013 (1952), p.20
L'idée signifie que toute chose existant dans la nature a sa « loi naturelle », c'est-à-dire sa « normalité de fonctionnement », d'après laquelle elle peut atteindre sa « plénitude d'être ». C'est, dans la perspective thomiste, l'inclination naturelle de la Création au Bien. En ce qui concerne la créature rationnelle qu'est l'homme, sa mise en œuvre est laissée à son conseil, à son libre arbitre ; et c'est pourquoi, chez l'homme, la loi naturelle est une loi morale. Elle est le don d'une participation de la Raison éternelle : « la loi naturelle n'est pas autre chose qu'une participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable ». Or, la loi est universelle et immuable, tandis que l'événement concret est toujours singulier et soumis aux changements. Le libre arbitre est très exactement cette responsabilité confiée à chacun d'individualiser la loi dans une histoire et des circonstances toujours singulières (*).
L'échange entre Aragorn et Éomer fournit une brillante illustration :
« J'avais oublié cela, dit Éomer. Il est difficile d'être sûr de quoi que ce soit au milieu de tant de choses étonnantes. Tout dans le monde est devenu étrange. [...] Comment jugerait-on de ce qu'il faut faire en une telle époque ? »
« Comme on a toujours jugé, dit Aragorn. Le bien et le mal n'ont pas changé depuis l'année dernière ; et ils ne sont pas non plus une chose chez Elfes et les Nains et une autre chez les Hommes. Il appartient à chacun de les discerner aussi bien dans la Forêt d'Or que dans sa propre maison. »
« Assurément, dit Éomer. Mais je ne doute pas de vous, ni de l'action que mon propre cœur voudrait accomplir. Je ne suis pourtant pas libre de faire tout ce que je veux. Il est contre notre loi de laisser des étrangers vagabonder à leur gré dans notre pays, jusqu'à ce que le roi lui-même en donne l'autorisation [...]. »
SdA, III.2
Éomer connaît déjà la réponse à sa question, puisqu'elle est inscrite dans son propre cœur. Aragorn l'exprime clairement : la loi éternelle / naturelle ne change pas, mais il nous appartient de la discerner là où nous sommes. C'est à elle que le cœur d'Éomer voudrait obéir, car elle est supérieure à la loi de Théoden. Ou, plus exactement, la loi de Théoden, si elle est juste, doit s'accorder à ce qui participe de la loi éternelle en elle, à savoir : la loi naturelle. La délibération d'Éomer sera particulièrement sage, puisqu'il obéira à sa raison sans pour autant tenir pour nulle la loi du Rohan (il aide Aragorn en lui demandant d'aller ensuite se présenter à Meduseld) qui s'en trouvera préservée, ce qui est important. À partir de ce moment, n'en doutons pas, l'amitié entre les deux futurs rois est scellée, et tous deux seront de vrais rois, qui font le choix d'Antigone contre celui de Créon : est juste est ce qui est conforme à la loi éternelle et donc à la loi naturelle, et non ce qui est conforme à la volonté du prince.
Si l'on creuse, l'accord avec la doctrine thomiste est manifeste :
Pour commencer, le Conte d'Arda conçoit la nature au sens métaphysique. À l'instar de la Tradition et à l'inverse de la Modernité, la nature y désigne ce qui cause chaque être à surgir et à se développer de telle façon et non de telle autre. Ainsi, lorsque les Valar ou les Sages des Eldar et des Edain essaient de comprendre le monde et ses habitants, ils étudient leur nature. L'amour des Eldar pour « les bêtes et les oiseaux qui sont [leurs] amis, les arbres, et même les belles fleurs qui passent encore plus rapidement que les Hommes », s'accompagne du regret de les voir partir ; « cela fait toutefois partie de leur nature » (HoMe X, p.308). Chez les Incarnés, l'union du fëa et du hröa « était par nature et cause (by nature and purpose) permanente » (p.218). Et la différence entre les Incarnés s'énonce en terme de nature : « depuis leurs commencements, la principale différence entre les Elfes et les Hommes résidait dans le destin et la nature (the fate and nature) de leurs esprits. Les fëar des Elfes étaient destinés à demeurer en Arda pour toute la vie d'Arda, et la mort de la chair n'abrogeait pas cette destinée. Leurs fëar étaient ainsi fermement ancrés (tenacious) à la vie “dans l'enveloppe d'Arda” (the raiment of Arda), et surpassaient de loin les esprits des Hommes quant au pouvoir sur cette “enveloppe”, [...] protégeant leurs corps de bien des maux et agressions (comme la maladie), et guérissant rapidement leurs dommages, de telle sorte qu'ils recouvraient de blessures qui se seraient révélées fatales aux Hommes » (p.218). Où l'on retrouve notre « destin » au sens de condition ... c'est-à-dire de nature ! Quant aux Hommes, dont le destin et donc la nature de leurs fëar est de quitter les Cercles du Monde, Andreth et Finrod s'accordent pour constater que, pour les Hommes, « rien en Arda ne garde longtemps sa saveur, et la beauté de toutes les belles choses s'affaiblit » ; d'après Finrod, « cela fut toujours [leur] nature » (p.316).
Ensuite, la nature des Incarnés est aussi un moyen de connaissance : « en ce qui concerne le roi Finrod, on doit comprendre qu'il part de certaines croyances de base qui, ainsi qu'il pourrait l'exprimer, provenaient de l'une ou de plusieurs de ces sources : sa nature créée ; l'instruction angélique ; la réflexion ; et l'expérience » (HoMe X, p.330).
Troisièmement, la nature dans le Conte d'Arda est présentée comme un cours ou un chemin. Les « lois & coutumes parmi les Eldar » se réfèrent « aux véritables voie et nature (right course and nature) dans un monde immarri, ou aux us de ceux qui n’ont pas été corrompus par l’Ombre et aux temps de paix et d’ordre » (HoMe X, p.217, cf. pp.232,255,334). Référence faite ici au Marrissement d'Arda, à cause duquel « rien [...] ne peut éviter complètement l’Ombre [...] ou n’est entièrement immarri, de sorte à suivre sans entrave son cours naturel (its natural course) » (p.217cf. pp.258-259). Je rappelle que le Marrissement signifie et désigne avant tout le dévoiement ou la rupture du cours naturel des choses (cf. « le Marrissement d'Arda » dans la Feuille de la Compagnie n°3 ; « Estel Eruhínion » dans Pour la gloire de ce monde). On lit ainsi que « le mariage [...] était le cours naturel (natural course) de la vie pour tous les Eldar » (p.210), et que le dénouement le plus heureux pour les Eldar morts « était après l'Attente de pouvoir re-naître, car ainsi le mal et la peine qu'ils avaient endurés avec l'interruption de leur cours naturel (in the curtailment of their natural course) pouvait être redressé » (p.219), ou encore que ceux qui avaient causé du mal et « qui avaient été sous la correction de Mandos [...] étaient revenus à leurs cours naturels (have returned to their natural courses), et ce qui avait été anormal et perverti (the unnatural and the perverted) ne faisait plus partie de la continuité de leurs vies » (p.235).
Quatrièmement, la nature aussi bien que le cours de la nature renvoient à un ordre idéal et à ce qui est conforme à cet ordre, c'est-à-dire à Arda Immarrie : « la source dont procèdent toutes les idées d’ordre et de perfection » (HoMe X, p.405, cf. VT n°39 p.23, PE n°17 p.178). Les Eldar estiment que « l'harmonie entre le hröa et le fëa [...] est essentielle à la vraie nature immarrie (the true nature unmarred) de tous les Incarnés » (p.315), si bien que « nous ne vivons pas dans notre être véritable (our right being) et son entièreté (its fullness) en dehors d'une union intime et paisible entre la Demeure et l'Hôte (the House and the Dweller) » (p.317), chacun devant « réaliser sa véritable nature (fulfill its right nature) » p.318, cf. encore : « conformément à une nature immarrie (according to unmarred nature) » p.218 ; « conformément à leur véritable nature (according to their right nature) » ibid. + idem p.363 ; « conforme à la vraie nature des hommes (according to the true nature of Men) » p.317 ; « de par nature (by right nature) » p.304 ; « la nature originelle des Hommes » p.304 ; « dans leur vraie nature (in their true nature) » p.314 x 2). De même, « le mariage était permanent conformément à la nature elfique (in accordance with elvish nature) » (p.225, un plus loin : la permanence du « mariage immarri » des Elfes découle de la permanence des Elfes eux-même au sein d'Arda). Vice versa, est contre-nature ce qui ne respecte pas cet ordre idéal. Cela renvoie à ce qui est injuste : « [une telle] re-naissance [par réincarnation] serait contre-nature et injuste (unnatural and unjust) » (HoMe X, p.220) ; « rendre anormalement (unnaturally) une justice illicite » (p.246). Cela renvoie à ce qui est mauvais : « la mort est pour les Eldar un mal, c'est-à-dire une chose contre-nature en Arda Immarrrie » (p.240, idem p.225) ; « le mal et la peine résident dans la séparation et la rupture même de la nature (the mere severance and breach of nature) » (p.245) ; « la défaillance des forces du corps de Míriel pouvait être attribuée, avec quelque raison, au mal d'Arda Marrie, et sa mort à une chose contre-nature » (p.241). Cela renvoie à ce qui est immoral : « ceux parmi les Eldar dont l’esprit s’assombrissait posaient des actes contre-nature (did unnatural deeds), et étaient doués de haine et de malveillance » (p.222). Et cela renvoie à ce qui devrait, autant que faire se peut, être « redressé » c'est-à-dire « guéri » : « Tel est le but de la grâce de la re-naissance que la rupture anormale (unnatural breach) de la continuité de la vie soit redressée (should be redressed) » (p.227) ; « Car c'est la raison du temps de l'Attente en Mandos que la rupture anormale (unnatural breach) de la continuité de la vie des Eldar soit guérie (should be healed) » (p.233).
Cinquièmement, le libre arbitre est d'autant plus convoqué là où la nature est déterminante. Nous avons vu l'insistance du Conte d'Arda sur le libre arbitre en ce qui concernait le mariage et la mort. Il s'agit précisément de deux chapitres qui insistent tout autant sur la nature. Ainsi, dans « les lois & coutumes parmi les Eldar », il est autant question de nature que de lois et coutumes : il existe « des différences entre les inclinations naturelles des neri et nissi, et d'autres différences qui ont été établies par la coutume (variant dans le lieu et le temps, et entre les peuples des Eldar) » (HoMe X, p.213). Le mariage chez les Eldar se rapporte aux faits que : non seulement les hröar mais aussi « les fëar des Elfes sont par nature mâle et femelle » (p.227) ; les Eldar « sont par nature continents et constants (steadfast) » (p.211) ; le mariage est « le cours naturel (natural course) de la vie » (p.210). Et si « l'union conjugale leur procure grandes félicité et joie, et les “jours des enfants”, comme ils les appellent, demeurent parmi les souvenirs les plus joyeux de la vie ; ils ont pourtant de nombreuses autres facultés du corps et de l'esprit que leur nature les pousse à accomplir » (p.213) (notons encore au passage les « noms de clairvoyance » (names of insight) que « la mère pouvait donner à son enfant [et qui] indiquaient quelque trait dominant qu'elle pouvait percevoir de sa nature » (p.216)). Quant à la mort, sa nature ne cesse d'être interrogée : la « déchirure entre le corps et l'esprit (sundering of spirit and body) » (p.225) constitue « un désastre » (p.317), car elle opère « une rupture contre-nature » (p.227, cf. pp.219,233,239,240,241,245) ; Andreth rapporte que « nombreux sont ceux parmi les Sages qui soutiennent qu’aucune chose vivante, dans sa vraie nature, ne devrait mourir » (p.314) ; et tout l'Athrabeth tournera autour de la nature de la mort : « les Hommes croyaient que leur hröar n'étaient pas éphémères de par nature (by right nature) » (p.304, cf. p.309) ; auquel cas, d'après les Eldar, « la nature des Hommes avait été grièvement altérée en regard du premier dessin d'Eru » (p.304) ; et Finrod de s'interroger sur l'étrangeté de « la nature originelle des Hommes » (p.304). Ainsi, là où nous avions vu précédemment que s'exprime le mieux le libre arbitre, la nature s'avère déterminante. Cela parce que (le contexte concerne le mariage mais il peut être aisément étendu) « bien que réalisé par et dans le corps, le mariage [comme tout acte] procède du fëa et réside ultimement dans sa volonté (in its will) » (p.227). Le libre arbitre, alors, est ce qui permet, non pas de s'émanciper de la nature comme dans la Modernité, mais au contraire de l'accomplir soi-même, personnellement, individuellement.
Le Namna offre à cet égard une synthèse pratique complète. Partis d'une question de libre arbitre face à la survenue de la Mort et de la séparation de Finwë et Míriel, qui se manifestent toutes deux comme « chose contre-nature (thing unnatural) » (HoMe X, p.227, idem p.239 qui précise « en Arda Immarrie »), les Valar, pour poser librement leur délibération et leur jugement, s'efforceront de discerner précisément ce qui relève ou non de l'ordre idéal de la nature des Enfants d'Eru : qu'il s'agisse des désirs de ces derniers « qui surgissent de leur nature même (from their very nature), à savoir l'habitation de l'esprit dans le corps, leur véritable condition (their right condition) » (p.242) ; du préjudice de « la vie et de l'espoir naturels » de Finwë (p.242) ; de l'espoir qui demeurait néanmoins qu'« après un repos en Mandos le fëa de Míriel eût pu de lui-même revenir à sa nature, à savoir désirer habiter son corps », car « il était plus anormal (more unnatural) pour l'un des Eldar de rester fëa désincarné à jamais que pour un autre de rester vivant et marié mais endeuillé » (p.243) ; et, surtout, du jugement qui sera finalement prononcé par Mandos, rendu « parce qu'il est contraire à la nature des Eldar de vivre seul (unwedded) » (p.255).
Enfin et dernièrement, on peut présenter une synthèse théorique et résumer les choses en disant que dans le Conte d'Arda la nature est finalisée par le Bien : celui-ci est la « cause finale » de la nature (pour prendre une terminologie aristotélicienne) : son but, sa raison d'être. Le monde créé, en effet, « a des fondations qui sont bonnes, et il tend par nature au bien (it turns by nature to good) [;] le mal en Arda [...] provient des volontés et des êtres (wills and beings) qui sont autres qu'Arda elle-même » (p.379) ; « Arda (sans la malice du Marrisseur) serait requise pour la pleine satisfaction de [la] nature [des Enfants] » (p.251) ; elle « impliquerait une continuité, par-delà la Fin (ou Achèvement (Completion)) » (ibid.).
Vice versa, le bien est défini par rapport à la nature (immarrie) :
√MAN « bien, bon » (good). Implique qu'une personne / chose est (relativement ou absolument) « immarrie » ; c'est-à-dire, dans la réflexion elfique, non affectée par les désordres introduits en Arda par Morgoth : et donc ce qui est fidèle à sa nature et à sa fonction (is true to its nature & function). Appliqué à l'esprit (mind/spirit), c'est à peu près l'équivalent de moralement bon (morally good) ; appliqué aux corps (bodies) cela faisait naturellement référence à la santé et à l'absence de déformations, dommages, défauts, &c.
PE n°17 p.162
Aman « béni, libre du mal (blessed, free from evil) » [...]. Forme valarine non donnée ; censée signifier « en paix, en accord (avec Eru) (in accord (with Eru)) ».
HoMe XI, p.399
L'équivocité de ces deux définitions du bien (ici le langage des Valar se situe du côté de la surnature, celui des Eldar du côté de la nature) identifie le Bien de la nature à l'accord avec Eru. Plus exactement, nous pourrions dire : le Bien de la nature, c'est être accordé (au sens d'un instrument) à Eru, ainsi que l'analyse minutieuse de Didier l'avait établi pour une discussion reliée (et dont les bases avaient été jetées ici ;)). Tout le débat du Namna se structure en fonction de cette double définition. La référence de tous les Valar pour discerner ce qui est juste, c'est la (véritable) nature des Incarnés, et donc les « ultimes desseins [et la] volonté d'Eru » (pp.241,242,245,246), « Seigneur de Tout » (pp.241,245), « Seigneur Éternel » (p.245), ou encore (synthèse des deux points de vue) « Arda Immarrie ». Il en va de même pour le débat de l'Athrabeth qui, du début à la fin, scrute la nature des Enfants d'Eru, laquelle est finalisée par « la volonté et les desseins d'Eru » (pp.304,326,330,331,334,338,342), « l'esprit d'Eru (the mind of Eru) » (p.318), « la magnificence d'Eru » (p.318). À son amie qui ne parvenait plus à le percevoir, ou qui n'avait plus l'espoir de le percevoir, Finrod partageait l'espérance des Eldar :
Vous aussi [...] êtes les Enfants d'Eru, et votre destin, votre nature, provient de Lui (your fate and nature is from Him).
[Aussi notre espérance] ne vient[-t-elle] point de l’expérience, mais de notre nature et de notre état primordial. Si nous sommes effectivement les Eruhin, les Enfants de l’Unique, alors Il ne permettra point d’être Lui-même dépossédé des Siens, ni par aucun Ennemi, ni même par nous-mêmes. C’est le dernier fondement de l’Estel, que nous gardons même lorsque nous contemplons la Fin : de l’ensemble de Ses desseins l’aboutissement doit être pour la joie de Ses Enfants. »
HoMe X, p.320 (cf. aussi p.239 dans le Namna les paroles de Manwë relatives à l'Espérance qui conserve la pensée d'Arda Immarrie)
Au final :
La nature dans le Conte d'Arda existe réellement. Elle existe au sens métaphysique (ni empiriste ni rationaliste). Elle est ce qui rend compte des particularités de l'être et du devenir des différentes créatures, aussi bien dans ce qu'elles ont en commun que dans ce qui les spécifie. Elle est une autre façon pour les Eldar de se référer au « Destin », Umbar, c'est-à-dire à la constitution et à l'ordre du monde, Ambar, et de ses habitants.
La nature des Incarnés est aussi une source de connaissance, aux côtés de la foi, de la raison, et de l'expérience.
La nature est volontiers décrite comme un cours ou un chemin. C'est très précisément ce « cours naturel » qui se trouve dévoyé par les dissonances introduites par le Marrisseur dans la structure d'Arda.
La nature renvoie ainsi à cet ordre ou cette référence idéale que constitue Arda Immarrie : la source de tout ce qui est essentiel, véritable, ordonné, parfait ; ce qui permet de réaliser son « être véritable ». Est contre-nature ou anormal ce qui ne respecte pas cet ordre idéal : tout ce qui est déformé, mauvais, injuste, immoral.
La nature est particulièrement convoquée aux lieux mêmes où le libre arbitre est appelé à se déployer. C'est qu'à cet ordre idéal, les créatures rationnelles sont appelées à participer par le moyen de leur libre arbitre. Cela ressort particulièrement des très nombreuses réflexions portant sur la mort, et aussi de celles qui portent sur des éléments importants de la vie, comme le mariage et la génération.
La nature est finalisée par le bien ; vice versa, le bien renvoie à ce qui est fidèle à sa nature et à sa fonction : la santé physique du corps, la santé morale et spirituelle de l'esprit. À cette perspective située naturellement correspond celle située surnaturellement : le bien de la nature est encore d'être accordé (au sens d'un instrument) à Eru. Autrement dit : « la nature et le destin » des Enfants d'Eru aboutit dans « l'ensemble de Ses Desseins ».
Évidemment (d'après moi), Tolkien ne s'est pas dit un jour d'illustrer la doctrine de saint Thomas. Je suis néanmoins frappé de constater à nouveau à quel point la mythopoésie du premier trouve un écho « naturel / éternel » dans la théologie du dernier. La nature dans le Conte d'Arda incline le cœur des créatures rationnelles vers le bien auquel tend leur être. Cette inclination leur permet de reconnaître le bien sans les y contraindre. Les Incarnés ont en cela reçu le don précieux du libre arbitre qui permet de pourvoir soi-même à l'accomplissement de sa nature (et à l'accomplissement de celle des autres et du monde). Dans le Conte d'Arda, la nature acquiert le sens (traditionnel) d'une loi (on a même une occurrence de « la loi de la nature des Elfes » HoMe X, p.226), et cette loi n'est rien d'autre que la participation de la loi éternelle dans la créature — avec la correspondance entre la loi naturelle et la loi éternelle qui se superpose à celle qui s'établit entre l'elfique et le valarin quant à la manière de définir le Bien. Il s'agit d'une loi non écrite (ainsi il était des choses « au sujet [desquelles] ils n'avaient besoin d'aucune loi ou instruction, mais où ils agissaient par nature, même s'ils en donnèrent ensuite des raisons » p.234, cf. aussi p.225). Et il s'agit, pour les créatures douées de libre arbitre, d'une loi morale : la responsabilité des agents libres du Conte d'Arda est bien d'accomplir individuellement, personnellement, cette loi. Enfin, mais ce sera l'objet de l'une des deux parties restantes, à cette loi s'oppose également une autre loi (qui ne peut être appelée telle que par analogie) : celle du Marrissement, qui renvoie, chez saint Thomas, au foyer de convoitise.
Pour conclure, précisons que, à la différence de ses sources grecques, les compréhensions thomiste et tolkienienne de la loi naturelle n'intègrent pas un schéma normatif au sens d'une hétéronomie qui imposerait à la créature un bien extrinsèque. Si les deux optiques se retrouvent dans l'acceptation des limites et le refus de l'hubris, la seconde diffère radicalement de la première en ce qu'elle invite la créature à se conformer à son propre bien (cf. supra à la fin : la revue des « Couleurs du Monde ») : dans les perspectives thomiste et tolkienienne de la loi naturelle, la liberté se déploie dans l'accomplissement de sa nature, et où :
Dieu ne nous demande pas de nous conduire d’une manière déterminée. Cela ne veut pas dire que toute conduite serait indifférente. C’est le contraire qui est vrai, et qui est même un peu effrayant : la moindre de nos actions comporte une logique interne qui, en dernier ressort, l’oriente nécessairement tantôt vers la vie tantôt vers la mort. Car Dieu n’attend rien de plus que de voir ses créatures se déployer selon leur logique immanente : […] Dieu attend que, et s’attend à ce que les choses et les événements portent leurs fruits. Il ne leur demande rien d’autre que ce à quoi les pousse la nature avec laquelle Il les a créées, à savoir leur bien. C’est notre bien que cherche Dieu, non le sien. « Dieu n’est offensé par nous que du fait que nous agissons contre notre propre bien ». Dieu ne demande pas, parce que ce n’est pas son intérêt qu’il cherche. Il attend que nous atteignions notre bien.
Rémi Brague, « Dieu ne nous demande rien », Critique, 2006/1, pp.182-185
Jérôme
__________________________________________________
(*) J'avais longtemps buté sur la notion de loi naturelle. Jusqu'à ce que, tout récemment, la synthèse thomiste opérée par Jacques Maritain ne m'éclaire. Ce qui suit est un peu long, et pourtant ce n'est qu'une sélection minimale, me semble-t-il, pour avoir une idée juste de ce que signifiait la loi naturelle chez saint Thomas.
La loi naturelle, chez saint Thomas, est, pourrait-on dire, l'ordre idéal de « fonctionnement » de la Création :
La raison est la mesure des actes humains, mesure mesurante à l'égard des actes humains qui doivent se conformer à elle et qui sont bons dans la mesure où ils sont conformes à la raison, mais cette mesure mesurante à l'égard des actes humains est aussi une mesure mesurée. [...] Avant de mesurer mon acte libre, la raison doit d'abord regarder vers quelque chose d'autre que moi et que ma subjectivité singulière, et même vers quelque chose qui est au-dessus de ma subjectivité singulière [...]. Cet ordre supérieur au simple fait, suprafactuel, fondé sur l'être extramental, qui mesure la raison humaine, laquelle mesure les actes humains, cet ordre, c'est la loi naturelle.
Toute chose existant dans la nature, une plante, un chien, un cheval a sa loi naturelle, c'est-à-dire la normalité de son fonctionnement, la manière propre dont, en raison de sa structure et de ses fins spécifiques, cet être doit atteindre sa plénitude d'être typique, soit dans sa croissance, soit dans son comportement. [...] [Ainsi] de la loi naturelle des chevaux, loi naturelle par rapport à laquelle le comportement d'un cheval fait de lui un bon cheval ou un cheval vicieux dans le troupeau. Mais les chevaux ne jouissent pas du libre arbitre, leur loi naturelle n'est qu'une partie de l'immense réseau de tendances et de régulations essentielles enveloppées dans le mouvement du cosmos.
La loi naturelle de tous les êtres existants dans la nature est la manière propre dont, en raison de leurs nature et fin spécifiques, ils doivent ou devraient atteindre leur plénitude d'être typique dans leur comportement. Ces mots eux-mêmes « ils doivent ou ils devraient » n'avaient qu'une signification métaphysique (de la même manière que nous disons qu'un œil bon ou normal « doit » ou « devrait » être capable de lire des lettres sur un tableau à une distance donnée). Les mêmes mots « doit » ou « devrait » commencent à avoir une signification morale [...] quand nous passons le seuil du monde des agents libres. La loi naturelle se trouve, en un sens, chez tous les êtres ; pour l'homme c'est une loi morale parce que l'homme lui obéit ou lui désobéit librement [...]. Le premier élément fondamental qui doit être reconnu dans la loi naturelle est donc l'élément ontologique, je veux dire la normalité de fonctionnement qui est fondée sur l'essence de cet être : l'homme. La loi naturelle en général est la formule idéale de développement d'un être donné [...], la loi naturelle est un ordre idéal relatif aux actions humaines, une ligne de partage des eaux entre ce qui est convenable ou non convenable, conforme ou non conforme aux fins de l'essence humaine.
J. Maritain, La loi naturelle ou loi non écrite, pp.15-16, 22, 22-23
D'ordre métaphysique, la loi naturelle ne doit donc pas être confondue avec la normalité d'une loi statistique :
La loi naturelle n'est pas une loi écrite par les hommes, ils la connaissent plus ou moins difficilement et à des degrés divers, en courant le risque d'erreurs ici comme ailleurs. [...] Montaigne remarquait que chez certains peuples l'inceste et le larcin étaient tenus pour actions vertueuses. Pascal s'en scandalisait. Tout cela ne prouve rien contre la loi naturelle, pas plus qu'une erreur dans une addition ne prouve quelque chose contre l'arithmétique.
Ibid., p.27
Non écrite, la loi naturelle, quoique intelligible et accessible à la connaissance, ne l'est pas sous le mode conceptuel ou rationnel :
Il faut bien remarquer que la raison humaine ne découvre pas les régulations de la loi naturelle d'une manière abstraite et théorique, comme une série de théorèmes de géométrie. Bien plus, elle ne les découvre pas par l'exercice conceptuel de l'intelligence, ou par voie de connaissance rationnelle. [...] Quand [saint Thomas] dit que la raison humaine découvre les régulations de la loi naturelle sous la conduite des inclinations de la nature humaine, il veut dire que le mode même selon lequel la raison humaine connaît la loi naturelle n'est pas celui de la connaissance rationnelle, mais celui de ce qu'on appelle connaissance par inclination [:] la connaissance par inclination ou par connaturalité est une espèce de connaissance [...] par mode d'instinct ou de sympathie, et dans laquelle l'intellect [...] prête l'oreille à la mélodie produite par la vibration des tendances profondes [...] pour aboutir [...] non pas à un jugement fondé sur des concepts, mais à un jugement qui n'exprime que la conformité de la raison aux tendances auxquelles elle s'accorde.
Ibid., 28-29
En tant que tel, elle n'est rien d'autre que la participation à la loi éternelle :
La loi éternelle ne fait qu'un avec la sagesse éternelle de Dieu et l'essence divine elle-même. Cette loi éternelle est définie par saint Thomas : la raison suprême existant en Dieu, l'ordre de la sagesse divine en tant que cette sagesse tient sous sa direction toutes les actions et motions des choses [ST Ia-IIæ.93.1]. [...] Il faut remarquer que parmi toutes les créatures, la créature intelligente est soumise à la divine providence d'une façon particulière, — plus excellente, dit saint Thomas — en tant que la créature intelligente participe elle-même au gouvernement providentiel, puisqu'elle pourvoit elle-même à son propre bien et à celui des autres êtres. « Ainsi la raison éternelle est participée par la créature intelligente en tant même qu'intelligente, et par une telle participation cette créature a une inclination naturelle aux actions et aux fins qui lui conviennent » [...] En cette créature, il y a donc une participation à la loi éternelle selon laquelle elle possède une inclination naturelle au mode d'agir et à la fin qui lui conviennent. « C'est cette participation à la loi éternelle dans la créature raisonnable qui est appelée la loi naturelle » [ST Ia-IIæ.91.2]. [...] Tout ce qui est bien et tout ce qui est mal n'est qu'une impression de la lumière divine en nous.
[Étant donné que] les causes secondes agissent seulement dans la vertu de la première cause qui les active, [...] cette propriété que la raison humaine possède d'être la règle et la mesure de la volonté humaine [i.e. la loi naturelle] procède de la loi éternelle qui est la raison divine. D'où il est manifeste que la bonté de la volonté humaine dépend davantage encore de la loi éternelle que de la raison humaine. [...] L'autorité de la raison, comme forme de la moralité, et la valeur des régulations de la loi naturelle sont connues de nous ou peuvent être connues de nous avant que Dieu soit connu, mais elles sont ontologiquement fondées sur la sagesse divine, sur la raison éternelle, de sorte que, finalement, si nous ignorons Dieu, nous finirons par répudier cette autorité de la raison. [...] C'est pourquoi il faut donner un sens fort aux expressions de l'article 2 de la question 91 : cette lumière de la raison naturelle par laquelle nous discernons ce qui est bien ou ce qui est mal, n'est pas la lumière discursive, mais celle de la la raison jugeant par connaturalité sur le fondement des inclinations proprement humaines de notre nature, inclinations qui dérivent de la loi éternelle ; elle est l'impression de la lumière divine en nous qui transmet la vérité pratique.
Ibid., pp.37-39, 39-43
L'individualisation de cette loi, telle est la fonction, le rôle, du libre arbitre, à savoir d'actualiser la loi de façon personnelle et circonstanciée :
Une régulation générale ou universelle ne suffit pas pour faire qu'un acte soit bon, il faut pour cela une régulation totalement individualisée. [...] Toute décision à prendre est mienne, elle engagera ma personnalité toute entière dans son incommunicabilité. De même qu'une feuille d'arbre n'est jamais identique à une autre, de même en est-il d'une situation morale jamais identique à une autre. [...] Le jugement pratico-pratique, qui ne fait qu'un avec la décision libre, est droit s'il est conforme à des jugements de conscience droits ou présumés tels. Ce jugement est, par nécessité, pleinement individualisé [,] il est pris par rapport à ce que je suis hic et nunc, de par ma liberté, de par mon être de liberté dont je suis moi-même l'auteur au moment de la décision libre. La conclusion la plus importante à tirer de ces remarques, c’est que rien ne peut remplacer le jugement de conscience à tous ses degrés, [...] parce que là où il y a pleine et entière individualisation, il n’y a pas de science qui puisse remplacer la prudence ; toute science, aussi particularisée qu’on la fasse, ne peut porter que des jugements universels, elle ne s’applique pas au cas seul et unique au monde d’une personnalité individuelle. C’est pourquoi aucune science morale ne suffit en définitive à faire agir bien, il faut qu’à la science morale s'ajoute la vertu de prudence, l’exercice prudent du libre arbitre. J'ai à introduire dans le monde quelque chose d’unique et de nouveau dont je suis seul responsable et dont la justesse est ma propre affaire, quelque chose pour quoi il me faut connaître la loi et apprécier les circonstances, oui, mais aussi engager tout ce qui est bon dans ma propre subjectivité et par-dessus tout la droiture de mon vouloir. [...] Obéir au commandement individuel tel qu’il se manifeste dans le jugement de conscience ultimement concrétisé, c’est le point final du processus moral, qui présuppose le jugement de conscience, la loi naturelle, la loi éternelle. [...] Ce serait trop facile s’il suffisait d'appliquer simplement un code général, tel quel ; il n’y aurait aucune inquiétude, aucune anxiété, aucun doute, aucun risque. Cela ne peut être le cas à cause de la singularité de l’acte moral et de son incommunicable caractère d’être mien et d'engager ma personnalité tout entière. [...] Il n’y a pas de vie morale authentique sans ce processus d’individualisation par lequel la loi universelle devient ma loi, s’incarne dans les profondeurs de mon désir, de mes vraies fins personnelles.
Ibid., pp.68-78
Mais la notion de loi naturelle demeure certainement difficile à comprendre aujourd'hui. L'expression fait double (ou même triple) difficulté. Double difficulté, en tant que posent problème à la fois la notion de loi et la notion de nature. Car la première a pris un tour rationaliste. Et la seconde a pris un tour empiriste. Triple difficulté, donc, si l'on veut, en ce que ces deux écueils, qui sont le fait de deux pensées antagonistes, sont en plus réunies à l'intérieur du même syntagme.
La déformation rationaliste de la notion de loi remonte au XVIIe siècle :
Ce que nous pouvons remarquer, c'est que, depuis le XVIIe siècle, les gens se sont mis à penser à la Nature et à la Raison avec des majuscules comme à des divinités abstraites siégeant dans un ciel platonicien. En conséquence, la conformité d'un acte à la raison devait signifier que cet acte était copié sur un modèle tout fait, préexistant, que l'infaillible Nature a incité l'infaillible Raison à tracer et qui, en conséquence, doit être doit être immuablement et universellement reconnu dans tous les lieux de la terre et à tous les moments du temps. [...] Ainsi la loi naturelle a subi une systématisation artificielle, une refonte rationaliste, cela depuis Grotius et depuis l'avènement de cette raison géométrique qui apparaît d'une manière si significative au XVIIe siècle. Et alors, par une méprise fatale, la loi naturelle, qui est au-dessus des choses et qui précède toute formulation, qui est connue de la raison humaine, mais non pas en termes de connaissance conceptuelle et rationnelle, cette loi naturelle a été conçue à la manière d'un code écrit [...].
[Or,] le concept de loi est un concept analogue [...] : « une certaine ordination de la raison pour le bien commun et promulguée par celui qui a soin de la communauté » [ST Ia-Iæ.90.4]. [...] Ce qui définit la loi, c’est la raison, l'intelligence parce qu’il y a un ordre — la volonté comme telle n’est pas faiseuse d’ordre —, c’est la raison qui peut faire de l’ordre, qui est elle-même ordre. [...] En ce qui concerne la loi naturelle, ce mot lui-même de « loi » comporte un danger de malentendu parce que la notion la plus obvie, la plus immédiate que nous avons de loi, c’est la loi écrite, la loi positive ; par conséquent, si nous oublions le caractère analogique de la notion de loi, nous courons le risque de concevoir la loi naturelle et toute espèce de loi d’après le type de la loi la plus connue de nous, la loi écrite. [...] Je disais tout à l’heure que la loi naturelle est un ordre fondé dans la nature, ou requis proprement par la nature humaine dont les régulations sont naturellement connues de l’homme, naturellement, c’est-à-dire grâce aux inclinations par le canal desquelles la créature raisonnable participe à loi divine. La raison dont il s’agit ici — puisque la loi est un ordre déterminé par la raison — c’est celle de l’auteur de la nature. On ne trouve pas cette raison dans la nature elle-même comme on le croyait au XVIIIe siècle. C'est pourquoi la loi naturelle oblige en vertu de la loi éternelle. C’est de la raison divine qu’elle tient son caractère rationnel, par conséquent c’est d’elle qu’elle tient sa véritable nature de loi.
Nous comprenons ici en quoi a consisté l’erreur d’un penseur comme Grotius : tout en tenant que la loi naturelle supposait en fait l'existence de Dieu, il a écrit une phrase célèbre dans laquelle il disait que même si, par absurde, Dieu n’existait pas, la loi naturelle continuerait d’exercer son empire et son autorité sur nous. C’est qu’il considérait uniquement l’ordre de la nature — comme déchiffré par la raison humaine ; il ne voyait pas la relation entre l’ordre de la nature et la raison éternelle. [...] C’est l’ordre d’une Nature se suffisant à elle-même, et dont la raison conceptuelle et discursive établit la connaissance. Mais pourquoi serais-je obligé en conscience par un ordre purement factuel ? En réalité, si Dieu n’existe pas, il n’y a pas de pouvoir obligatoire de la loi naturelle. Si la loi naturelle n’engage pas la raison divine, elle n’est pas une loi, et si elle n’est pas une loi, elle n’oblige pas. [...] Avec Grotius, le processus de sécularisation de la loi naturelle a commencé sous une forme encore très masquée, puisqu’il parle encore de la volonté divine, mais en la reléguant dans le rôle d’autorité suprême. La raison et la nature humaines ont suffisamment de cohérence et de consistance pour établir la loi ; c’est là le germe de l’absolutisation de la nature et de la raison dont j’ai parlé [...] et qui fait comprendre pourquoi Grotius lui-même affirmait que même si, par absurde, Dieu n'existait pas, la loi naturelle continuerait à avoir sa valeur et sa force obligatoire [:] la nature devient un absolu, garanti du dehors par un autre absolu, l’absolu divin, et destiné à le supplanter ou à pouvoir se passer de lui. [...] Enfin, il faudrait ajouter une articulation à ce tableau, destinée à rattacher la théorie de Grotius à la notion de nature soumise à l’autorité de la volonté divine telle que nous la trouvons chez Suarez.
Ibid., pp.18,44-45, 45-46.113-114
La déformation empiriste de la compréhension de la nature va de pair :
Il ne fait aucun doute que nous vivons une période d’extraordinaire développement dans la capacité humaine de déchiffrer les règles et les structures de la matière, et la domination de l'homme sur la nature qui en découle. Nous voyons tous les grands bénéfices de ce progrès, et nous voyons toujours plus aussi les menaces d'une destruction de la nature par la force de nos actions. Il existe un autre danger, moins visible, mais non moins inquiétant : la méthode qui nous permet de connaître toujours plus à fond les structures rationnelles de la matière nous rend toujours moins capables de voir la source de cette rationalité, la Raison créatrice. La capacité de voir les lois de l'être matériel nous rend incapables de voir le message éthique contenu dans l'être, message appelé par la tradition lex naturalis, loi morale naturelle. Il s'agit d'un terme devenu pour beaucoup aujourd’hui presque incompréhensible, à cause d'un concept de nature non plus métaphysique, mais seulement empirique.
Benoît XVI, Congrès international sur la loi morale naturelle, Université Pontificale du Latran, 12 février 2007
En outre, par cet effet de balancier propre à l'histoire de la pensée occidentale, les deux erreurs, loin de se corriger, se sont affermies :
Un autre courant de pensée devait surgir et se développer à la fin du XVIIIe siècle, le courant kantien. La révolution copernicienne qu’il accomplit et en vertu de laquelle il n'y a plus de nature au sens ontologique — puisque l’objet de la connaissance est lui-même construit, fabriqué par l'entendement humain — nous laisse face à une morale de l'impératif catégorique où l’autonomie de la volonté humaine va remplacer la volonté divine et établir la loi sans l'intermédiaire de la nature. Nous pouvons rattacher la théorie kantienne de l’autonomie de la volonté à la conception que Suarez avait de la volonté divine comme norme suprême et remonter de là aux philosophies volontaristes du moyen âge [Occam]. Mais la volonté dont il s’agit maintenant est la volonté nouménale, et l’on comprend qu’elle prenne la place de la volonté divine. C’est aussi l'autonomie de la volonté nouménale avec la liberté humaine absolue dans le monde intelligible qui va fonder tout l’ordre moral. [...] Ajoutons que sous les influences conjuguées d’une part de Rousseau et de la révolution française, d’autre part de ces positions kantiennes, la notion de la loi naturelle va essentiellement se rattacher à celle de la liberté. Le principe fondamental de la loi naturelle est, en effet, pour Rousseau : on ne doit obéir qu’à soi-même, et pour Kant, dans l’introduction à la Métaphysique des mœurs : Une personne n’est sujette à d’autres lois qu’à celles qu’elle-même, soit seule, soit conjointement avec d’autres, se donne à elle-même. C'est la même pensée que celle de Rousseau : l’autonomie du vouloir et la loi exprimant la liberté, non plus la liberté absolue de Dieu comme chez Occam, mais la liberté absolue de la volonté pure pratique de l’homme.
J. Maritain, La loi naturelle ou loi non écrite, pp.114-116
Hors ligne
#84 29-04-2020 11:07
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Cher Yyr, merci pour « ce nouvel excursus (à peine plus grand :)) » — Mwarff ! — ainsi que pour la nouvelle note complémentaire de ce nouvel excursus (il fallait le faire, ça, inventer le concept de note complémentaire à un excursus : )).
S.
Hors ligne
#85 29-04-2020 13:26
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
[...] ainsi que pour la nouvelle note complémentaire de ce nouvel excursus (il fallait le faire, ça, inventer le concept de note complémentaire à un excursus : )).
J'ai eu un bon maître, maître ;)
[édit : mais J.-C. Michéa fait encore mieux ;)]
Hors ligne
#86 03-05-2020 00:10
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
Avec quelques jours de retard (je n'étais pas revenu lire ce fuseau jusqu'à cette nuit), voici quelques précisions/réactions...
Sur « l'autre scandale » de l'Église :
Je l'avais bien compris, mais c'est un scandale — tout aussi répugnant que l'autre — dont il était question depuis pas mal de temps aussi, même si cela a commencé à se savoir vingt ou trente ans après les premiers cas de pédophilie, qui sont sortis dans les années 1970. Il est fort possible néanmoins que la presse grand public s'en soit moins fait l'écho et que cela explique que tu n'en aies entendu parler que récemment.
Effectivement, il me semble que l'on en a beaucoup moins parlé dans les médias et la presse grand public que le scandale des abus sur mineurs : aussi bien n'avais-je pas été totalement surpris en apprenant cette autre réalité (sur le principe, l'abus de pouvoir n'épargne personne et dans aucun milieu), mais mon écœurement est en fait venu de l'ampleur de cette réalité et des détails horribles révélés par les témoignages des religieuses victimes, dans le cadre d'affaires parfois anciennes mais parfois aussi datant seulement de quelques années : cette parole des victimes, enfin audible et entendue par un large public, est au cœur du documentaire dont j'ai parlé, et c'est en particulier cette dimension inédite dans le traitement du sujet qui m'a marqué.
Il y aurait trop à dire, ce n'est pas le lieu & le temps manque, mais à propos de la justice selon Ellul, un contresens à éviter :
La justice : non pas juridique ou de rétribution, mais d'exactitude et de paix.
J. Ellul, Changer de révolution, Seuil, 1982, p. 290.
Ayant bien recopié (et donc, je l'espère, compris) ce passage du livre dans mes notes (éparses), mais je m'aperçois qu'en fait, en reprenant (trop rapidement dans le cadre de nos échanges) les mots du propos d'Ellul, j'ai malencontreusement retranché, si j'ose dire, l'exactitude au lieu de la rétribution. Merci donc de m'avoir signalé ce que est en fait une erreur d'inattention de ma part (d'où l'"effet contresens" malheureux). Du coup, j'ai édité mon message précédent en conséquence.
Quant à la question de l'évolution chrétienne du Légendaire, pour résumer pour l'instant l'une de nos divergences, et en forçant le trait à dessein, quitte à être provocateur, je dirais que les réflexions de Tolkien sont devenues plus densément chrétiennes à cause de sa mythopoésie et non l'inverse. Son exploration de Faërie était en même temps une exploration du réel, et ce qu'il y a découvert a résonné dans son cœur. Si ce qu'il avait découvert n'avait pas été chrétien, il aurait plutôt rejeté la foi que ce que sa raison, son cœur et sa nature lui montraient. Aussi d'après moi n'y-a-t-il jamais eu « lewisisation » de Tolkien (ce qui ne serait pas péjoratif pour autant en ce qui me concerne).
C'est cette lecture du concept de Faërie, comme de celui de subcréation d'ailleurs, qui me pose question : la mythopoésie n'a pas vocation à s'identifier à ce que Tolkien estimait être un "mythe vrai" (pourquoi ce mythe et non pas un autre ?) dont Faërie ferait au fond comme consubstantiellement partie. Pour essayer de comprendre la pensée de Tolkien, il faut bien tenir compte de ses propres concepts, mais delà à en tirer des sortes de lois universelles en matière de création, d'imaginaire, d'art, lois qui, comme par hasard, correspondrait aux certitudes d'un Benoît XVI... honnêtement, je ne vois pas pourquoi ? Tolkien a pu trouver dans son exploration du réel une justification de sa foi à l'aune de laquelle peut être appréhendée Faërie, mais en quoi le fait que cela puisse coïncider pour lui avec la raison, le cœur, la nature, relève d'autre chose que de son point de vue personnel ? Un chrétien peut toujours se prévaloir de sa foi, mais qu'en est-il du reste ? Son cœur bat-il dès lors plus fort face au réel que n'importe qui d'autre ? Sa raison, sa créativité, face au réel, sont-elles plus "éclairées" de ce fait que n'importe qui d'autre ? Faërie, à cette aune, me rappelle la formule de Julien Gracq sur l'œuvre décrite en forme de serrure : si c'est pour dire que c'est (encore une fois) une histoire d'initiés/étoilés, quel peut être l'intérêt de ce concept dans le cadre d'une réflexion sur la création littéraire et plus largement artistique, notamment en fantasy mais pas seulement ? Parlons-nous d'un auteur et de l'œuvre de son esprit, ou bien du réel en général mais de façon totalement indexée à l'angoisse métaphysique face à laquelle les chrétiens n'ont, au fond, qu'une seule réponse (fut-elle trinitaire) ? Telles sont en tout cas, un peu en vrac, mes interrogations... provocation de ta part ou pas ! ;-)
Enfin, ta « question ouverte » est parfaitement dans le sujet, que je ne prétendais pas épuiser. Je la note ! :)
Merci, Jérôme. ^^ C'est vraiment une question ouverte, car je ne cherche pas à amener dans une direction particulière... même si je reste attaché à une pensée en mouvement. ;-)
ce nouvel excursus (à peine plus grand :))
Effectivement... à peine plus grand ! ;-) Et, cette fois-ci encore, je salue l'effort ! ^^
Mais la notion de loi naturelle demeure certainement difficile à comprendre aujourd'hui. L'expression fait double (ou même triple) difficulté. Double difficulté, en tant que posent problème à la fois la notion de loi et la notion de nature. Car la première a pris un tour rationaliste. Et la seconde a pris un tour empiriste. Triple difficulté, donc, si l'on veut, en ce que ces deux écueils, qui sont le fait de deux pensées antagonistes, sont en plus réunies à l'intérieur du même syntagme.
La difficulté est ici triple en effet... mais pour ma part je ne parlerai pas de "déformation", qu'elle soit rationaliste pour la notion de loi ou empiriste pour la compréhension de la nature : parler de déformation sonne un peu comme parler de discordance dans la musique d'Ilúvatar... ;-) Les notions les plus générales face au réel peuvent évoluer : en "bien" ou en "mal", c'est une question de point de vue, et ce n'est pas tout-à-fait la même chose que, par exemple, une œuvre littéraire d'un auteur qui serait ultérieurement "mise au point" par des "collaborateurs posthumes" (oui, là, j'ai un exemple précis en tête... ^^) et qui pour le coup s'en retrouverait de facto déformée. Que les notions de loi et de nature restent pour l'humanité des notions pouvant être discutées, a fortiori parce qu'étant difficiles à appréhender, me parait, en tout cas, être plutôt un signe de (relative) bonne santé de notre pensée, laquelle en soi n'a pas à être inféodée ni à la seule "Tradition" ni à la seule "Modernité". Quant à commettre des "erreurs", plus ou moins "affermies", avec ou sans balancier, c'est une éventualité dont bien sûr personne n'est préservé (mais, ça, tu le sais). :-)
B.
Hors ligne
#87 08-05-2020 00:51
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
C'est cette lecture du concept de Faërie, comme de celui de subcréation d'ailleurs, qui me pose question : la mythopoésie n'a pas vocation à s'identifier à ce que Tolkien estimait être un "mythe vrai" (pourquoi ce mythe et non pas un autre ?) dont Faërie ferait au fond comme consubstantiellement partie. Pour essayer de comprendre la pensée de Tolkien, il faut bien tenir compte de ses propres concepts, mais delà à en tirer des sortes de lois universelles en matière de création, d'imaginaire, d'art, lois qui, comme par hasard, correspondrait aux certitudes d'un Benoît XVI... honnêtement, je ne vois pas pourquoi ? Tolkien a pu trouver dans son exploration du réel une justification de sa foi à l'aune de laquelle peut être appréhendée Faërie, mais en quoi le fait que cela puisse coïncider pour lui avec la raison, le cœur, la nature, relève d'autre chose que de son point de vue personnel ? Un chrétien peut toujours se prévaloir de sa foi, mais qu'en est-il du reste ? Son cœur bat-il dès lors plus fort face au réel que n'importe qui d'autre ? Sa raison, sa créativité, face au réel, sont-elles plus "éclairées" de ce fait que n'importe qui d'autre ? Faërie, à cette aune, me rappelle la formule de Julien Gracq sur l'œuvre décrite en forme de serrure : si c'est pour dire que c'est (encore une fois) une histoire d'initiés/étoilés, quel peut être l'intérêt de ce concept dans le cadre d'une réflexion sur la création littéraire et plus largement artistique, notamment en fantasy mais pas seulement ? Parlons-nous d'un auteur et de l'œuvre de son esprit, ou bien du réel en général mais de façon totalement indexée à l'angoisse métaphysique face à laquelle les chrétiens n'ont, au fond, qu'une seule réponse (fut-elle trinitaire) ? Telles sont en tout cas, un peu en vrac, mes interrogations... provocation de ta part ou pas ! ;-)
Là-dessus, je pense que nous ne nous sommes pas compris. Mais nous en reparlerons ;).
Quant à la « déformation » de la compréhension de la loi naturelle (expression empruntée à Maritain), cela pourrait nous amener (trop) loin. Tu sais que nous sommes en désaccord et que, pour moi, « les notions les plus générales face au réel » ne se réduisent pas à n'être qu'« une question de point de vue » ;).
Merci pour les encouragements.
PS : À noter que, lorsque, plus haut, j'avais évoqué « ce qui est censé être chrétien », je n'avais pas du tout à l'esprit la dimension morale sur laquelle vous êtres partis Elendil & toi ;) mais la dimension plus large, disons doctrinale ou dogmatique. Pas grave. Cela excède la discussion actuelle et devrait être traité ailleurs le cas échéant.
PSS : il semble que tu rajoutes volontiers des SIZE=2. C'est fort déconseillé : c'est ce genre de code qui migre mal d'un style (et donc d'un thème) à un autre. Préférer les balises SMALL et BIG ;).
Hors ligne
#88 08-05-2020 00:52
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
La liberté à l'égard du Bien
Nous avons donc vu que, dans le Conte d'Arda, la liberté totale était l'apanage de l'Artiste suprême et Auteur de la Réalité. Cette liberté est concrète. Elle se déploie dans la sagesse même de l'Unique, laquelle sagesse définit tout ce qui ce qui est possible et bon, et manifeste, comme à sa racine première, la miséricorde et la pitié. Nul ne peut jouer un thème qui ne prend pas sa source ultime en l'Unique (dans un langage thomiste : la Création dépend de cette loi éternelle). Le don d'Eru de la subcréation à Ses Enfants (et aux Ainur), qui leur accorde de jouer « un rôle [...] dans le Grand Conte en vue de sa complétion » (HoMe X, p.380) est une participation directe et unique à Sa sagesse, à Sa bonté et à Sa liberté. Cette disposition à la subcréation est constitutive de la nature des Enfants : elle incline leur cœur, leur intelligence et leur volonté, vers la reconnaissance du bien auquel tend leur être (dans un langage thomiste : la subcréation dépend de la loi naturelle, laquelle participe de la loi éternelle). Le libre arbitre se situe à ce niveau : il procède de la nature et des facultés spirituelles des Enfants, à même de pouvoir individualiser, personnaliser, chacun son accord aux thèmes de la Musique, c'est-à-dire son rôle dans le Grand Conte. Ou encore : la liberté, dans le Conte d'Arda, est un don qui s'épanouit dans et donne le pouvoir de pourvoir soi-même à l'accomplissement (dans l'Éternité) de sa nature.
Ce don s'inscrit ainsi dans une dépendance nécessaire : le subcréateur ne peut rien faire de véritable sans s'inscrire dans l'ordre de sagesse et de bonté qui provient d'Eru.
Cette dépendance, l'Ennemi et les siens la refusent. Leur compréhension de la liberté sera celle d'une indépendance absolue. Melkor, on s'en souvient, était parti à la recherche de la Flamme Impérissable « dans le Vide » i.e. au-delà de l'essence divine pour faire exister d'autres possibles par lui-même et lui seul. Être libre, pour Melkor, c'est être libre absolument, y compris à l'égard du Bien ... y compris, donc, à l'égard de la source même de la liberté : la Flamme Impérissable, qui « était avec Ilúvatar » (Ainulindalë). À partir de là, deux perspectives, deux langages, de la liberté, vont s'affronter.
Les événements de Valinor en donnent une illustration assez complète :
Melkor se prosterna aux pieds de Manwë et implora son pardon, et il s'humilia, et il fit serment de se conformer à sa loi, et d'apporter son concours aux Valar de toutes les façons qu'il le pourrait, pour le bien d'Arda, et pour le profit des Valar et des Eldar, s'il se voyait accorder la liberté et la dernière place du peuple de Valinor. Et Niënna intercéda pour lui (à cause de leur parenté), et Manwë exauça sa prière, car, étant lui-même pur de tout mal (free of all evil), il ne perçut point les profondeurs du cœur de Melkor, et il crut à ses serments. Mais Mandos demeura silencieux, et le cœur d'Ulmo fut empli d'appréhension. [...] Manwë lui accorda sa liberté au sein du Valinor. [...] Mais en fait, Melkor était déloyal et trahissait la clémence de Manwë, et il utilisa sa liberté pour répandre des mensonges et empoisonner la paix de Valinor. Ainsi, une ombre s'étendit sur le Royaume Bienheureux [...].
HoMe X, pp.93-94, cf. p.273
Melkor était déloyal, c'est-à-dire que la liberté qu'il demandait et qui lui fut accordée n'est pas celle qu'il poursuivait.
Ni celle qu'il enseigna à ceux qui, au début, ne connaissaient que la première :
[Ingwë, Finwë & Elwë] furent remplis de stupeur et d'admiration (filled with awe) devant la gloire et la majesté des Valar et désirèrent grandement la lumière et la splendeur des Arbres. Alors ils revinrent et recommandèrent aux Elfes de partir pour l'Ouest (to remove into the West), et la plus grande part de leur peuple écoutèrent leur conseil. Cela, ils le firent librement (of their free will).
Alors la connaissance et les arts faisaient le délice des Noldor, et Aulë et son peuple allaient souvent parmi eux. Le talent dont Ilúvatar les avait pourvus était tel qu'en bien des points, tout spécialement ceux qui requéraient adresse et finesse à l'ouvrage, ils surpassèrent très vite leurs maîtres. [...] Et leurs artisans conçurent des outils pour découper et façonner les gemmes, et ils les taillèrent en de nombreuses formes belles et brillantes ; et ils ne les amassaient pas mais les offraient librement (gave them freely) à tous ceux qui en désiraient, et tout Valinor fut enrichi par leur labeur.
HoMe X, pp.162,92
On a à nouveau ici tout un résumé de la liberté véritable, qui consiste à sortir de soi (to remove) pour aller vers (into) la lumière, la gloire, la majesté, et ainsi accomplir sa nature, c'est-à-dire déployer ses talents, les offrir, et enrichir le monde — il n'est pas anodin que les Avari soient glosés « the Unwilling ».
Melkor va leur apprendre une autre idée de la liberté.
En leur laissant entendre « que les Valar avaient amené les Eldar en Valinor par jalousie de leur beauté et de leur talent, par peur aussi de les voir devenir trop hardis (too strong) pour être gouvernés dans les pays libres (in the free lands) de l'Est » (p.95) : la liberté comme indépendance et hardiesse.
En leur faisant entrevoir « en leurs cœurs de puissants royaumes (mighty realms) qu'ils pourraient gouverner (could have ruled) à leur gré (at their own will) librement et puissamment (in power and freedom) dans l'Est » (p.275) : la liberté comme puissance et maîtrise.
C'est ainsi qu'avant que les Valar en soient avertis, le poison avait déjà été inoculé :
Les Noldor commencèrent à murmurer contre [les Valar] et les leurs ; et nombreux devinrent vaniteux, oubliant à quel point la plupart de leurs biens et de leurs connaissances leurs venaient gracieusement (in gift) de la part des Valar. La flamme du désir pour la liberté et de plus vastes royaumes brûla encore plus intensément dans le cœur ardent de Fëanor ; et Melkor riait secrètement, car ses mensonges avaient atteint leur cible, haïssant Fëanor par-dessus tout, et convoitant toujours plus les Silmarils. Mais il ne pouvait s'en approcher. Car, bien que Fëanor pouvait les arborer à son front flamboyant aux grandes occasions, ils étaient autrement gardés clos, enfermés à clé dans les profondes chambres de son trésor dans Túna. Il n'y avait pas encore de voleurs en Valinor ; mais Fëanor commença à aimer les Silmarils d'un amour cupide (with a greedy love), et répugnait à les laisser voir à tous, sauf à son père ou à ses fils. Il se rappelait maintenant rarement qu'ils brillaient d'une lumière qui n'était pas la sienne.
HoMe X, p.276
On connaît la suite : la chute, précipitée par Fëanor, du peuple des Ñoldor. Car même si Fëanor « ferma la porte au nez du plus puissant de tous les résidents d'Arda », le poison de ce dernier avait pénétré au plus profond de son cœur : « si le cœur de Fëanor est toujours libre et intrépide (free and bold) » (p.97) lui avait-il dit ... Ce sont les mêmes paroles et la même définition de la liberté qui franchiront les lèvres de Fëanor pour exhorter son peuple à tourner le dos aux Valar, et « par leur seule bravoure de conquérir liberté et royaumes (to win freedom and great realms) dans les pays de l'Est » en « de vastes terres (wide lands) [...] où pourrait marcher un peuple libre (a free folk) » (p.111). Le narrateur prend bien soin de préciser qu'il « faisait écho aux mensonges de Melkor ». Ses paroles se faisaient de plus en plus terribles : « Dites adieu à l'esclavage (bondage) ! [...] Dites adieu aux faibles (the weak) ! [...] Voyagez léger. Mais prenez avec vous vos épées ! [...] Et lorsque nous aurons vaincu (conquered) et regagné les Silmarils qu'il a dérobés, alors vous verrez ! Nous, et nous seuls, serons les seigneurs de la Lumière immaculée (unsullied Light), et les maîtres du bonheur et de la beauté d'Arda ! » (pp.111-112).
Les paroles rapportées par le messager de Manwë ont beau être de pure sagesse ...
À la folie de Fëanor je n'opposerai que mon conseil. N'allez pas plus loin ! Car l'heure est mauvaise (the hour is evil), et la route que vous empruntez mène à une tristesse que vous ne devinez pas. Les Valar ne vous enverront aucune aide dans cette entreprise ; ils ne vous feront pas davantage obstacle. Car sachez-le : tout comme vous êtes arrivés ici librement, librement vous en repartirez. [...]
HoMe X, p.114
... Fëanor maintient son cœur attaché à la conception melkorienne de la liberté, refusant « un retour à l'esclavage (bondage) » pour « à travers la tristesse trouver la joie — ou à tout le moins : la liberté ! » (p.114).
Ainsi que le résume le Commentaire de l'Athrabeth : « les Noldor [...] s'étaient, en tant que peuple, eux-mêmes coupés de la miséricorde [des Valar] ; ils avaient quitté Aman en exigeant une liberté absolue (absolute freedom) pour être leurs propres maîtres » (p.340).
Cette opposition entre une conception véritable de la liberté et sa déformation fait écho à celle que nous avons déjà vue en ce qui concerne la compréhension de la liberté et de la puissance du Créateur. Pour Occam, le possible ne dépend pas de l'essence (de sagesse et de bonté) de Dieu mais de Sa volonté arbitraire et absolue : Sa liberté lui permet de choisir un ordre des choses indépendamment de toute loi éternelle qui proviendrait de Sa nature. Il s'ensuit, entre autres, que la Création n'est pas caractérisée par un ordre ou une finalité quelconque, car ce serait là une limite à la toute puissance du Créateur. Il n'y a donc pas de nature. Il s'ensuit, au niveau de la créature, une opposition semblable : tandis que pour saint Thomas le libre arbitre est une liberté de qualité qui augmente avec la perfection de la nature, pour Occam le libre-arbitre est une liberté d’indifférence qui réside tout entière dans le pouvoir d’autodétermination de la volonté et qui n'est mesurée par rien : la plus grande liberté est l'indépendance absolue (cf. le post de Nikita quant à la conception de « l’homme moderne » pour qui « la liberté équivaut à l’absence de toute influence et de hiérarchie »). Ou encore : tandis que dans la perspective thomiste (et tolkienienne) le libre arbitre n'est pas entièrement « libre à l'égard du Bien » puisque le Bien détermine son déploiement et son épanouissement (il est par soi ordonné au bien et ne tend au mal que par déficience : choisir entre diverses choses conformément à l’ordre de la Création relève de la perfection de la liberté ; choisir une chose en s’écartant de cet ordre relève d’une déficience de la liberté), dans la perspective occamiste, toute disposition naturelle éventuelle constitue une entrave à la liberté et choisir « à égalité » entre le bien et le mal est essentiel à la liberté d'indifférence (le bien parfait, à savoir Dieu, qui augmente la liberté de qualité, constitue ici une diminution de la liberté d’indifférence, en diminuant son pouvoir de choisir le mal).
La métaphysique d'Occam aurait ainsi très bien convenu à Melkor pour dispenser ses enseignements.
Toutefois, l'inverse n'est pas vrai, et Occam n'aurait pas suivi l'Ainu rebelle.
Ce dernier, en effet, franchit une autre étape : l'effacement de l'existence divine. C'est toutefois ce qui s'est produit dans la Modernité, où le commun de la société s'est organisé etsi Deus non daretur (« comme si Dieu n'existait pas », cf. Grotius). Le soubassement (nominaliste) volontariste de la liberté des Modernes, avec cet effacement de la Volonté divine, a alors logiquement relocalisé la source de la liberté dans la volonté de l'individu, dans sa capacité à se déterminer de façon autonome et indépendante : « l’autonomie du vouloir et la loi exprimant la liberté, non plus la liberté absolue de Dieu comme chez Occam, mais la liberté absolue de la volonté pure pratique de l’homme » (Maritain, op. cit.).
La correspondance de Tolkien s'inscrit dans une déclinaison de cette dichotomie de la liberté. À l'époque de la Seconde Guerre Mondiale, quand les Inklings étaient conscients que « ce terme [de liberté] a été tellement galvaudé par la propagande qu'il a perdu toute valeur pour la raison et est devenu une simple dose émotionnelle propre à échauffer les esprits » (Lettres, n°81 p.138), Tolkien pouvait néanmoins écrire à son fils Michaël, sur la question du mariage, qu'il distinguait entre la liberté qui implique « exercice délibéré et conscient de la volonté (deliberate conscious exercise of the will) [et] abnégation (self-denial) » et celle qui implique « libre jouissance (free enjoyment) [ou/et] autocomplaisance (self-indulgence) » (Lettres, n°43 pp.79-80). Plus tard, partageant ses réflexions sur le personnage de Bombadil, il rappelait en préambule que « l'histoire [du SdA] est bâtie en termes d'oppositions, entre le Bien et le Mal, la beauté et la laideur sans pitié, [la royauté et la tyrannie], entre une liberté relative fondée sur l'assentiment et une compulsion qui n'a plus aucun autre objet, depuis longtemps, que le seul pouvoir, etc. » (Lettres, n°144 p.255). Suit la description de la liberté de Bombadil, qui « [a] fait “vœu de pauvreté” [et] renoncé au contrôle » (ibid.), soit l'antithèse complète et radicale de l'Ennemi. Tolkien prend alors soin de préciser que ce modèle ne pourrait toutefois survivre seul — nous devrons y revenir.
Pour achever cette partie dédiée à la question de la nature du libre arbitre : dépendance nécessaire ou indépendance absolue ? je terminerai par un passage du Seigneur des Anneaux (qui m'avait toujours ému et fait rire aux larmes) qui pose la question par le biais d'une autre question, connexe, celle de la confiance : consiste-t-elle à rechercher le bien de l'autre ou sa volonté ?
« Sam ! » s’écria Frodo, convaincu que la surprise était à son comble, et tout à fait incapable de décider s’il se sentait fâché, amusé, soulagé, ou simplement stupide.
« Oui, m'sieur ! dit Sam. Vous m’excuserez, m'sieur ! Je voulais pas vous faire du tort, monsieur Frodo, ni à M. Gandalf, d’ailleurs. Mais il a de la jugeote, lui, remarquez ; et quand vous avez dit partir seul, il a dit non ! emmenez quelqu'un de confiance. »
« Mais il semble que je ne puisse faire confiance à personne », dit Frodo.
Sam le regarda d’un air malheureux. « Tout dépend de ce que tu veux, intervint Merry. Tu peux nous faire confiance pour demeurer à tes côtés, envers et contre tout, jusqu’au bout. Et tu peux nous faire confiance pour garder un secret, quel qu’il soit — mieux que tu sembles toi-même en être capable. Mais tu ne peux pas nous faire confiance s’il s’agit de te laisser affronter les ennuis tout seul, et de partir sans dire un mot. Nous sommes tes amis, Frodo. Enfin, voilà. Nous savons une bonne partie de ce que Gandalf t'a expliqué. Nous savons pas mal de choses sur l’Anneau. Nous avons terriblement peur... mais nous venons avec toi ; ou nous te talonnerons comme des chiens. »
SdA, I.5
Tout comme Aragorn et Éomer tenaient la loi éternelle pour supérieure à la loi du prince, Merry considère que la véritable confiance est fondée dans l'amour et le bien d'autrui et non pas dans sa volonté (même si, dans un cas comme dans l'autre, la loi du prince et la volonté individuelle ne sont pas tenues pour nulles).
Hors ligne
#89 08-05-2020 03:35
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
Quant à la « déformation » de la compréhension de la loi naturelle (expression empruntée à Maritain), cela pourrait nous amener (trop) loin. Tu sais que nous sommes en désaccord et que, pour moi, « les notions les plus générales face au réel » ne se réduisent pas à n'être qu'« une question de point de vue » ;).
Mon regard sur la connaissance face au réel n'est pas aussi relativiste que tu sembles persister à vouloir l'établir, Jérôme. :-) L'essentiel du désaccord entre nous tient en ceci : je ne crois pas que la connaissance et la compréhension de la loi naturelle, s'il peut être possible de la connaître et de la comprendre, puissent forcément et univoquement passer par les certitudes religieuses auxquelles tu tiens absolument à étroitement associer cette connaissance et cette compréhension, qui plus est "jusqu'à preuve du contraire" (facile) et sous couvert de rationalité (douteux). En résumé, tu veux établir la vérité à partir de ce que tu crois être la Vérité, quand je ne fais que chercher la vérité en n'excluant pas que si Vérité il y a, elle soit éventuellement inconnaissable et incompréhensible. Le voila, le désaccord, ici plus clairement rappelé et formulé à mon sens. :-) Notre regard respectif sur Faërie en découle, pour nous en tenir à ce qui peut ne pas nous amener trop loin. Autre élément important, que je me permets de rappeler : je ne cherche pas à avoir raison, mais je crois simplement (encore) aux vertus de la dialectique socratique, même quand, en face de soi, autrui semble en permanence tenté d'amener l'interlocuteur vers ce qu'il s'est convaincu d'être la Vérité... et qui n'est peut-être que "sa" vérité, dès lors non assumée comme telle, du moins à ce qu'il semble. :-)
S'agissant de Faërie, je ne crois pas qu'elle subsume à (ou sous) la Vérité chrétienne. L'inverse me parait plus conforme à quelque loi naturelle, si celle-ci est connaissable et compréhensible. Peut-être que Faërie est une chose trop sérieuse pour être confiée à la seule pensée d'un écrivain en particulier, qu'il ait ou non été un fervent catholique...
PSS : il semble que tu rajoutes volontiers des SIZE=2. C'est fort déconseillé : c'est ce genre de code qui migre mal d'un style (et donc d'un thème) à un autre. Préférer les balises SMALL et BIG ;).
Il semble que tu interprètes l'emploi des SIZE=2 comme une fantaisie de ma part : ce n'est évidemment pas le cas. :-)
N'étant pas un obsédé du codage (loin s'en faut), je me passerais bien, à vrai dire, de devoir repasser derrière des réductions de police qui me paraissent parfois intempestives pour les besoins de l'expression. ^^' Si les SIZE=2 migrent mal, tu m'en vois évidemment désolé, mais toujours est-il que la balise BIG n'est pas tout-à-fait satisfaisante en matière de taille, dès lors que l'on souhaite répondre en citant tout en maintenant le tout en petits caractères, puisqu'avec BIG le texte de la citation devient, tout simplement, un poil trop gros par rapport au texte de la réponse (dans le cadre d'un message tout en SMALL à la base), alors que le problème, à ce qu'il me semble, se pose moins avec SIZE=2 (même si les différences entre BIG, SIZE=2 et le texte principal en SMALL semblent parfois varier, parfois presque d'une prévisualisation à l'autre, pour une raison qui m'échappe... et qui, je l'avoue, me fatigue un peu... ^^'). Rendre les citations vraiment minuscules peut éventuellement avoir des avantages dans certains cas, mais pas dans tous : l'idéal serait qu'une citation reprise en SMALL soit ramenée à la même taille que le texte principal en SMALL, mais j'ignore si cela peut être automatisé. Voila pourquoi en tout cas, par la force des choses, dans ce forum de maniaques ;-), j'ai été contraint d'avoir recours aux SIZE=2. C'est du petit bricolage, certes, mais on ne pourra pas me reprocher d'essayer, autant que possible, de m'adapter au bricolage principal, dont toutes les subtilités ne nous sont pas toujours connues, faute d'envisager forcément toujours toutes les conséquences de telle ou telle évolution, variation de style/thème, migration ultérieure, ou autre. :-)
Entre nous, sincèrement, par rapport aux autres participants passant encore par ici, je passe déjà sans doute beaucoup trop de temps à écrire en ces lieux, même si je ne fais heureusement pas que cela : ne me désespérez pas trop de continuer à participer à l'aventure, la barre me paraissant déjà suffisamment haute. :-)
B.
P.S.: c'est moi, ou la police de caractère en SMALL s'est encore rétrécie ? ^^'
P.S.2: même en taille normale, SIZE=2 me parait plus harmonieux que BIG dans le cadre d'une citation de participant, y compris en comparaison d'une citation d'auteur... Enfin, bref... Je ne change rien à ce qui a été fait : même mon propre perfectionnisme a ses limites.
***
EDIT (08/05/2020, 17h30): message complété au début, au sujet de notre désaccord de fond.
Hors ligne
#90 10-05-2020 15:48
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Merci Yyr pour cette nouvelle livraison, qui donne à relire les textes sous un jour nouveau.
Je n'avais pas noté (ou j'avais oublié) cette phrase très juste concernant Fëanor : « Il se rappelait maintenant rarement qu'ils brillaient d'une lumière qui n'était pas la sienne », ou bien sa parole totalement démente : « Nous, et nous seuls, serons les seigneurs de la Lumière immaculée, et les maîtres du bonheur et de la beauté d'Arda ! »
Quant à la tristesse de Sam et aux paroles de Merry («nous te talonnerons comme des chiens »), c'est magnifique.
Un beau et bon fuseau, à lire, tu nous donnes, maître Yyr : )
Hors ligne
#91 11-05-2020 08:35
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Hier, au fil d'une lecture, je tombe sur ce passage qui fait fortement écho avec ta présentation :
L’opposition du bien et du mal est pour lui [l’homme] un fardeau intolérable. […]
Une tradition albigeoise raconte que le diable a séduit les créatures en leur disant : « Avec Dieu vous n’êtes pas libres, car vous ne pouvez faire que le bien. Suivez-moi et vous aurez la puissance de faire à votre gré le bien et le mal. » L’expérience confirme cette tradition. […]
L’homme a suivi le diable. Il a reçu ce que le diable lui promettait. Mais mis en possession du couple bien et mal, il est aussi à l’aise qu’un enfant qui aurait pris dans sa main un charbon brûlant. Il voudrait jeter le charbon. Il s’aperçoit que c’est difficile.
[Une des] méthodes pour y parvenir […] consiste à nier la réalité de l’opposition entre le bien et le mal. Notre siècle l’a essayé. Une horrible parole de Blake a eu parmi nos contemporain un grand retentissement : « Il vaut mieux étrangler un enfant dans son berceau que de garder au cœur un désir non satisfait. » [Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desire (Proverbs of Hell, plate 10)]
Seulement ce n’est pas le désir qui oriente l’effort, c’est le but. L’essence même de l’homme est l’effort orienté ; les pensées de l’âme, les mouvements du corps, n’en sont que des formes. Quand l’orientation disparaît, l’homme devient fou, au sens littéral, médical du mot. C’est pourquoi cette méthode, fondé sur le principe que tout se vaut rend fou. Quoiqu’elle n’impose aucune contrainte, elle précipite l’homme dans un ennui semblable à celui des malheureux condamnés à la prison cellulaire, et donc la plus grande douleur est de n’avoir rien à faire.
— Simone Weil, « Cette guerre est une guerre de religions », in : Œuvres complètes, t. V, Écrits de New York et de Londres, vol. 1 : Questions politiques et religieuses (1942-1943), Gallimard, 2019, p.251
Une variante du dernier paragraphe revient sur cette liberté d’indifférence
[…] et l’homme, avant d’être pensée, chair vivante ou matière, est direction ; il ne pense et ne se meut que pour quelque chose. En lui ôtant la pensée de but, on le condamne en pleine liberté à l’ennui du prisonnier […].
Quand la prospérité procure des forces et des ressources surabondantes, on peut tromper cet ennui en jouant. Ce ne sont pas des jeux d’enfants ; ce sont des jeux d’hommes mûrs qui jouent sans croire au jeu. Des jeux de prisonniers.
— Simone Weil, ibid., p. 592.
Enfin, la présentation du recueil s'ouvre par une expression de Simone Weil rapportée par Hélène Honnorat, qui fut son amie :
Être libre, ce n'est pas choisir, c'est avoir choisi.
— Simone Weil, ibid., p. 13.
S.
Hors ligne
#92 11-05-2020 22:16
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Merci Sosryko,
Pour les paroles à la fois enracinées et orientées de cette grande Dame.
Et plus encore pour les tiennes : Ps 132:2.
Yyr
Hors ligne
#93 12-05-2020 05:44
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
S'agissant de Faërie, je ne crois pas qu'elle subsume à (ou sous) la Vérité chrétienne. L'inverse me parait plus conforme à quelque loi naturelle, si celle-ci est connaissable et compréhensible. Peut-être que Faërie est une chose trop sérieuse pour être confiée à la seule pensée d'un écrivain en particulier, qu'il ait ou non été un fervent catholique...
Je sens qu'il faut que je précise ce que j'ai voulu dire : il ne s'agit pas pour moi d'écarter la pensée de Tolkien s'agissant de Faërie (ce serait bien dommage), mais simplement d'en tenir compte avec mesure, dans une perspective de définition et d'appréhension ouverte, et non close dans une vision qui serait trop étroitement liée au seul point de vue propre à cet écrivain, la fantasy moderne n'étant notamment pas née, de toute façon, de la seule définition tolkienienne du conte de fée.
À cette aune, mon regard sur Faërie tend plutôt à rejoindre en fait celui exprimé par Necsipaal dans son Avant-Propos aux Errances en Faërie que j'ai relu récemment : en partant de la définition tolkienienne, Faërie apparait comme le domaine du merveilleux (d'un surnaturel plus ou moins accepté) mais avec des contours souvent flous vis-à-vis du réel, quelque-chose d'« indescriptible quoique sans être imperceptible » pour reprendre les mots de Tolkien, « une chimère, surprenante et inquiétante, parfois cruelle, dont la vue seule suffit à apaiser l'esprit de qui sait en emprunter les chemins bigarrés et les valeurs en trompe l'œil » pour reprendre les mots de Necsipaal. À travers toutes sortes de récits aux objets divers (« satire, aventure, moralité, fantaisie » évoqués par Tolkien) Faërie invite ainsi à renouer avec une certaine tradition mythique, foisonnante, attirante, mais pas particulièrement avec un seul « mythe vrai » (selon la foi de Tolkien) auquel (ou sous lequel) le Royaume de Faërie serait subsumé. Voila ce que j'ai voulu dire.
Par ailleurs, suite à des remarques reçues en privé, je crois qu'il est peut-être plus simple de me mettre pour le moment en retrait des présents échanges. Je ne suis pas en mesure de savoir s'il est seulement question ici de recherche sur la conception tolkienienne du libre arbitre (et entre autres sur ses correspondances possibles avec la conception de Thomas d'Aquin), ou bien s'il s'agit de cela tout autant que de développer un point de vue sur l'œuvre (de fantasy, mais pas seulement) de Tolkien susceptible de me paraitre trop univoquement orienté. À cette aune, j'avoue que je ne sais pas comment utilement contribuer aux échanges, à propos d'un sujet qui cependant m'intéresse et dont je salue, encore une fois, le traitement patiemment fouillé dont il fait ici l'objet. Comme je l'ai dit plus haut, il m'arrive de ne pas toujours comprendre le ton ou l'intention de certains messages, de même que l'usage qui peut être fait de citations dont on ne sait pas toujours si elles servent seulement la recherche ou la mise en avant de points de vue qui la dépasse quelque peu. Peut-être que je prends tous ces échanges de façon trop personnelle, en surinterprétant et en me posant trop de questions, mais bon... dans le doute, mieux vaut probablement faire une pause me concernant, et laisser ainsi en particulier Yyr développer toute sa réflexion jusqu'au bout.
Peace and Love,
B.
Hors ligne
#94 13-05-2020 12:35
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Je ne le fais pas exprès, mais une nouvelle lecture, ce jour, vient à point et redouble les échos précédents au présent propos. Nous ne sommes pas en 1942 mais en 1890 cette fois, alors que Jean Jaurès, encore professeur de philosophie à la faculté de Toulouse, explore le fondement philosophique du socialisme :
L’humanité ne peut donc être une que d’une unité morale et spirituelle ; et voilà pourquoi le socialisme ne peut s’appuyer que sur les doctrines qui ont affirmé et justifié l’unité humaine. Je dirais volontiers : il y a trois doctrines qui ont affirmé l’humanité : la doctrine stoïcienne, la doctrine chrétienne, et la doctrine kantienne. En comprenant dans ce nom toutes les philosophies qui au XVIIIe et au XIXe siècle ont proclamé la valeur absolue de la personne humaine par le droit et la liberté.
— Jean Jaurès, Qu’est-ce que le socialisme, Pluriel, 2019, p. 48.
Cette comparaison des trois « doctrines » le conduit à anticiper une métaphore tolkienienne (c’est ce qui m’a convaincu que reproduire ces textes ne nous éloignait pas trop de notre sujet mais nous y ramenait au contraire) :
[…] c’est la même pensée, le même rayon de lumière humaine réfracté dans trois milieux différents, en résignation splendide et en charité orgueilleuse dans l’aristocratie de la Rome impériale, en douceur évangélique dans les foules de souffrance et d’espérance, en fierté morale et en respect du devoir dans nos sociétés modernes […].
— Jean Jaurès, Ibid.
Un peu plus loin, répondant à la critique de l’intolérance adressée au socialisme :
l’idée d’humanité sur laquelle le socialisme repose n’est pas distincte de l’idée profonde de liberté. La communion des êtres en Dieu n’est possible que par un libre élan intérieur d’amour : et le devoir n’a une valeur absolue que parce qu’il se confond dans la personne humaine avec la liberté morale. Ainsi, développer l’humanité, c’est au fond développer la liberté : mais la liberté vraie n’est pas cette liberté d’indifférence qui est supposée choisir presque arbitrairement le pour et le contre et qui est par définition toujours égale à elle-même. La liberté vraie, c’est l’adhésion intérieure au devoir et à la raison sous la seule action du devoir et par la seule influence de la raison.
— Jean Jaurès, ibid., p. 50
Il enchaîne avec un développement qui oppose le couple raison/liberté à celui de fatalité/désespoir qui nous ramène encore au propos de ce fuseau (mais avec une définition de la nature comme uniquement lieu de déterminations et une réponse collective et non pas personnelle, puisque le rôle de Dieu est joué par l’humanité désormais) :
Mais l'homme tient à l'animalité, et il fait partie de la nature : c'est dire que la raison et la liberté, pour se développer en lui, rencontrent des obstacles sans nombre : l'ignorance, la misère, la fatalité des instincts [51] héréditaires dans les âmes incultes en qui l'hérédité est presque tout, la force des convoitises et des appétits déchaînés par le mouvement même de l'ordre social ; et enfin ce sombre désespoir qui est la négation même de la raison puisque la raison communiquant avec l'éternel englobe nécessairement l'espérance, mais désespoir inévitable pour la plupart des âmes humaines à un certain degré de misère, surtout à un certain degré d'abandon et qu'on pourrait appeler la folie de la souffrance. Et quand l'humanité interviendra pour régler ces désordres, elle ne portera pas atteinte à la liberté elle lèvera au contraire les derniers obstacles qu'oppose la nature à la liberté et à la raison.
— Jean Jaurès, ibid., p. 50-51
Rq : On n’est pas loin non plus de Thomas d’Aquin puisque Jacques Maritain, avant de devenir un commentateur de la pensée du docteur angélique fut un grand admirateur de Jean Jaurés ;-)
S.
Hors ligne
#95 14-05-2020 08:39
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
À peine descendu de cheval, me voila remis en selle... Il fallait le dire tout de suite, que l'on avait le droit de parler ici de socialisme ! ;-)
Plus sérieusement, suite à de nouveaux échanges en privé, il apparait que l'impression récurrente que je peux avoir, de longue date, d'une évocation de la parole de Tolkien conjointe à des éclairages chrétiens et prenant dès lors l'aspect d'une argumentation pro domo... reste avant tout une impression de ma part. Dans le fond, je me doute bien que ni Yyr, ni Sosryko ne prétendent qu'une seule lecture de l'oeuvre, celle qu'ils proposent, soit possible, et qu'ils sont bien conscients que cette lecture ne saurait être suffisante. Puisque je m'en doute bien au fond, je devrais me répéter cela plus souvent, si je veux notamment être à la hauteur de ce que j'ai écrit précédemment s'agissant de ne pas prendre mes interlocuteurs pour des représentants d'une Idée avec un grand « I » ou d'un système de pensée, et s'agissant de rester fidèle à ma devise « faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux », y compris en appréhendant le travail qu'autrui prend la peine de partager.
Nous avons, toutes et tous, quelque-chose à nous apporter, que nos éclairages respectifs sur tel ou tel sujet soient ou non tolkieniens. À cette aune, il me semble que ce que j’appelle le « lithisme » représente évidemment un ennemi commun, un piège nous concernant tous, même évidemment quand on est sceptique. La pensée des philosophes est là pour nous aider à garder notre propre pensée en mouvement, non pour nous servir univoquement de guide « figé ». C'est de cette façon que, pour ma part, je peux apprécier un penseur comme David Hume (pour ce que j'ai lu de lui ; en matière de scepticisme, je connais mieux Montaigne en comparaison), comme tout autre penseur qui peut éventuellement « me parler » par sa réflexion, fut-elle sur tel ou tel sujet l'anti-thèse dialectique de tel autre penseur dont la réflexion pourra aussi également « me parler » en quelque autre façon (Jean Jaurès, loin d'être un sceptique ou un empiriste, est en cela un bon exemple).
Je ne le fais pas exprès...
Si Sosryko ne le fait pas exprès, pour ce qui me concerne, je me sens un peu comme Hercule Poirot se qualifiant d'imbécile, face à quelque-chose qu'il aurait pu voir plus tôt dans le cadre d'une enquête : la dernière fois que Jean Jaurès a été évoqué sur le présent forum de JRRVF, cela s'est passé dans un autre fuseau où j'avais moi-même recommandé, entre autres, la lecture de l'œuvre philosophique de Jaurès, éditée par Jòrdi Blanc (né Georges Blanc) aux éditions de l'association Vent Terral. Car cette œuvre contient bien sûr des éléments pouvant concerner la réflexion présente : nom d'une pipe, j'aurai dû y penser ! ^^' Ceci dit, nous sommes tellement habitués à tourner autour de références plus ou moins immédiatement « compatibles » avec le catholicisme conservateur de Tolkien, que j'en suis probablement venu, avec le temps, à ne plus envisager d'en suggérer d'autres...
Cependant, je ne connaissais pas le texte évoqué par Sosryko... mais ce n'est pas très étonnant, puisqu'il est apparemment longtemps resté inédit et que sa première publication remonte seulement à quelques mois. Il semble très intéressant en raison de l'époque à laquelle il a été semble-t-il écrit (1890), soit peu de temps avant que Jean Jaurès n'adhère explicitement et définitivement au socialisme, en 1892, année où il est choisi comme candidat des socialistes de Carmaux, contre le marquis de Solages, à une élection législative anticipée faisant suite à la célèbre grève des mineurs carmausins de cette année-là. On a eu souvent tendance à distinguer, sur fond de convictions plus ou moins militantes, le Jaurès d'avant 1892 et celui d'après, comme s'il y avait eut deux Jaurès, l'un jeune intellectuel bourgeois, l'autre adulte entré dans l'Histoire et utile à la lutte des classes. Pourtant, il n'y eut au fond qu'un Jaurès, dont la force fut, y compris dans une perspective politique et socialiste, de s'être d'abord construit philosophiquement lui-même avant de s'engager dans l'action politique, ce qui l'a davantage prémuni que d'autres d'une perméabilité excessive aux influences doctrinaires (notamment marxistes) une fois plongé dans le bain de la politique et de l'engagement socialiste.
Le texte qu'évoque Sosryko, même à travers seulement quelques extraits, m'en rappelle ainsi d'autres, antérieurs comme postérieurs, sachant que l'engagement politique de Jaurès s'inscrit dans le prolongement d'une philosophie qui fut le moteur de son action, avec une proposition que contenait déjà De la Réalité du Monde sensible, sa thèse principale publiée à Toulouse en 1891 et soutenue en Sorbonne le 5 février 1892. Définissant ladite thèse comme étant la théodicée de Jaurès, Jòrdi Blanc a pu résumer ainsi cette proposition : face au drame humain et universel qu'est « l'abîme », « entre l'infini extérieur et l'insignifiance de l'individu humain, Jaurès ne propose pas le pari pascalien, repli mystique dans l'intériorité, mais un acte d'amour à la dimension de l'humanité et de l'univers. »
Avant de donner, à partir de 1889, des cours publics à la faculté de Toulouse, Jaurès a professé un cours de philosophie au lycée d'Albi pendant l'année scolaire 1882-1883 (tout en se rendant déjà alors à Toulouse, une fois par semaine à partir de janvier 1883, pour donner une conférence de philosophie à la faculté des lettres). Ce cours de philosophie d'Albi constitue en quelque sorte le prélude, le banc d'essai de la thèse soutenue par Jaurès dix ans plus tard. Ce cours, qui nous est parvenu grâce à la retranscription de deux des anciens élèves de Jaurès (in fine sur deux cahiers manuscrits), comporte 43 leçons, avec des suppléments sous forme de 28 autres leçons, suppléments suivis de sept leçons d'histoire de la philosophie. La question qui nous occupe est abordée dans la 29e leçon du cours, « De la liberté. Responsabilité, remords ». Le temps me manque pour vous recopier tout ça (j'ai encore bien d'autres choses à écrire par ailleurs... ^^'), mais Jòrdi Blanc évoque ainsi le propos de cette leçon dans son introduction au cours :
Traitant de la morale avant la théodicée, et félicitant Kant d'avoir émancipé la morale de la métaphysique, Jaurès semble bien s'affranchir de l'ordre cousinien des matières faisant dépendre de Dieu l'obligation morale. Mais son exposé de la morale kantienne, largement inspiré de Boutroux, ne fait qu'aboutir à l'une des critiques les plus sévères du formalisme moral kantien que l'on connaisse.
Véritable détachement avancé du cours de morale, curieusement placée à la fin du premier cahier et du cours de psychologie et de logique, se trouve une leçon intitulée « De la liberté. Responsabilité, remords ». Consacrée à la fameuse antinomie du libre arbitre et du déterminisme, le problème de la liberté y est abordé de manière historique, historiale dirait-on dans le jargon de l'authenticité. La liberté, dit Jaurès, a été mise en cause deux fois : la première lorsqu'elle s'est trouvée contestée par l'affirmation de la toute-puissance divine, la seconde lorsqu'elle a été menacée par la postulation du déterminisme par la science. Rouvrant le dossier de la querelle sur la prédestination, c'est contre Pélage et les Jésuites, affirmant la plénitude du libre arbitre en même temps que la soumission de la raison humaine à la raison divine, qu'il se prononce, et pour saint Augustin, niant le libre arbitre, et renchérissant encore sur ce dernier.
La tentative de Kant, consistant, dit-il, à dissocier le monde des phénomènes où règnerait le déterminisme, d'une intériorité nouménale où règnerait la liberté, est aussi vaine et illusoire que la tentative d'un Pélage prétendant couper l'homme en deux. Accordant à Kant l'affirmation du déterminisme des phénomènes, il conteste l'exception de la liberté nouménale.
Je ne peux dire ma volonté que si ma volonté découle de ma personne. La liberté humaine n'est pas concevable sans l'affirmation du déterminisme du moi individuel, et loin qu'il faille opposer le libre arbitre au déterminisme, nous n'avons que deux possibilités : celle de nous soumettre au déterminisme des choses ou celle de nous soumettre au déterminisme du bien. Nécessité et déterminisme, liberté et moralité : Jaurès dissocie ce que Kant croyait indispensable de relier et relie ce que Kant croyait nécessaire de dissocier. Rompant avec la conception kantienne de la moralité comme liberté, il rompt du même coup avec tout cartésiano-spiritualisme moral en renouant avec la conception spinoziste et leibnizienne de la moralité comme obéissance à la nécessité.
Jòrdi Blanc, in Jean Jaurès, Œuvres philosophiques I, Cours de philosophie, Valence d'Albigeois, Vent Terral, 2005, « Méditation sur la substance. Introduction au Cours de philosophie », II., 3., p. 138-139.
Pour donner à lire tout de même un peu le propos de Jaurès lui-même, voici les dernières phrases de cette 29e leçon de son Cours de philosophie :
[...] Quand la volonté est conçue comme une puissance arbitraire et indéterminée, elle apparaît du même coup comme ployable en tous sens et, n'étant pas soumise à des influences intérieures, elle l'est d'autant plus à des influences extérieures. Voila pourquoi, du même coup, les Jésuites affirmaient le libre arbitre de la volonté humaine et enserraient du dehors cette volonté par des influences innombrables.
Au contraire, lorsque la volonté est subordonnée à des croyances, à des sentiments, à un idéal, comme il ne dépend de personne de changer en nous ces croyances, ces sentiments, cet idéal, notre caractère est ferme et notre volonté est indépendante. La liberté ne consiste pas pour nous dans un libre arbitre chimérique et indifférent. Elle consiste dans la soumission croissante de notre être à la raison. La raison, en effet, commune à tous les hommes, la même en tous, a quelque-chose d'universel et d'impersonnel par où ceux qui la suivent échappent aux hasards individuels de la naissance, de l'éducation et de la destinée, et cette raison qui nous affranchit n'est pas une puissance qui nous est étrangère. Il est vrai qu'elle n'a rien à voir avec notre individu particulier. Mais chacun de nous n'est pas seulement tel individu, ayant tel nom ou tel prénom, tel âge et telle figure, telle profession et telle demeure. Il est avant tout un homme. Or à quoi la raison fait-elle appel quand elle nous commande le bien, la justice, la charité ? Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas à ses caprices, à ses intérêts particuliers ou variables, c'est au fond humain, à la personne humaine qui est en nous. Ainsi donc, en même temps que la raison nous appelle, nous élève et nous affranchit, c'est nous qui, par le meilleur, le plus intime, le plus durable de notre être, faisons la force de la raison, si bien que là encore, et jusque sur ces hauteurs où nous sommes débarassés d'une individualité de hasard et où nous manifestons dans sa plénitude la personne humaine universelle, permanente qui nous est commune avec les autres individus, c'est encore par nous que nous sommes gouvernés, par nous que nous sommes affranchis.
Jean Jaurès, Œuvres philosophiques I, Cours de philosophie, op. cit., Cahier I, 29e leçon « De la liberté. Responsabilité, remords » (p. 310-325), p. 324-325.
À Toulouse, durant ses années d'enseignement, Jean Jaurès compta notamment parmi ses collègues l'historien de l'art Émile Mâle, lequel, en décembre 1889, raconte dans une lettre (citée par J. Blanc) : « J'ai fait la connaissance de Jaurès [...] qui a repris son cours de philosophie à la faculté. C'est un charmant garçon. Nous causons de temps en temps de saint Thomas d'Aquin — car il lit la Somme, cette haute cathédrale du verbe. J'ai assisté à quelques-unes de ses leçons. Il parle avec une chaleur d'apôtre et de magnifiques métaphores : la faculté refuse du monde. »
B.
Hors ligne
#96 14-05-2020 22:46
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Ce fut une découverte totalement fortuite, que ces pages de Jean Jaurés, feuilletées ces derniers jours pour la premières fois, le livre figurant parmi tant d'autres qui attendent d'être lus.
Par contre, en postant mon message, j'espérais, cher Hyarion, que tu pourrais nous éclairer plus avant sur cette trouvaille. Et tu ne nous déçois pas. Merci pour ces précisions, la dernière n'étant pas la moindre: d'un côté, je n'aurais pas imaginé que Jean Jaurès avait lu la Somme ; de l'autre, je ne suis pas étonné que son talent d'orateur était déjà manifeste dans ses années d'enseignement.
S.
Hors ligne
#97 15-05-2020 00:20
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Eh bien, je suis scotché !! :)
C'est peu dire que je vous suis très reconnaissant, à l'un et à l'autre, pour ces textes édifiants, et à Benjamin en plus pour sa contextualisation agréable et très utile (et ce bel exemple, en passant, du dialogue qui était possible, à l'époque, entre ces intelligences hors normes). Les points de contacts avec Tolkien et saint Thomas, sans être évidemment complets (ces derniers ne s'accorderont pas avec la rupture métaphysique kantienne), sont remarquables ! Même si ce n'est pas une surprise totale, je ne pensais pas trouver chez Jaurès une plaidoirie d'une telle qualité en faveur de la liberté de qualité (pour reprendre la terminologie de Pinckærs) et contre la liberté d'indifférence.
À noter que la suite que j'ai prévue me donnera probablement l'occasion de revenir à une autre différence, celle qui survient (du fait de la rupture métaphysique évoquée à l'instant) dans la compréhension de nature : nature comme dynamique d'accomplissement d'un côté, nature comme ensemble de déterminismes faisant obstacle à l'accomplissement de l'autre (cf. dernière citation donnée par Sosryko). En attendant, on peut déjà dire que Tolkien l'a justement thématisée, en opposant d'un côté la nature qui relève d'Arda Immarrie et la nature qui relève d'Arda Marrie.
Vraiment, bravo à tous les deux.
Hors ligne
#98 15-05-2020 00:29
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
La liberté à l'égard du Mal (1/3) : existence et nature du Mal
Et du Mal on ne sait / qu'une chose, une seule, et terrifiante : il est.
« Mythopoeia », FAT, p.309
Tolkien développera tout de même ce que peut vouloir dire ce qu'« il est ».
Pour résumer, les Eldar et les Valar comprennent le Mal par rapport au Bien : le Mal est pour eux une altération du Bien. Et il sera défini en proportion du Bien. Lorsque le Bien est envisagé d'après la loi éternelle (perspective majoritairement valienne), à savoir ce qui est « en paix, en accord (avec Eru) » (HoMe XI, p.399), la référence est la Volonté ou le Dessein d'Eru et le Mal consiste à refuser la dépendance qui en découle. Cela nous renvoie à notre premier excursus sur le rapport entre la liberté et la puissance : l'entêtement de Melkor introduira dans la Musique, non pas une autre musique, un autre « possible », qui serait un autre « Bien », mais « des altérations » (Lettres, n°212 p.40), qui ne seront elles-mêmes, en fin de compte, « qu'une part de l'ensemble, tributaires de [la] gloire [d'Ilúvatar] » (Ainulindalë). Lorsque le Bien est envisagé d'après la loi naturelle (perspective majoritairement elfique), il sera défini comme « ce qui est fidèle à sa nature et à sa fonction (true to its nature & function) » (PE n°17 p.162). La référence est ici la nature, entendue au sens de cause finalisée, orientée, par et vers le Bien, et le Mal se définit comme ce qui est contre-nature. Ce qui nous renvoie à notre deuxième excursus sur le rapport entre la liberté et la nature : le mal réside dans ce qui est « anormal et contre-nature (unnatural) », c'est-à-dire ce qui ne respecte pas l'ordre idéal de la Création : « la vraie nature (the true nature) » (HoMe X, pp.314,315,317) des Incarnés, leur « être véritable (right being) et entièreté (its fullness) » (p.317), leur « nature véritable (right nature) » (p.218) et « originelle » (p.304), etc. etc.
Le Mal est donc une altération du Bien, comme saint Augustin pouvait dire que le Mal est « la privation du bien, privation dont le dernier terme est le néant » (Confessions, III, VII, 12), Néant qui est « l'objet ultime » de Morgoth (HoMe X, p.396). À nouveau, la mythopoésie tolkienienne s'enfile comme un gant dans la théologie de l'Aquinate, pour qui « du fait que toute nature désire son être et sa perfection, il résulte que l’être et la perfection de toute nature a raison de bien » et « il est donc impossible que le mal signifie un certain être, ou une certaine nature de forme » mais bien « une certaine absence de bien [:] [celle qui] est une privation [et qui, comme telle, est] appelée un mal : telle la privation de la vue, qu’on nomme cécité » (ST Ia.48.1-3). Il s'ensuite que le Mal a besoin du Bien pour exister, alors que l'inverse n'est pas vrai. Il s'ensuit également que le Mal altère sa propre base. Aussi Theoden peut-il rappeler que « le mal ruine souvent le mal » (SdA, III.11). (*)
Jonathan McIntosh a relevé, comme d'autres, que les nombreuses « oppositions » tolkieniennes entre bons et mauvais (Manwë / Melkor, Gandalf / Saruman, Elfes / Orques, etc.) atteignent « une symétrie presque parfaite au sein de laquelle Tolkien contrebalance chaque être bon avec sa forme mauvaise correspondante » (The Flame Imperishable, p.216, cf. « Le seuil et le centre », dans Pour la gloire de ce monde, p.94 en particulier avec la figure de « la maison de Tom »). Mais cette symétrie, « bien loin de suggérer une sorte de dualisme manichéen et d'équipotence entre le bien et le mal, nous rappelle au contraire que le mal est tributaire, même dans son extraordinaire variété et subtilité, de l'authentique variété et subtilité dont dispose la création, en vertu de sa participation à l'infinie variété du Créateur » (ibid., référence faite ici par l'auteur à Lettres, n°153 p.269). Cette symétrie, nous avons vu que Tolkien lui-même l'énonce : « l'histoire est bâtie en termes d'oppositions, entre le bon côté et le mauvais côté : la beauté et la laideur sans pitié, la royauté et la tyrannie, la liberté mesurée fondée sur l'assentiment (moderated freedom with consent) et la compulsion qui n'a plus aucun autre objet, depuis longtemps, que le seul pouvoir, etc. » (Lettres, n°144 p.255, trad. modifiée). Et surtout, il l'énonce de façon « thomiste » si je puis dire : la laideur comme déformation du bien, la tyrannie comme déformation de la royauté, la compulsion comme déformation de la liberté. (**)
Si l'on en revient maintenant aux deux façons des Eldar et des Valar de définir la référence du Bien, et donc le Mal. Celles-ci sont équivalentes et se répondent (comme nos deux excursus) : ce qui est naturel manifeste ce qui est éternel. Les Eldar et Valar rassemblent alors souvent ces deux références au Bien en une seule, éternelle et naturelle à la fois, dans un syntagme bien identifié : Arda Immarrie. Arda Immarrie désigne ainsi le monde « dans des conditions idéales, libres du mal » (VT n°39 p.23), « le monde tel qu’il aurait été si le Mal n’était jamais apparu » (PE n°17 p.178), « la source dont procèdent toutes les idées d’ordre et de perfection » (HoMe X, p.405), c'est-à-dire la nature dans son intégrité et ses fonctions originelles, ordonnées au Créateur. C'est ainsi que le Mal se verra défini par tout ce qui s'écarte d'Arda Immarrie, et il sera sinon résumé en tout cas originé dans la thématique du Marrissement d'Arda :
Il avait marri l’ensemble d’Arda (et en fait probablement bien d’autres parties d’Eä). Melkor n’était pas seulement un Mal localisé sur Terre, non plus qu’un ange gardien de la Terre ayant mal tourné : il était l’Esprit du Mal, qui avait surgi avant même la création d’Eä. Sa tentative pour dominer la structure d’Eä, et d’Arda en particulier, et altérer les desseins d’Eru (qui gouvernait toutes les interventions des Valar fidèles), avait introduit le mal, ou une tendance à l’aberration par rapport au dessein originel, dans toute la matière physique d’Arda.
HoMe X, p.334
La malice du Marrisseur à l’œuvre dans le monde sépare la réalité d’Arda Immarrie (celle des conditions idéales, libres du mal) de celle d’Arda Marrie (celle dont les Enfants d’Eru font l’expérience). Le Marrissement d'Arda, cette « inclination [de toutes choses] au mal et à la perversion de leurs justes formes et voies » (HoMe X, p.255), est très exactement un dé-voiement : ce qui détourne l’existence de son « cours naturel » (cf. pp.217,232,255 ; voir le deuxième excursus supra, et « Estel Eruhínion » § I.1.a « détourner toute chose de son cours naturel »).
Ainsi, le Mal apparaît bien comme non substantiel en lui-même. Si le Bien réside dans l'inclination naturelle des êtres à « l’ordre et la perfection » (p.405), le Mal est un défaut, une défaillance relative à l’orientation naturelle de « ce monde [qui] a des fondations qui sont bonnes, et [qui] tend par nature au bien » (p.379). L’Anneau de Sauron manifeste cette essence du Mal, lui qui détourne son porteur de son cours naturel — de « sa nature et fonction » disent les Eldar (PE n°17 p.162), de « son devoir et son dû » dira Sam (SdA, VI.1) — au point de le faire, littéralement, s’évanouir du monde des vivants.
Enfin, le Marrissement d'Arda concerne essentiellement la matière :
C’est pourquoi ceux dont l’existence commençait en Arda, et dont la nature, en plus, consistait en l’union d’un esprit et d’un corps, tirant la nourriture du dernier d’Arda Marrie, devaient à jamais être sujets, dans une certaine mesure, à la peine, et à faire ou souffrir des choses anormales […]
[...] la blessure jadis infligée par Melkor à la substance d’Arda était telle que tous ceux qui étaient incarnés […] devaient à jamais être sujets à la peine, et à faire ou souffrir des choses anormales en Arda Immarrie.
Sa tentative pour dominer la structure d’Eä, et d’Arda en particulier, et altérer les desseins d’Eru (qui gouvernait toutes les interventions des Valar fidèles), avait introduit le mal, ou une tendance à l’aberration par rapport au dessein originel, dans toute la matière physique d’Arda.
HoMe X, pp.255,258-259,334
Cette insistance achève de relier la mythopoésie tolkienienne à la doctrine de l'Aquinate. Pour ce dernier, « le mal, en effet, est le défaut d’un bien qu’un être est naturellement apte à avoir, et doit avoir ». Mais comment le Mal, qui n'est pas substantiel, peut-il causer quoi que ce soit en général, et en particulier à un être la privation de sa disposition naturelle, « être cause ne [pouvant] être que le fait d’un bien ; car rien ne peut être cause sinon en tant qu’il est de l’être, et tout être, en tant que tel, est un bien » ? En fait, « le bien est cause du mal à la manière d’une cause matérielle, car on a montré que le bien est le sujet du mal. Quant à la cause formelle, le mal n’en a pas, car il est plutôt une privation de forme. Il en est de même de la cause finale ; car le mal, loin d’avoir une fin, est bien plutôt la privation de l’ordination à la fin requise » (ST Ia.49.1). (***)
__________________________________________
(*) Sur la nature du Mal :
Dans une opposition, un terme est connu par l’autre, comme les ténèbres par la lumière. Pour savoir ce que c’est que le mal, il faut donc utiliser la notion de bien. Or, nous avons établi plus haute que le bien est tout ce qui est désirable. Ainsi, du fait que toute nature désire son être et sa perfection, il résulte que l’être et la perfection de toute nature a raison de bien. Il est donc impossible que le mal signifie un certain être, ou une certaine nature de forme. Le terme de mal désigne donc une certaine absence de bien. Voilà pourquoi l’on dit du mal qu’il n’est « ni un existant, ni un bien » ; car l’être, comme tel, étant un bien, on ne peut nier l’un sans l’autre.
Somme Théologique, Ia.48.1
S. Augustin écrit : « Le mal n’existe que dans le bien. » [...] Le mal implique l’absence de bien [mais] toute absence de bien ne s’appelle pas un mal. L’absence de bien peut en effet être prise soit comme négation pure, soit comme privation. Et l’absence de bien prise par manière de négation n’a pas raison de mal, sans quoi les choses qui n’existent d’aucune manière seraient des maux, et toute chose serait mauvaise du seul fait qu’elle n’a pas le bien d’une autre. Ainsi l’homme serait mauvais pour n’avoir pas l’agilité de la chèvre ou la force du lion. C’est lorsqu’elle est une privation que l’absence est appelée un mal : telle la privation de la vue, qu’on nomme cécité.
Somme Théologique, Ia.48.3
(**) Sur l'apparente symétrie entre le Bien et le Mal, non pas signe de dualisme manichéen mais reflet de la variété de la Création :
Selon S. Augustin « de tout ce qui constitue l’univers, il résulte une beauté admirable, et dans cet ensemble, ce qu’on appelle le mal, bien ordonné et mis à sa place, fait ressortir l’éclat du bien. »
Comme on l’a dit précédemment, les parties de l’univers sont hiérarchisées de telle sorte que l’une agisse sur l’autre, qu’elle soit sa fin et lui serve de modèle. Or, nous venons de montrer qu’il ne peut en être ainsi du mal, si ce n’est en raison du bien qui lui est conjoint. Le mal ne contribue donc pas à la perfection de l’univers, et il ne fait point partie de l’ordre universel, si ce n’est accidentellement, en raison du bien conjoint.
Comme nous l’avons dit à [l'instant], la perfection de l’univers requiert qu’il y ait inégalité entre les créatures, afin que tous les degrés de bonté s’y trouvent réalisés. Or, un premier degré de bonté, c’est qu’un être soit tellement bon qu’il ne puisse jamais défaillir. Un autre, c’est qu’il soit bon, mais puisse faillir au bien. Et ces degrés se rencontrent aussi dans l’être lui-même ; car il y a certaines choses qui ne peuvent perdre l’être, comme les réalités incorporelles ; et d’autres peuvent le perdre, comme les réalités corporelles. Donc, de même que la perfection de l’univers requiert qu’il n’y ait pas seulement des réalités incorporelles, mais aussi des réalités corporelles ; de même la perfection de l’univers exige que certains êtres puissent défaillir à l’égard du bien ; d’où il suit que parfois ils défaillent. Or, la nature du mal consiste précisément en ce qu’un être défaille à l’égard du bien. D’où il est évident que, dans les choses, le mal se rencontre au même titre que la corruption, car la corruption elle-même est une sorte de mal.
Somme Théologique, Ia.48.1-2
(***) Sur la cause du Mal :
Le mal, en effet, est le défaut d’un bien qu’un être est naturellement apte à avoir, et doit avoir. Or, un être ne peut être privé de la disposition due à la nature que si une cause lui soustrait cette disposition. [...] Mais être cause ne peut être que le fait d’un bien ; car rien ne peut être cause sinon en tant qu’il est de l’être, et tout être, en tant que tel, est un bien. [...] Ce qui précède prouve que le bien est cause du mal à la manière d’une cause matérielle, car on a montré que le bien est le sujet du mal. Quant à la cause formelle, le mal n’en a pas, car il est plutôt une privation de forme. Il en est de même de la cause finale ; car le mal, loin d’avoir une fin, est bien plutôt la privation de l’ordination à la fin requise [...]. Si le mal a une cause efficiente, c’est une cause qui ne le produit pas directement, mais par accident. [...] Dans l’action, le mal est causé par le défaut de l’un des principes de l’action [...]. Dans une chose, au contraire, le mal a pour cause parfois la puissance de l’agent (non pas toutefois dans l’effet propre de cet agent), et parfois le défaut de l’agent ou [...] une mauvaise disposition de la matière.
Somme Théologique, Ia.49.1
L’effet de la cause seconde défaillante se ramène à la cause première non défaillante pour tout ce qu’il a d’entité et de perfection, mais non pour ce qu’il a de déficient. Ainsi tout ce qu’il y a de mouvement dans la jambe qui boite est causé par sa puissance motrice ; mais ce qu’il y a de dévié dans ce mouvement n’est pas causé par cette puissance motrice, il a pour cause la difformité de la jambe. De même, tout ce qu’il y a d’être et d’action dans une action mauvaise, remonte à Dieu comme à sa cause ; mais ce qu’il y a là de défaillant n’est pas causé par Dieu ; c’est l’effet de la cause seconde qui défaille.
Somme Théologique, Ia.49.2
Hors ligne
#99 16-05-2020 14:38
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Je n'avais pas encore tout relu de Jonathan McIntosh l'autre jour. Peu après avoir posté, je suis tombé sur ce passage, où l'auteur résume le point de vue de Jacques Maritain en des termes tolkieniens :
En bref, l'âme ou la volonté (the soul or will), est comme la vitre d'une fenêtre ou, pour employer une autre image, commune à la fois à Tolkien et Maritain [...], un « prisme » : la lumière qu'il reçoit est la puissance créative, activatrice, « qui meut » (moving), de Dieu ; la lumière qu'il admet ou qui brille à travers la fenêtre le fait en raison des actions de l'âme. La lumière qu'il admet devrait-elle être brisée (shattered) (à la différence, disons, de son être merveilleusement réfracté à travers l'acte subcréateur), la faute ne serait pas celle de la lumière qu'il reçoit, mais celle de l'âme ou de la volonté fendillée ou brisée (cracked or shattered) qui la reçoit.
The Flame Imperishable, p.222
Qui ne manquent pas de renvoyer :
- à ce passage précis de la lettre que nous retrouvons régulièrement : « mais je puis bien sûr être dans l'erreur (sur certains points ou sur tous) : mes vérités peuvent ne pas être vraies, ou peuvent être déformées ; et le miroir que j'ai fabriqué peut être terne et fendillé (dim and cracked) » (Lettres, n°153 p.277) ;
- aux « Couleurs du monde » de Sosryko que nous retrouvons avec la même régularité ;
- et surtout à l'ensemble de « Mythopoeia », qui s'achève par l'espérance de ce que « l'œil captera peut-être au Paradis / [...] un vrai reflet du Vrai dans le miroir » (FAT, pp.312-313).
D'ailleurs, ayant commencé par une citation du poème, j'aurais pu terminer mon précédent post par ce passage de la finale qui le résume :
Le Mal, il [l'œil] ne le verra pas qui touche
non au tableau de Dieu mais à l'œil qui louche,
non à la source mais au choix mauvais
non pas au son mais au timbre muet.
« Mythopoeia », FAT, p.313
Mais il est temps de reprendre notre chemin, et de gravir bientôt les derniers escarpements de notre colline ... :)
Hors ligne
#100 16-05-2020 14:43
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
La liberté à l'égard du Mal (2/3) : le mal diminue la liberté
Si aucune créature incarnée ne peut entièrement échapper au pouvoir du Mal, aucune créature, même la plus misérable, ne peut non plus lui être entièrement soumis : « Même Gollum n'était pas encore complètement perdu. [...] Il y avait encore une parcelle de son esprit qui lui appartenait, où la lumière filtrait, comme une fente dans l'obscurité » (SdA, I.2).
En effet, dans la perspective tolkienienne, ou thomiste, « le mal ne peut détruire complètement le bien » (ST Ia.48.4). Ce serait sinon pouvoir vraiment s'opposer au Créateur : le bien étant dans l'être même, le subcréateur n'ayant pouvoir que de subcréation, il ne peut l'annihiler (même si, on l'a vu, tel est l'objet ultime de Melkor : disons que telle est l'asymptote à laquelle il tend sans jamais pouvoir l'atteindre). L'aptitude de la créature à être, et donc son aptitude au bien, est donc « diminuée par le mal, sans être complètement détruite » (ibid.). La Somme Théologique de saint Thomas est remarquablement évocatrice de la thématique tolkienienne, quand il énonce que « cette baisse de capacité s’explique par le processus inverse de son développement. La capacité se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte : plus elles sont multipliées dans le sujet, plus celui-ci est habilité à recevoir la perfection et la forme. En sens inverse, la capacité diminue par les dispositions contraires : plus elles sont nombreuses dans la matière, et intenses, plus elles atténuent la disposition à l’acte » (ibid.). On pense à nouveau au Marrissement, lié à la dissémination du pouvoir de Morgoth dans la matière, de telle sorte que celle-ci soit de moins en moins bien disposée à suivre le cours naturel des êtres. J'avais moi-même essayé de dire la même chose lorsque j'avais travaillé la thématique. Le mieux auquel j'étais parvenu fut d'écrire que « l’on peut ainsi, du point de vue métaphysique, comprendre le Marrissement comme l’incapacité fondamentale pour les essences et pour les âmes à informer correctement les choses et les corps incarnés » (« Estel Eruhínion » § I.1.b). Mais, à l'époque, je n'avais rien lu de saint Thomas ; je n'en étais peut-être pas capable de toute façon. Je me souviens qu'il y a 10 ou 20 ans, c'était du chinois. Aujourd'hui, c'est seulement ardu. Le progrès fait depuis me fait malheureusement craindre de devenir illisible à mon tour ;). Pas grave : vous pouvez passer la métaphysique ; nous allons voir que l'histoire elle-même (du Silmarillion, du SdA) suffit à expliciter les choses. (*)
Ainsi la capacité au bien diminue avec les dispositions contraires. Et, en effet, lorsque dans le Conte d'Arda on s'habitue au Mal, celui-ci devient de plus en plus fort, au point de devenir quasi irrésistible — et l'on retrouve la problématique du libre arbitre :
Mais cette chose lui dévorait l’esprit, évidemment, et ce supplice était devenu quasi insoutenable. [...] Il était absolument misérable. Il haïssait l'obscurité, et la lumière plus encore : il haïssait tout, et l'anneau plus que toute autre chose. [...] Il le haïssait et il l’aimait, comme il se haïssait et s'aimait lui-même. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Il ne lui restait plus aucune volonté à cet égard.
SdA, I.2
La rançon de la « liberté à l'égard du Bien » que l'Anneau Unique dispense est un esclavage à l'égard du Mal.
En cela, l'Anneau est paradigmatique : le Mal, en écartant la créature de son cours naturel, diminue d'autant sa liberté — le corrélat attendu du fait que l'authentique liberté du subcréateur soit enracinée dans sa nature (immarrie) de créature.
On retrouve ici ce que Vincent et Sosryko avaient depuis longtemps relevé. Le premier écrivait ainsi que « le texte [du SdA], ainsi que [des] lettres de Tolkien, insist[ent] sur la liberté de choix, qui différencie les alliés de leurs adversaires. Si Le Seigneur des Anneaux réserve une place essentielle à la question des “intentions” et du choix, c'est pour montrer que certains personnages renoncent à ce dernier par désir du pouvoir » (Rivages, p.214). Le second que le Silmarillion nous montre des protagonistes qui vont « trop loin », s’endurcissant qui dans le désir de puissance, qui dans le désir de vengeance, et sont incapables de revenir en arrière : Melkor bien sûr, puis Sauron, et aussi ... Fëanor et ses Fils. Cela évoque la Bible, où la liberté de l’homme (sa capacité à choisir le bien : Dieu) est préservée par la patience et la miséricorde de Dieu, mais où le libre arbitre s’amenuise si l’homme se complaît dans le rejet de Dieu, s’il « endurcit son cœur », se plaçant dans une condition où sa capacité même à s’engager disparaît (Le Silmarillion : Mythologie ou Chrétienté ?).
Où l'on retrouve le débat entre liberté « d'accomplissement » (ou liberté de qualité) et liberté « à l'égard du bien » (ou liberté d'indifférence) : si pouvoir choisir le Mal est une preuve de l'existence du libre arbitre, choisir effectivement le Mal est une preuve de sa dégradation. Ainsi du refus des fëar de répondre à leur convocation en Mandos : « ils pouvaient refuser la convocation (summons), mais cela aurait impliqué qu'ils fussent d'une certaine manière viciés (tainted), ou bien ils ne refuseraient pas l'autorité de Mandos » (p.339).
Les exemples du Légendaire sont récurrents, qui montrent la corrélation directe entre le Mal et l'amenuisement de la liberté qui s'ensuit. Et cela, que le Mal soit choisi ou subi.
Si l'on accepte quelque approximation (car le Mal est rarement uniquement choisi ou uniquement subi), l'on peut donner ici un exemple de chaque.
Pour un exemple de mal essentiellement choisi, nous pouvons poursuivre avec le destin tragique de Fëanor, lorsqu'il réfléchit à la requête des Valar d'offrir ses Silmarils à Yavanna pour qu'elle rende la vie aux Arbres :
Tout était silencieux, tandis que Fëanor ruminait dans l'obscurité (brooded in the dark). Et il lui semblait être encerclé par des ennemis, et les paroles de Melkor lui revinrent, disant que les Silmarils ne seraient pas en sécurité si les Valar devaient les obtenir. « Et n'est-il pas Vala aussi bien qu'eux, songeait-il, pour comprendre leurs cœurs ? En vérité, un voleur confondra les voleurs ». Alors il s'écria : « Nenni. Je n'agirai point ainsi de mon plein gré (of free will). Mais si les Valar me contraignent, alors, en vérité, je saurai que Melkor leur est apparenté ».
HoMe X, p.107
À ce moment-là, son cœur est déjà assombri, et son libre arbitre a déjà diminué. Car cette chose qu'il ne veut pas faire, c'est une chose qu'il ne peut plus faire librement, de lui-même.
Un exemple de mal essentiellement subi est, bien sûr, celui de Frodo. À la fin du Livre II, au sommet de l'Amon Hen, il était encore « libre de choisir, avec un seul instant pour le faire », entre l'Œil et la Voix (SdA, II.10). Mais à la fin de la Quête, écrasé par une puissance qui le dépasse, il ne le peut plus :
Je suis venu, dit-il. Mais je ne choisis plus (I do not choose now) de faire ce pour quoi je suis venu. Je n'accomplirai pas cet acte (I will not do this deed). L'Anneau est à moi !
SdA, VI.3
Frodo aurait encore mieux dit s'il s'était écrié qu'il appartenait à l'Anneau. En tout cas, la ressemblance avec Fëanor est frappante : qu'il s'agisse des plus grands ou des plus humbles, l'ombre du Mal, lorsqu'elle s'étend, éclipse la liberté.
Enfin, les cas les plus emblématiques des personnes les plus corrompues nous montrent que la perte de liberté va de pair avec la perte d'être, de réalité, de substance. On le voit avec Gollum. On le voit avec Saruman, Sauron, et surtout avec les Spectres de l'Anneau. C'est on ne peut plus logique si la liberté prend sa source dans la nature des créatures. En ce sens, pour chacun des Incarnés, l'écartement de sa nature immarrie entraîne la dégradation de son être qui entraîne la dégradation de sa liberté.
Et c'est ici que l'on retrouve la pierre de touche tolkienienne : le rapport à la Mort. La rébellion des Númenóréens (« la Chute de Númenor, la deuxième Chute de l’Homme », Lettres, n°131 p.222, c'est-à-dire la chute de ceux-là mêmes qui avaient reçu pour grâce de recouvrer une nature proche de leur condition originelle) s'enracina dans le refus de la mortalité c'est-à-dire de leur nature : la convoitise « d’une immortalité (dans les limites du monde) qui va contre leur loi, le destin ou don particulier (the special doom or gif) d’Ilúvatar (Dieu) et que leur nature en fait ne peut tolérer » (ibid., p.223 ; on voit à nouveau comment loi, destin, nature et don d'Eru sont autant de perspectives différentes de la même réalité). Il est utile de souligner ici la note de bas de page qui suit :
On considère (comme cela réapparaît clairement plus tard dans le cas des Hobbits qui possèdent un moment l’Anneau) que chaque « Espèce » a une durée de vie naturelle, en conformité avec sa nature biologique et spirituelle. Elle ne peut pas vraiment être augmentée qualitativement ou quantitativement ; si bien qu’en prolonger la durée revient à étirer toujours plus un fil de fer ou à « étaler du beurre en couche toujours plus fine » : cela devient un tourment intolérable.
Lettres, n°131 p.223
La « libération » recherchée par rapport à sa nature, à l'ordre de la Création, est un leurre. Bilbo l'exprimera très bien. D'autres en donneront de sinistres exemples : Gollum, bien sûr, mais aussi et surtout les funestes Spectres de l'Anneau : ceux-ci ont effectivement échappé à leur nature et à la Mort ... au prix de leur existence entière (ils sont des spectres) et de leur liberté entière (ils sont les esclaves de l'Anneau).
L'on retrouve ici le thème de la Machine qui, pour Tolkien, rend l’homme « moins incorporé à la vie », « moins Réel » (Faërie, p.239). Ainsi « contraint d’habiter une dimension excentrée du monde véritable et qui le laisse dans un état de “désunion” permanent et le met dans la situation de ne pouvoir exister “qu’à la surface des choses” » (Bertrand Alliot), la Machine provoque « rien moins que la séparation de l’homme d’avec le “monde réel”. La Machine est diabolique en ce sens qu’elle institue, provoque une telle division (le diable étant, selon l’étymologie, “celui qui divise”) » (Sosryko). Cette séparation, c'est, depuis l'origine du Mal, celle des Enfants d'Eru d’avec leur vraie nature (immarrie). Et l’Anneau Unique, procurant l'abstraction du temps (longévité sans fin) et de l'espace (invisibilité), constitue « la machine ultime » (Christopher Tolkien), celle qui opère la séparation ultime, la désincarnation des Mirröanwi (q. Incarnés, HoMe X, pp.316,350). On comprend alors pourquoi, dans la métaphysique tolkienienne, la Machine ne peut augmenter la liberté. C'est le contraire : la Machine, si elle nous sépare de notre être, de notre nature, nous fait perdre la source même de notre liberté : « Comparez la mort d'Aragorn avec ce qu'elle est pour un spectre de l'Anneau » (Lettres, n°208 p.377). (**)
__________________________________________
(*) Pour les références à saint Thomas :
Le mal ne peut détruire complètement le bien. Pour s’en convaincre, il faut observer qu’il y a trois sortes de bien. La première est totalement détruite par le mal ; c’est le bien opposé au mal : ainsi la lumière est totalement détruite par les ténèbres, et la vue par la cécité. La deuxième n’est ni totalement détruite par le mal, ni même affaiblie par lui : ainsi, du fait des ténèbres, rien de la substance de l’air n’est diminué. Enfin, la troisième sorte de bien est diminuée par le mal, sans être complètement détruite : c’est l’aptitude du sujet à son acte.
Or, cette diminution du bien ne doit pas se comprendre par manière de soustraction, comme pour les quantités, mais par affaiblissement ou déclin, comme dans les qualités et les formes. Cette baisse de capacité s’explique par le processus inverse de son développement. La capacité se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte : plus elles sont multipliées dans le sujet, plus celui-ci est habilité à recevoir la perfection et la forme. En sens inverse, la capacité diminue par les dispositions contraires : plus elles sont nombreuses dans la matière, et intenses, plus elles atténuent la disposition à l’acte.
Donc, si les dispositions contraires ne peuvent se multiplier et s’intensifier indéfiniment, mais seulement jusqu’à un certain point, l’aptitude susdite ne sera pas non plus diminuée ou affaiblie à l’infini, et c’est ce que l’on voit dans les qualités actives et passives des éléments. En effet, le froid et l’humidité, qui diminuent ou affaiblissent l’aptitude du combustible à s’enflammer, ne peuvent s’accroître indéfiniment. Si au contraire les dispositions adverses peuvent être indéfiniment multipliées, l’aptitude en question peut être elle-même indéfiniment diminuée ou affaiblie ; mais elle ne serait jamais totalement détruite ; car elle demeure dans sa racine, qui est la substance du sujet. De même, si l’on interposait indéfiniment des corps opaques entre le soleil et l’air, celui-ci verra indéfiniment diminuer sa capacité de recevoir la lumière ; mais il ne la perdrait nullement, puisqu’il est translucide par nature. De même on pourrait ajouter indéfiniment péchés sur péchés, et ainsi affaiblir de plus en plus l’aptitude de l’âme à la grâce ; car les péchés sont comme des obstacles interposés entre nous et Dieu, selon la parole d’Isaïe (59, 2) : « Nos iniquités ont mis une séparation entre nous et Dieu. » Cependant, ils ne détruisent pas totalement cette aptitude, car elle tient à la nature de l’âme.
Somme Théologique, Ia.48.4
(**) Voir à nouveau : « Un secours comme son vis-à-vis » in Pour la gloire de ce monde.
C'est encore la thèse du philosophe Olivier Rey : « l'homme augmenté » de l'idéologie transhumaniste est en fait un « homme diminué » (Leurre et malheur du transhumanisme, 2018).
Hors ligne
#101 22-05-2020 20:17
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Avec du retard, merci Yyr pour cette double suite : )
Un exemple de mal à la fois choisi et subi, qui entrelace les thèmes de la mort, du pouvoir et de la Machine : la trajectoire et la fin de Denethor.
« […] Je ne cèderai pas ma place pour devenir le vieux chambellan d’un parvenu. […] Je ne m’inclinerai pas devant tel personnage, dernier d’une maison délabrée, dépouillée depuis bien longtemps de toute grandeur ou dignité. »
« Que souhaiteriez-vous, dit Gandalf, si votre volonté pouvait prévaloir ? »
« Je voudrais que les choses fussent comme elles ont été tous les jours de ma vie (I would have things as they were in all the days of my life), répondit Denethor, et du temps de mes ancêtres venus avant moi : régner sur cette Cite en paix, et laisser mon fauteuil à un fils qui me suivrait, et qui serait son propre maître (his own master), non l’élève d’un magicien. Mais si le sort (doom) me refuse cela, je préfère n’avoir rien (naught) : ni vie diminuée, ni amour divisé, ni honneur abaissé. »
« Je ne vois pas en quoi serait diminué l’amour ou l’honneur voué à un Intendant qui renoncerait fidèlement à sa charge, dit Gandalf. En tout cas, vous ne priverez pas votre fils de son choix tandis que sa mort reste incertaine. »
— SdA, V.7 = RR, Lauzon, p. 149-150.
Là encore, il s'agit d'une question de volonté :
« Eh bien ! s’écria Denethor. […] tu ne défieras pas ma volonté (my will) – décider de ma propre fin (to rule my own end).
[…]
Lors Denethor sauta sur la table et il s’y tint debout, drapé de flammes et de fumée ; et il prit le bâton de son intendance qui gisait à ses pieds et le brisa sur son genou. Ayant jeté les morceaux au feu, il se pencha et s’étendit sur la table, serrant le palantír a deux mains
contre sa poitrine. Et l’on dit que des lors, quiconque regarda dans cette Pierre, à moins d’avoir la volonté pour l’orienter vers d’autres desseins (a great strength of will to turn it to other purpose), n’y vit jamais que deux vieilles mains consumées par les flammes. »
— SdA, V.7, ibid., p. 150.
Mais la volonté de Denethor, loin d'être libre, coïncide avec celle de Morgoth : en brisant son bâton, il ne veut pas seulement manifester sa volonté d'être son propre maître jusque dans sa fin, mais aussi, me semble-t-il, s'assurer qu'il n'y aura aucun Intendant après lui, et donc saper les fondements d'une royauté qu'il rejette, car il renie l'autorité qu'elle suppose.
La triste image des mains crispées jusque dans la mort sur le palantír montre la facilité avec laquelle la Machine (qui n'est pas le palantír mais l'esprit de séduction attaché à la puissance privilégiée qu'il procure) impose une vision diminuée du réel à celui qui l'utilise.
Le problème de Denethor était moins celui de l'âge et de l'indépendance (celui d'« une vie diminuée ») que celui d'une volonté diminuée, celui de la liberté à l'égard du bien (l'amour qui aurait dû être partagé et non réduit à l'allégeance d'un fils qu'il n'appelle même plus par son nom), ce qui l'a conduit à devenir esclave des visions de Sauron.
S.
Hors ligne
#102 22-05-2020 23:53
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
C'est sûr que tu abuses, là ;).
Hé ho ! Tu ne rigoles pas un peu non en demandant pardon ? :) Je vous suis déjà très reconnaissant, à Elendil, Hyarion et toi, de me suivre sur des chemins longs et laborieux :).
Très bien vu, ce passage !
En effet : là encore (là toujours), tout un entrelacs de thèmes chers à Tolkien, qui se nouent autour de la volonté des protagonistes et de la liberté de cette volonté : une volonté plus ou moins diminuée, plus ou moins influencée, plus ou moins orgueilleuse, aussi. Or, c'est une volonté qui a besoin d'accepter de l'aide ...
... Une excellente transition (juste à l'heure, tu as eu chaud ! ;)) pour ce qui suit :
La liberté à l'égard du Mal (3/3) : le paradigme de la liberté
Nous avons vu que la liberté se déploie dans l'accomplissement de sa nature et donc dans la réalisation du Bien, tandis que le Mal entraîne la diminution de l'aptitude à cet accomplissement.
Il s'ensuit, et nous finirons là-dessus, que la liberté, pour être vraiment libre, doit être libre du Mal. La « liberté à l'égard du Mal » devient même un pléonasme : être libre, c'est être libre à l'égard du Mal.
À cette aune, rares sont ceux qui sont vraiment libres, même parmi les Valar. Manwë et Varda sont probablement les seuls à l'être entièrement. Manwë est ainsi le seul personnage du Légendaire dont il est dit, à plusieurs reprises, qu'il était « libre de tout mal (free of/from all evil) » (HoMe X, pp.93-94,273). Son nom seul suffit à comprendre pourquoi : « V[alarin] Mānawenūz “Celui qui est béni, (le plus) en accord avec Eru” (Blessed One, One (closest) in accord with Eru) » (HoMe XI, p.399). Je ne pense pas exagéré de lui associer Varda, en cela comme en toute chose, Varda qui porte encore « l'éclat d'Ilúvatar », elle que Melkor « haïssait et [...] craignait plus que toute autre créature d'Eru » (Valaquenta). Mais il est encore une autre exception, bien connue en ces lieux : celle du couple de la Vieille Forêt. On ne rencontre pas plus libre que « Maître Bombadil », comme l'appelle Sam. Il est en effet aussi libre qu'une créature peut l'être. Tolkien le décrit comme l'anti-modèle radical de l'Ennemi : il est celui qui a « fait “vœu de pauvreté” [et] renoncé au contrôle » (Lettres, n°144 p.255) et qui donc peut se rire du Maître Anneau : « l'Anneau n'a aucun pouvoir sur lui [;] il est son propre maître » (SdA, II.2). La créature la plus libre de la Terre du Milieu est la plus libre à l'égard du Mal, et (c'est le corollaire) la plus naturellement « en accord avec Eru » : il n'y a qu'à considérer sa connivence, j'allais presque écrire insolente, avec la « chance » — ce qui arrive occasionnellement chez les autres semble être pour lui « dans sa nature ». Mais tel est bien le cas : Tom fait tout simplement figure d'Homme Immarri. Notez que toute l'aventure des Hobbits dans la Vieille Forêt se résume à un détour et au recouvrement d'un chemin (les Hobbits sont détournés de leur chemin et remis dessus par Tom). Ou encore, si l'on relit le passage ad hoc, on voit que ce que Bombadil ordonne au Vieil Homme Saule, c'est ni plus ni moins que de reprendre son cours naturel, etc. Quand on sait en plus les traits communs entre le couple de la Vieille Forêt et le couple royal d'Ilmarin (cf. « Le seuil et le centre », Pour la gloire de ce monde, pp.90-91 ; voir aussi ici pour l'harmonie conjugale parfaite que partagent les deux couples), il est d'autant plus facile de les réunir encore dans leur exceptionnelle liberté. (*)
Une exception donc car, dans le Conte d'Arda, la liberté entière est l'exception. La règle, c'est la liberté partielle :
rien [...] ne peut éviter complètement l’Ombre qui s’étend sur Arda ou n’est entièrement immarri, de sorte à suivre sans entrave son cours naturel.
HoMe X, p.217
Cela vaut pour toute la Création. À commencer par les choses inanimées elles-mêmes, avec des différences entre les choses d'ailleurs, en fonction de l'intérêt porté par Melkor à chacune d'entre elles :
La totalité de la « Terre du Milieu » était l'Anneau de Morgoth [...] C'était cet élément-Morgoth dans la matière, en effet, qui constituait le prérequis pour une « magie » et d'autres maux tels que ceux auxquels Sauron se livrait ou avec lesquels il pratiquait. [...] Il était tout à fait possible, bien sûr, que certains « éléments » ou conditions de la matière aient attiré l'attention spéciale de Morgoth [...] Par exemple, tout l'or (en Terre du Milieu) semble avoir une tendance spécialement « mauvaise » — mais pas l'argent. L'eau est représentée comme étant presque entièrement libre de Morgoth (free of Morgoth). (Cela, bien entendu, ne voulait pas dire que tel mer, ruisseau, rivière, ou même récipient d'eau ne pouvait pas être empoisonné ou souillé — comme toutes les choses le pouvaient.)
HoMe X, pp.400-401
Cela vaut pour les êtres vivants, y compris et surtout pour les créatures rationnelles : « ceux qui avaient un corps, nourri par le hroa d’Arda, avaient une attirance plus ou moins grande envers Melkor : aucun d’entre eux n’étaient entièrement libres de lui (wholly free of him) dans leur forme incarnée, et leur corps avait une influence sur leur esprit » (p.400). Cf. au post précédent le lien entre le Mal et la matière, au sens thomiste, lorsque le Mal est compris, comme avec le Marrissement d'Arda, comme la disposition matériellement contraire à la nature. Notons que, là encore, ce qui vaut pour tous les Incarnés ne vaut pas pareillement pour tous les Incarnés :
Sa tentative pour dominer la structure d’Eä, et d’Arda en particulier, et altérer les desseins d’Eru (qui gouvernait toutes les interventions des Valar fidèles), avait introduit le mal, ou une tendance à l’aberration par rapport au dessein originel, dans toute la matière physique d’Arda. C'était sans aucun doute la raison pour laquelle il avait complètement réussi avec les Hommes, mais seulement en partie avec les Elfes (qui n'avaient pas « chuté » en tant que peuple, who remained as a people 'unfallen'). Son pouvoir s'exerçait sur la matière, et à travers elle. Mais par nature les fëar des Hommes maîtrisaient beaucoup moins bien leurs hröar que les Elfes. Les Elfes, individuellement, pouvaient éventuellement être séduits par une sorte de « melkorisme » mineur : le désir d'être leurs propres maîtres en Arda, et de conduire les choses à leur idée, ce qui pouvait en des cas extrêmes les mener à la rébellion contre la tutelle des Valar ; mais aucun d'entre eux n'était jamais entré au service de Melkor ni ne lui avait prêté allégeance, ni n'avait jamais nié l'existence et la suprématie absolue d'Eru. Des choses aussi terribles, à ce que pouvait en deviner Finrod, les Hommes (dans leur ensemble) devaient les avoir commises [...].
HoMe X, p.334
En effet, on comprendrait mal autrement pourquoi les forces mauvaises redoutent les Elfes et leurs ouvrages comme un vampire l'eau bénite. Précisément, c'est parce qu'ils demeurent en partie, plus que d'autres, dans la bénédiction. Les Elfes peuvent chuter, et ils l'ont fait, mais d'un mal qui n'était pas absolu, qui ne les coupaient pas complètement d'Eru : vouloir (pour être schématique) « préserver la Création malgré elle » n'est pas le même mal que la dominer, la réifier, voire la détruire (Jonathan McIntosh aborde aussi ce point de façon assez convaincante).
Et l'on retrouve dans les textes abordés plus haut plusieurs expressions qui font de la liberté « à l'égard du Mal » la liberté « fondamentale ». Pour Finrod, cette liberté-là conditionne rien moins que la capacité à aimer :
[...] vous aimez Arda [...] dans la mesure où vous êtes libres à l'égard de l'Ombre (free from the Shadow) [...].
HoMe X, p.315
Yavanna, lorsqu'elle se rallie dans le Namna à Ulmo et Manwë, termine en identifiant purement et simplement la liberté à l'égard du mal à la liberté tout court :
Mon seigneur Aulë se leurre [en] parlant de Finwë et Míriel comme étant libres de cœur et de pensée à l'égard de l'Ombre (free in heart and thought from the Shadow), comme si rien de ce qu'il leur advenait ne pouvait provenir de l'Ombre ou du Marrissement d'Arda. [...] Toute la Terre du Milieu est pervertie par le mal de Melkor, qui y a œuvré (wrought) aussi puissamment que n'importe lequel d'entre nous. C'est pourquoi aucun parmi ceux qui se sont éveillés en Terre du Milieu, et qui y ont résidé avant de venir jusqu'ici, ne sont venus entièrement libres (wholly free).
HoMe X, p.241
On observe alors (en fait, on l'a déjà observé mais, sages et patients, vous m'avez fait l'amitié de ne pas m'interrompre ;)) que l'on se retrouve finalement avec une « autre nature » que celle dont on avait parlé au début, celle qui est censée guider « naturellement » chacun vers son bien (Dieu). On se retrouve, d'une certaine façon (**), avec deux natures :
une nature « immarrie » (originelle, idéale, fondamentale)
une nature « marrie » (présente, faussée, éprouvée)
Une dichotomie particulièrement saillante dans l'Athrabeth qui va jusqu'à envisager une « modification » de la nature des Hommes.
Il s'ensuit, en Arda Marrie dans le Légendaire, en un monde déchu dans les Lettres, la nécessité à être sans cesse sorti des détours et remis dans son cours naturel, d'être reconduit vers le Bien. Les Incarnés sont naturellement libres (en Arda Immarrie) mais ce n'est plus tout à fait vrai en Arda Marrie où ils ont besoin d'être libérés ou, pour le dire autrement : leur liberté a elle-même besoin d'être libérée.
Le thème de la libération est omniprésent dans le Conte d'Arda. Qu'il s'agisse du lai de Leithian (« la délivrance »), des nombreuses occurrences de la « libération des Cercles du Monde », de l'Athrabeth qui pour ainsi dire ne parle que de cela, ou de la Quête de l'Anneau (à la fois ce qui se joue autour de l'Anneau et ce qui se joue à l'intérieur de l'âme des protagonistes de la Quête, tous, bien sûr, mais les choses sont particulièrement remarquables chez Frodo, Gollum, Saruman, Boromir, ou encore Denethor), la liberté est cet enjeu primordial, qui d'un côté semble promis à la ruine (notion fatidique du « destin » lorsque la nature du Monde est marrie), de l'autre est régulièrement rattrapée ou, plus exactement, sauvé. Régulièrement, et non pas systématiquement, c'est-à-dire là où les créatures acceptent de collaborer, à partir de leur liberté là où elle en est, à ce qui peut suppléer à ses déficiences.
D'où l'importance de l'obéissance et de la grâce, par ailleurs liés entre eux. Nous avions commencé à en parler ici (puis là, là, et encore là ;)). La description des « étapes » de la chute des Númenóréens est éloquente :
Ils chutent et perdent la grâce en trois phases. Premièrement, le consentement, l'obéissance libre et volontaire (free and willing), mais non toutefois en totale connaissance de cause (though without complete understanding). Puis pendant longtemps ils obéissent à contrecœur (they obey unwillingly), récriminant de plus en plus ouvertement. Enfin, ils se rebellent — et un fossé apparaît entre les hommes du Roi et les rebelles d'un côté, et la petite minorité des Fidèles persécutés de l'autre.
JRR Tolkien, Lettres, n°131 p.223
Obéir à contrecœur est, dans le cadre de la mythopoésie tolkienienne, un oxymore métaphysique, si je peux tenter l'expression. Dit encore autrement : les Númenóréens passent ici de l'obéissance au sens thomiste (l'obéissance à Dieu est obéissance à son propre bien) à l'obéissance au sens occamiste (l'obéissance à Dieu ou à autre chose est purement volontariste) ... et finissent par se rebeller purement et simplement. La véritable obéissance spirituelle est ouverture à la grâce, c'est-à-dire au don gratuit de Dieu (en quenya grâce = eruanna, lit. « don de Dieu »). Nous retrouvons maintenant certains commentaires que j'avais réunis au début de ce fuseau : dans le Légendaire, le destin personnel ou « malédiction » peut être couvert par le pardon, c'est une définition de la Grâce (« c'est elle que j'opposerai au Destin plutôt que la Providence » disait Sosryko ; et c'est très exactement ce que fait Tolkien dans ses Lettres lorsqu'il évoque l'élection de Frodo et l'eucatastrophe du Mont Destin) ; en résonance avec la théologie augustinienne, le libre arbitre de l’Homme a besoin de la grâce de Dieu pour choisir le Bien, écrivait Houghton, qui rappelait que l’achèvement de la quête de Frodo a été décrite par Tolkien comme une méditation des « dernières prières, mystérieuses, du “Notre Père” : “Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal” » (Lettres, n°191 p.356).
Notons que la délivrance relevant de la grâce, elle n'a donc rien d'automatique non plus ; elle peut très bien être rejetée et « le peuple des hommes dans son ensemble (tout comme chaque individu) est libre de ne pas s'élever de nouveau mais d'aller à sa perdition et de poursuivre la Chute jusqu'à son terme ultime (tout comme chaque individu le peut singulariter) » (Lettres, n°96 p.162).
Enfin, on peut maintenant revenir sur ce que Tolkien disait du modèle de Bombadil, parfaitement libre mais qui ne pourrait toutefois survivre seul. Gandalf, en fait, l'explique dans ce passage du Conseil d'Elrond que je redonne ici en le complétant :
« Tout de même, ne serait-il pas possible de lui envoyer des messages et d'obtenir son aide ? demanda Erestor. Il semble qu'il ait un pouvoir capable d'agir même sur l'Anneau. »
« Non, ce n'est pas ainsi que je l'exprimerais, dit Gandalf. Dites plutôt que l'Anneau n'a aucun pouvoir sur lui. Il est son propre maître. Mais il ne peut transformer l'Anneau lui-même, ni défaire le pouvoir que l'Anneau exerce sur les autres. [...] »
SdA, II.2
Tom Bombadil, quoique libre lui-même à l'égard du mal, sait qu'il doit, pour ce qui ne dépend pas de lui, attendre le jour « où viendra la guérison du monde » (SdA, I.8).
Yyr
__________________________________________
(*) Tom Bombadil achève (ou parachève) le lien nécessaire entre la liberté et le Bien. Le fait qu'il apparaisse spécialement libre est une preuve de plus de son attachement et non de son indépendance à l'égard Bien. À cet égard, il me semble qu'une lecture agnostique de Tom Bombadil n'a pu être envisagée que d'après les catégories nominalistes dont nous avons parlé (où être libre c'est être libre à l'égard du bien et du mal).
(**) « D'une certaine façon », car la manière de concevoir cette dualité fera théologiquement débat — cela pourra toujours faire l'objet d'un dernier excursus s'il me reste quelques forces une fois arrivé au sommet ;).
Hors ligne
#103 23-05-2020 00:23
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Voilà, j'en ai terminé avec les quatre points qu'il m'avait paru important de développer. Cela ne prétend pas clore la discussion, évidemment. Mais cela va me permettre déjà de faire une pause — ce travail m'a fatigué ;).
Mais la joie est à la mesure de la fatigue ... Tiens, je pense spontanément à Tintin au début de Tintin au Tibet de retour de sa randonnée, fourbu mais heureux comme un roi. D'ailleurs, j'imagine bien Cédric, Isengar et les autres m'attendre (ou plutôt nous attendre, car vous êtes quand même trois téméraires à m'avoir suivi ;)) à la terrasse de l'hôtel, en train de siroter une bière ;)).
En attendant, je redonne un dernier extrait du Seigneur des Anneaux qui, lui aussi, résume et rassemble bien des choses (tout en faisant écho à cet autre très beau passage où Merry et les amis de Frodo lui témoignaient de ce qu'ils pensaient être l'amitié et la confiance) :
Bilbo s'empourpra, et une lueur de colère parut dans ses yeux. Son visage bienveillant se durcit. « Pourquoi pas ? s'écria-t-il. Et en quoi ça vous regarde, hein, de savoir ce que je fais de mes propres affaires ? Il est à moi. Je l’ai trouvé. Il est venu à moi. »
« Oui, oui, dit Gandalf. Mais il n’y a pas lieu de vous mettre en colère. »
« Si je le suis, c’est de votre faute, dit Bilbo. Il est à moi, que je vous dis. À moi. Mon Trésor. Oui, mon Trésor. »
La figure du magicien demeurait grave et attentive ; seule une lueur tremblotante dans ses yeux profonds trahissait sa surprise et même son alarme. « Quelqu’un l’a déjà appelé ainsi, dit-il, mais pas vous. »
« Mais je le dis, maintenant. Et pourquoi pas ? Même si Gollum a déjà dit la même chose. Il n’est plus à lui, mais à moi. Et je vais le garder, je vous dis. »
Gandalf se leva. Il prit un ton sévère. « Vous seriez fou d'agir ainsi, Bilbo, dit-il. Vous en faites la démonstration chaque fois que vous ouvrez la bouche. Son emprise sur vous est beaucoup trop forte. Laissez-le partir ! Alors vous pourrez vous-même partir, et être libre (be free). »
[Suivent l'obstination de Bilbo, puis le courroux de Gandalf]
Bilbo se recula contre le mur, haletant, sa main agrippant la poche de son pantalon. Les deux se tinrent un moment face à face, et un frisson parcourut la pièce. Les yeux de Gandalf restaient braqués sur lui. Lentement, ses mains se détendirent et il se mit à trembler.
« Je ne sais pas ce qui vous prend, Gandalf, dit-il. Je ne vous ai jamais vu ainsi. À quoi tout cela rime-t-il ? Il est à moi, n'est-ce pas ? Je l'ai trouvé, et Gollum m'aurait tué si je ne l’avais pas gardé. Je ne suis pas un voleur, quoi qu’il ait pu dire. »
« Je ne vous ai jamais accusé d’en être un, répondit Gandalf. Et je n’en suis pas un non plus. Je n’essaie pas de vous voler, mais de vous aider. Je voudrais que vous me fassiez confiance, comme autrefois. »
SdA, I.1
La liberté et le bien de Bilbo forment ici le premier enjeu du magicien, bien avant le devenir de l'Anneau. C'est bien pourquoi Gandalf refuse de lui prendre l’Anneau de force. Pour que l'acte de Bilbo soit bon (il le sait d'ailleurs : « ce serait pourtant un soulagement », avoue-t-il) et que sa liberté soit préservée, il faut qu’il s’en sépare de lui-même : « Je disais souvent à Bilbo qu'il valait mieux ne pas utiliser de tels anneaux ; mais cela l'agaçait, et il ne tardait pas à se mettre en colère. De mon point de vue, il n'y avait pas grand-chose à faire. Je ne pouvais pas le lui prendre sans causer un plus grand tort ; et je n'avais pas le droit de le faire de toute façon. » (SdA, I.2). Ce qui rappelle à nouveau les termes en lesquels Tolkien décrit le « sacrifice » de Gandalf : « il s'en remettait à l'Autorité qui avait décrété (ordained) les Règles » (Lettres, n°156 p.288). Ce qui nous ramène à la liberté du Créateur, dont dérivent toutes les autres ...
Hors ligne
#104 23-05-2020 02:12
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Jonathan McIntosh a relevé, comme d'autres, que les nombreuses « oppositions » tolkieniennes entre bons et mauvais (Manwë / Melkor, Gandalf / Saruman, Elfes / Orques, etc.) atteignent « une symétrie presque parfaite au sein de laquelle Tolkien contrebalance chaque être bon avec sa forme mauvaise correspondante » (The Flame Imperishable, p.216, cf. « Le seuil et le centre », dans Pour la gloire de ce monde, p.94 en particulier avec la figure de « la maison de Tom »). Mais cette symétrie, « bien loin de suggérer une sorte de dualisme manichéen et d'équipotence entre le bien et le mal, nous rappelle au contraire que le mal est tributaire, même dans son extraordinaire variété et subtilité, de l'authentique variété et subtilité dont dispose la création, en vertu de sa participation à l'infinie variété du Créateur » (ibid., référence faite ici par l'auteur à Lettres, n°153 p.269). Cette symétrie, nous avons vu que Tolkien lui-même l'énonce : « l'histoire est bâtie en termes d'oppositions, entre le bon côté et le mauvais côté : la beauté et la laideur sans pitié, la royauté et la tyrannie, la liberté mesurée fondée sur l'assentiment (moderated freedom with consent) et la compulsion qui n'a plus aucun autre objet, depuis longtemps, que le seul pouvoir, etc. » (Lettres, n°144 p.255, trad. modifiée). Et surtout, il l'énonce de façon « thomiste » si je puis dire : la laideur comme déformation du bien, la tyrannie comme déformation de la royauté, la compulsion comme déformation de la liberté.
Certes il y a une symétrie entre les figures du Conte d'Arda, mais elle est loin d'être « presque parfaite » car une différence flagrante accompagne cette symétrie. Pour le dire, encore une fois, avec les mots de Simone Weil (lus ces derniers jours là encore, avant tes derniers messages) :
« Le bien absolu est autre chose que le bien qui est le contraire et le corrélatif du mal, quoiqu'il en soit le modèle et le principe. »
— Simone Weil, op. cit., p.254
Précisant dans un de ses cahiers :
«Le bien et le mal, c'est le centre du problème, et la vérité essentielle est que leur relation n'est pas réciproque. Le mal est le contraire du bien, mais le bien n'est le contraire de rien.»
— Simone Weil, ibid., p. 692 n.206
Melkor a besoin d'Eru pour être Morgoth, mais l'inverse n'est pas vrai.
Denethor a besoin d’Aragorn pour se définir comme « son propre maître » (SdA, V.7). Tom Bombadil n’a pas besoin de l’Homme-Saule pour être « son propre maître » (SdA, II.2)
Plus encore. Quoiqu’ominiprésent en Arda et en surnombre dans ses représentants, le mal est fondamentalement seul. Alors que le bien se vit sous le signe de l’addition et du partage, le mal opère dans la soustraction et l’isolement. Retrait de Melkor dans le Vide, retrait de Morgoth en Angband, retrait de Gollum jusqu’aux racines des montagnes, retrait de Smaug dans sa montagne, retrait de Saruman dans sa tour, retrait de Shelob dans sa caverne, retrait de Sauron au Mont Destin. La fraternité, la solidarité et le couple (réel, symbolique ou mystique : cf. Sam et Rose, Gandalf et Nienna, Gimli et Galadriel) d’un côté, le retrait, la solitude et l’incapacité d’aimer de l’autre. La communauté est celle de personnes qui œuvrent pour un bien qui ne se réduit pas à la somme des intérêts de chacun, la solitude est celle de volontés courbées sur elles-mêmes. Le bien comme chemin de vie passe par l’amour d’autrui et du monde, le mal comme refus d’un tel chemin.
Cf. « Un secours comme son vis-à-vis » in Pour la gloire de ce monde, p. 149-151 (qu'il faudrait citer en grande partie ici ; d'autant que, comme toi, je reprends le commentaire de Tolkien sur Gandalf : « il s'en remettait à l'Autorité qui avait décrété les Règles »).
S.
Hors ligne
#105 25-05-2020 11:05
- Elendil
- Lieu : Velaux
- Inscription : 2008
- Messages : 1 200
Re : La question du Libre Arbitre
(*) Tom Bombadil achève (ou parachève) le lien nécessaire entre la liberté et le Bien. Le fait qu'il apparaisse spécialement libre est une preuve de plus de son attachement et non de son indépendance à l'égard Bien. À cet égard, il me semble qu'une lecture agnostique de Tom Bombadil n'a pu être envisagée que d'après les catégories nominalistes dont nous avons parlé (où être libre c'est être libre à l'égard du bien et du mal).
À noter que l'essai en question (que je ne me souviens pas avoir déjà lu) n'est plus accessible depuis le lien présent sur le premier message dudit fuseau, ô maître du retissage du forum.
E.
Hors ligne
#106 25-05-2020 17:47
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
Yyr a écrit :(*) Tom Bombadil achève (ou parachève) le lien nécessaire entre la liberté et le Bien. Le fait qu'il apparaisse spécialement libre est une preuve de plus de son attachement et non de son indépendance à l'égard Bien. À cet égard, il me semble qu'une lecture agnostique de Tom Bombadil n'a pu être envisagée que d'après les catégories nominalistes dont nous avons parlé (où être libre c'est être libre à l'égard du bien et du mal).
À noter que l'essai en question (que je ne me souviens pas avoir déjà lu) n'est plus accessible depuis le lien présent sur le premier message dudit fuseau, ô maître du retissage du forum.
Pour ma part, je m'en souviens un peu (c'était l'objet d'une discussion encore assez récente lorsque j'ai découvert le présent forum, vers la fin de 2003, avant mon inscription en janvier 2004), même si le document en question n'a pas dû rester très longtemps en ligne, et même si cela remonte en tout cas maintenant à fort loin... Et quand j'ai relu l'autre jour, après sa mention ici par Yyr, le contenu du fuseau correspondant, j'ai eu l'impression d'être un mammifère du Cénozoïque occupant, par la force des choses, la niche écologique laissé vacante par un grand reptile disparu du Mésozoïque... Sauf que le grand reptile en question n'a pas disparu, évidemment, puisque j'ai encore eu l'occasion de parler avec le Dragon pas plus tard qu'avant-hier. ^^ Mais pour lui aussi, c'est un souvenir lointain, et le document (pdf ou page) sur sa digression « agnostique » à partir du nom elfique de Tom Bombadil, Iarwain Ben-adar, est possiblement irrémédiablement perdu, faute apparemment d'avoir été conservé, entre deux mues du site Hiswelókë, par la Wayback Machine. En tout cas, je n'ai rien retrouvé l'autre jour pour ma part, et le Dragon ne saurait dire où cela est passé (peut-être reste-t-il toutefois une copie quelque-part dans un disque dur... mais possiblement perdu lui-même ! Bref... même si on peut toujours se tromper et qu'il se peut que le document ressurgisse un jour, n'y comptez pas trop a priori)...
Ceci dit, sans surprise, tout cela ne nous rajeunit pas et ne fait qu'illustrer à quel point les paradigmes animant les échanges sur JRRVF cherchent inchangés depuis très longtemps, malgré la progression des intervenants dans l'âge... Le contenu du fuseau correspondant illustre d'ailleurs aussi l'ancienneté de la difficulté à parler de Tolkien sans que l'on en vienne à s'énerver quelque peu autour de certaines opinions tranchées sur fond de convictions spirituelles personnelles... Le dernier message du Dragon, à cette aune, semble assez représentatif de cette ambiance de l'époque, encore fraîche (si j'ose dire) à mon arrivée (« Enfin... pour ma part je potasserai à nouveau, peut-être, le sujet... mais loin des remous du forum »)...
Sur le fond, et ce n'est pas nouveau, la vision du Dragon concernant Tom Bombadil tend à rejoindre naturellement la mienne : la question s'agissant de ce personnage n'est pas tant de savoir qui il est (je l'ai déjà dit ailleurs pour ma part : Tom Bombadil est... ce que vous voulez), mais ce qui peut se trouver dans la zone d'ombre qu'il représente. Or, malgré tout le désir que l'on peut avoir d'embrasser toute l'œuvre dans une perception totalisante (ici chrétienne), Bombadil est là pour nous rappeler, entre autres, le rôle de l'auteur dans la présence « anormale » de ce personnage au sein de ladite œuvre. Tom Bombadil a été créé, précocement, dans un certain contexte, et il a été intégré à une « œuvre-monde » en suivant un lent processus, le tout s'inscrivant dans le caractère évolutif de la pensée de l'écrivain dont j'ai déjà parlé plus haut ici. Ce qui fait la richesse du personnage ne réside pas, à cette aune, dans son intégration « bien emboitée » à un ensemble perçu (parfois exagérément selon moi) comme « merveilleusement » cohérent, mais dans l'intégration que ledit personnage permet, au sein d'un ensemble supposé étroitement borné (par les limites induites notamment par un horizon spirituel particulier), du champ des possibles, et cela tant vis-à-vis de l'auteur (qui a vécu) que vis-à-vis du lecteur (qui a vécu, qui vit, et qui vivra, tant qu'il y aura des lectrices et des lecteurs).
Voila notamment pourquoi Tom Bombadil me parait échapper à tout esprit de système... même à l'aune d'un principe ontologique suprême, conçu depuis Platon, d'où viendrait l'ensemble du monde intelligible, à savoir l'idée du Bien. J'ai parlé précédemment d'un universel qui peut exister, mais qu'il ne faut pas essayer de définir : avec Tom Bombadil, comme avec Pan d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est aussi vis-à-vis de cette question que nous sommes invités à exercer notre libre arbitre, en fonction de ce que nous pensons ou croyons savoir, à telle ou telle époque de notre fragile humanité, à tel ou tel âge de nos modestes vies... et ce même seulement à l'échelle d'une œuvre littéraire, mais aussi bien évidemment au-delà. Peut-être que Tom Bombadil est attaché au Bien et non indépendant de lui... mais en quoi cet attachement ne relèverait-il pas d'abord d'un bien relevant d'une dimension morale et éthique à hauteur d'être humain avant d'être totalement rattachable à un Bien lié à une métaphysique particulière ? Si Tom est le « sans-père », n'en est-il pas moins capable de concevoir librement un choix d'action sage, sans avoir pour autant à se poser la question métaphysique du « Père », que celui-ci soit ou non conçu, à travers Ilúvatar, comme le Dieu personnel des religions du Livre ? Et de toute façon, est-on en mesure de savoir exactement ce que Tom a vraiment dans la tête quand il parle et agit, compte tenu de son identité indéfinie ? Toujours est-il qu'à chaque fois que l'on teste une hypothèse sur lui, ce brave Tom s'échappe... et cela me parait très bien ainsi. Il me semble que l'hypothèse de Jérôme selon laquelle Tom ferait figure d'Homme Immarri tend à rejoindre, en fait, d'autres hypothèses comparant Bombadil et Goldberry à Adam et Ève, ou plus largement à ce que Joseph Pearce a appelé « the Unfallen Creation ». Or, quitte à nous retrouver toujours confrontés aux notions de « péché » et de « Chute », j'avoue que tout cela me rappelle un intéressant dessin satirique de 2017, réalisé aux Pays-Bas par Gunduz Aghayev (artiste exilé, originaire de l'Azerbaïdjan) et intitulé Rescue : on y voit le premier couple, à l'origine de l'humanité selon la Bible, adoptant la seule attitude raisonnable face à toute volonté politico-religieuse de domination des esprits et des corps (entre autres évocations, toutes les religions plus ou moins instituées sont concernées, ainsi que toutes les idéologies elles aussi basées sur des idées absolues, y compris le « socialisme » de caserne, avec marxisme orthodoxe, uniforme castriste et/ou livre rouge maoïste, qui n'a évidemment rien à voir avec le socialisme de Jaurès ni avec « mon » socialisme, je le rappelle quand même en passant).

Remplacez le couple que sont Adam et Ève par le couple que sont Tom Bombadil et Goldberry, et considérez dès lors tous les autres personnages comme des allégories de l'esprit de système qui anime bien des grilles de lecture, et vous aurez une idée de la façon dont je conçois le personnage de Tom, et de ce que je veux dire quand j'ai parlé précédemment de porte de sortie (salvatrice) s'agissant de ce qu'il représente, du moins à mes yeux. ;-)
Point de malice de ma part dans cette évocation, évidemment, car cela ne veut pas dire que l'hypothèse de Jérôme ne me paraisse pas recevable : elle l'est comme toutes les hypothèses argumentées, et si cela peut te rassurer quant au ton de mon propos, cher Jérôme, elle m'apparaît de toute façon plus subtile que la grille de lecture d'un Pearce et ou d'un de ses suiveurs. Du reste, nous serons tous d'accord pour convenir que c'est une proposition parmi d'autres possibles, et tous d'accord pour remercier évidemment son auteur d'avoir pris tant de temps pour développer ici, plus généralement, l'ensemble de son propos sur la question du libre arbitre chez Tolkien.
Par ailleurs, après avoir relu le fuseau « Une lecture... agnostique de Tom Bombadil? », je note que les propos actuels de Yyr et de Sosryko sont dans l'exact prolongement de ceux qui étaient déjà les leurs à l'époque : on voit même déjà dans la discussion, par exemple, les prémisses du travail, très intéressant par ailleurs, que proposera plus tard Sosryko en évoquant conjointement Tom et Väinämöinen. À ce qu'il me semble, ce ne sont pas d'ailleurs lesdits propos de Yyr et Sosryko qui ont amené le Dragon à se mettre en retrait à l'époque, mais d'autres, plutôt sur le fond dans le sillage d'un Pearce justement, et considérant que toute discussion ne rentrant pas dans le cadre de la « Vérité » prétendument établie (selon certains) par la lettre 142 à Robert Murray ne serait que d'idiotes et dangereuses élucubrations « athées/agnostiques/monistes/nominalistes/sceptiques/empiristes/relativistes/marxistes » censées porter atteinte à l'intégrité de la sainte œuvre du « Professeur » : je force là le trait bien sûr, mais chacun pourra cependant constater que déjà à l'époque, il n'y avait pas de fumée sans feu... ^^' Mais bon, bien de l'eau a coulé sous les ponts, et Sosryko notait déjà lui-même à l'époque que c'est surtout par manque de participants aux discussions que celles-ci pouvaient avoir tendance, plus ou moins, à illustrer davantage certaines appréhensions de l'œuvre de Tolkien plutôt que d'autres. C'est toujours le cas aujourd'hui. Peut-être que le Dragon aura un jour envie de revenir parler de Tom, et plus largement de Tolkien selon un point de vue autre que strictement chrétien : je n'ai pas vocation à le remplacer ici en tout cas, malgré l'impression mammalienne/reptilienne évoquée au début de ce message. ^^'
Pour ce qui est des lectures chrétiennes de l'œuvre de Tolkien, peut-être ont-elles en tout cas, pour leur part, plus que d'autres, vocation à édifier des cathédrales à la cohérence censée épouser celle supposée de ladite œuvre... :-) Si c'est le cas, ce n'est pas un mal. Aux autres lectures d'assumer d'autres ambitions, différentes (c'est le cas de ma propre lecture, très modeste), et puissent toutes ces lectures diverses continuer à nourrir conjointement l'intérêt pluriel de toutes et tous autour d'une même œuvre, du moins tant que celle-ci sera lue.
Au fond, à tout âge, à toute époque, et pour conclure, Tom Bombadil me parait surtout faire figure de miroir : miroir d'un auteur d'abord, et surtout désormais miroir des lecteurs. Tolkien n'aurait pas pu créer meilleure figure, et c'est sans doute pourquoi Tom est mon personnage tolkienien préféré, source permanente d'imagination pour l'esprit et de mouvement pour la pensée de chacun.
Amicalement,
B.
P.S.:
Je vous suis déjà très reconnaissant, à Elendil, Hyarion et toi, de me suivre sur des chemins longs et laborieux :).
Merci à toi pour ta propre patience, Jérôme. ^^'
D'ailleurs, j'imagine bien Cédric, Isengar et les autres m'attendre (ou plutôt nous attendre, car vous êtes quand même trois téméraires à m'avoir suivi ;)) à la terrasse de l'hôtel, en train de siroter une bière ;)).
Oh pour ça oui, je les imagine également fort bien dans cette posture... le Dragon et sa fée inclus ! ;-)
[EDIT: correction de fautes...]
Hors ligne
#107 25-05-2020 19:21
- Hisweloke
- Inscription : 1999
- Messages : 1 622
Re : La question du Libre Arbitre
À noter que l'essai en question (que je ne me souviens pas avoir déjà lu) n'est plus accessible depuis le lien présent sur le premier message dudit fuseau, ô maître du retissage du forum.
Complètement oublié ce truc, moi... Enfin en grattouillant un peu, c'était une vague note (jamais un "essai") qui est là https://www.jrrvf.com/hisweloke/site2/a … /bombadil/
Délicat cependant de "corriger" le fuseau, parce que la survie du "site2" (sans parler du reste...) n'est pas assurée... Et ça ne cassait pas des briques non plus, ce petit texte, plus un "lancer de dés" qu'autre chose, qui a suscité quand même d'intéressants débats (au-delà de mes querelles avec un Cynewulf obtu;) - plus intéressants in fine que le point de départ.
D.
Hors ligne
#108 25-05-2020 19:42
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
Complètement oublié ce truc, moi... Enfin en grattouillant un peu, c'était une vague note (jamais un "essai") qui est là https://www.jrrvf.com/hisweloke/site2/a … /bombadil/
Ah merci, Didier ! J'ai bien fait de te relancer... ;-)
Hihi, c'est bien ce qu'il me semblait : il était curieux que la Wayback Machine n'ait absolument rien conservée jusqu'à aujourd'hui, mais dans la mesure où ta note en question n'apparait pas dans la page générale des articles (à thématique mythologique) de la version 2 d'Hiswelókë (page que la Wayback Machine a finalement peu archivée), seul l'auteur pouvait donc éventuellement grattouiller suffisamment sous le capot pour retrouver quelque-chose... ;-)
Enfin, ceci dit, si j'avais eu le temps, j'aurai pu évidemment tester toutes les options possibles en matière d'URL, mais bon... c'est quand même plus simple quand le Dragon retrouve lui-même ses papiers ! ;-)
Amicalement, ^^
B.
P.S.: que la version 2 du site survive encore longtemps ou pas, la page en question est désormais bel et bien archivée (comme d'autres) par la Wayback Machine, à cette adresse > https://web.archive.org/web/20200525182 … /bombadil/ .
[EDIT (26/05/2020): Bon, je vois que l'archive a disparu dès le lendemain de sa création, pour des raisons qui m'échappent... Tant pis ! Pour le moment, il nous reste donc la page originale...]
[EDIT (02/06/2020): Bon, l'archive est réapparue... La Wayback Machine, c'est magique. ^^'
Hors ligne
#109 25-05-2020 23:11
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Merci Didier pour cette nouvelle occasion de lire cette « vague » (mwarf) note, mais surtout de te lire tout court : )
S.
Hors ligne
#110 28-09-2020 11:01
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
@ Hyarion : Je n'oublie pas ton excursus sur Tom Bombadil, qui me semble donner une suite intéressante au fuseau mentionné. J'aurai peut-être une ou deux réflexions à y apporter, mais je le ferai alors à la suite dudit fuseau (que je suis d'ailleurs en train de repriser), en faisant le lien vers ta propre contribution ici.
Je reviens ici (en attendant d'autres compléments) sur ce que j'écrivais :
Pour finir sur cet aspect métaphysique, et rejoindre en partie (en partie seulement mais en partie quand même ;)) l'insistance de Benjamin à se méfier du « lithisme », rappelons que l'on prête à saint Thomas lui-même, à la fin de sa vie, cet aphorisme d'après lequel tout ce qu'il avait écrit ne valait guère plus que de la paille.
Erreur, mon cher Yyr ;).
Comme beaucoup d'aphorismes, celui-ci a été dépouillé de son contexte et de son symbolisme.
Comme j'ai voulu connaître un peu mieux celui que j'ai régulièrement mis à contribution ici, je me suis procuré ce récent ouvrage du dominicain Jean-Pierre Torrell : Saint Thomas en plus simple, le Cerf, 2019, 226p. Cet ouvrage est assez remarquable, puisqu'il parvient à être 1) facile d'accès, 2) court, 3) malgré les deux points précédents utile, réussissant à donner accès à la personne et à la pensée de l'Aquinate. (*)
Voici donc le contexte et le sens de l’aphorisme que je rapportais plus haut.
On est ici dans les derniers mois de la vie de Thomas d'Aquin :
Le 29 septembre 1273, Thomas participe encore au chapitre de sa province [des Dominicains] à Rome en qualité de « définiteur », chargé avec d’autres de « définir » la politique de la Province pour la période à venir. Quelques semaines plus tard, alors qu’il célèbre la messe dans la chapelle Saint-Nicolas, il expérimente une nouvelle extase (il en a déjà eu d’autres les jours précédents) et il en sort profondément transformé : « Après cette messe, il n’écrivit plus jamais ni ne dicta quoi que ce soit et délaissa même son matériel pour écrire ; il en était à la troisième partie de la Somme, au traité de la pénitence. » À Raynald [son secrétaire] stupéfait, qui ne comprend pas pourquoi il abandonne son œuvre, le Maître répond simplement :
« Je ne peux plus. »
Revenant à la charge, Raynald reçoit la même réponse :
« Je ne peux plus.
Tout ce que j'ai écrit me semble de la paille
en comparaison de ce que j'ai vu. »
C'était aux environs de la fête de saint Nicolas (6 décembre 1273).
Ces mots sont universellement connus de ceux qui s'intéressent tant soit peu à Thomas d'Aquin, mais ils sont souvent mal compris. L'expression « Tout cela me semble de la paille » ne signifie pas que tout cela ne vaut rien. On pourrait en effet se demander si, dans ces conditions, il vaut vraiment la peine d’étudier son œuvre. Ce serait se tromper que de le penser. En réalité, la paille, c’est l'expression consacrée pour distinguer, en lui donnant son poids, le grain de la réalité de l'enveloppe des mots ; les mots ne sont pas la réalité, ils la désignent et y conduisent. Parvenu à la réalité même, Thomas avait quelque droit à se sentir détaché à l’égard de ses propres mots. Cela ne signifiait nullement qu’il considérait son œuvre comme sans valeur. Il était simplement arrivé au-delà.
Jean-Pierre Torrell, Saint Thomas en plus simple, pp.156-157
Je pense que c’est là un symbolisme que n'aurais pas renié Tolkien (à condition d'être attentif à la beauté de l'enveloppe ;)).
Et je profite d'avoir donné ce passage correctif pour poursuivre, car la suite n'est pas sans lien avec notre fuseau, tout en étant, je trouve, très émouvante :
Après quelque temps chez sa sœur où on l'avait envoyé se reposer, Thomas et son compagnon regagnent Naples. Quelques semaines plus tard, ils doivent se remettre en route pour le concile que Grégoire X a convoqué à Lyon, pour le 1 mai 1274, en vue d’une entente avec les Grecs. Thomas prend donc avec lui le Contre les erreurs des Grecs qu’il avait composé à la demande d’Urbain IV. La réputation du voyageur chemine plus rapidement que lui et il est attendu par un envoyé de Bernard Ayglier, l’abbé du Mont-Cassin, qui l'invite à faire un petit détour par l'abbaye pour éclairer ses religieux sur le sens d’un passage de saint Grégoire. Déjà très fatigué, Thomas décline l'offre de passer par le monastère et allègue qu’une réponse par écrit aura l’avantage d’être utile à des lecteurs à venir et pas seulement à des auditeurs présents.
Les moines sont troublés par l'interprétation d’un texte qui concerne les rapports de l’infaillibilité de la prescience divine avec la liberté humaine. Thomas réaffirme ces deux données et souligne que la différence de plan entre les deux termes en présence n’entraîne aucune nécessité de l’un sur l’autre : voir quelqu'un s'asseoir ce n'est pas l’obliger à s'asseoir. Ainsi Dieu ne peut se tromper en sa science qui voit toutes choses dans le présent de son éternité et l’homme reste libre dans son activité de créature temporellement située. Paradoxalement, cette Lettre à Bernard Ayglier, abbé du Mont-Cassin dictée à Raynald est peut-être l'explication la plus claire et la plus brève que Thomas ait jamais donnée de ce problème. Il est déjà physiquement affaibli par la maladie, ses facultés intellectuelles sont intactes.
Il mourra quelques jours plus tard à l’abbaye cistercienne de Fossanova où il s'était arrêté pour reprendre des forces. Après s'être confessé à Raynald, il reçut une dernière fois le Christ sur cette terre.
Ibid., pp.157-158
Thomas, ce « grand frère », redonna pour ultime enseignement sa réponse au problème qui, sur JRRVF, avait ouvert nos échanges sur le libre arbitre ;).
PS : les citations données par le père Torrell sont issues du procès de canonisation de s. Thomas, si je ne m'abuse.
_________________________________
(*) Loin des clichés, saint Thomas n'était pas un intellectuel confortablement installé les pieds au chaud dans une tour d'ivoire et la tête dans un système conceptuel. Ce fut un homme, certes d'une intelligence hors pair, mais avant tout, d'une indépendance remarquable (résistant dès le début aux conformismes tant culturels qu'intellectuels de son temps — c'est lui, entre autres, qui innove sur la distinction entre ce qui relève de l'ordre spirituel et ce qui relève de l'ordre temporel), qui choisit la pauvreté, l'obéissance et l'enseignement de l'Écriture, parcourant de nombreuses routes (peu sûres), et qui élabora une doctrine au fur et à mesure en réponse à ce qu'on lui demandait (il était alors rigoureux mais non dogmatique : il était dogmatique si l'on entend par là la soumission à la vérité, il ne l'était pas si l'on entend par là un esprit de système « lithique » : d'où son admiration pour Aristote « le philosophe » ou encore le fait qu'il ne pourrait rentrer ni dans la démarche des empiristes ni celle des rationalistes).
Hors ligne
#111 29-09-2020 23:22
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Comme je l'avais évoqué, la présente recherche a été motivée, entre autres, par la demande d'un article. La rédaction de ce dernier, il y a quelques mois (l'occasion sera donnée d'annoncer sa publication en temps et en heure ; les participants de ce fuseau l'ont reçu en attendant), a été l'occasion, depuis nos derniers échanges, de relever quelques éléments complémentaires, à verser au dossier, comme on dit :), que voici.
À tout seigneur tout honneur : commençons par un passage des Lettres.
Il concerne le lien entre sagesse de Dieu et miséricorde, dont nous avons parlé notamment au moment de caractériser la nature de la toute puissance divine :
La Création, dans le Conte d'Arda, se loge aisément dans la théologie de saint Thomas, puisque Eru est le Grand Auteur qui « tout en demeurant “au dehors” et indépendant de son œuvre, y “habite” aussi, sur son plan dérivé, [...] comme la source et la garantie de son être », une œuvre où l'« on ne peut jouer un thème qui ne prend pas sa source ultime en [Lui] » et dont on attend un « accomplissement », c'est-à-dire où les choses, dont l'existence est « dérivée », devront être « achevées en forme et en acte ». Où encore les interventions « surnaturelles », c'est-à-dire « les ajouts d’Eru, ne sont pas “étrangers” mais s’adaptent à la nature et aux caractéristiques » de l'ordre du monde — selon la « puissance ordonnée » de Dieu, pour reprendre la terminologie scolastique. Où enfin, et surtout, ledit accomplissement des choses y est produit par la pitié, c'est-à-dire, par « le pouvoir de miséricorde [qui] ne nous est que délégué et est toujours exercé [...] par l'Autorité Suprême » : on pourrait y lire mot pour mot le Docteur Angélique qui, concluant sur la sagesse qui caractérise la puissance de Dieu, termine en disant qu'« en toute œuvre de Dieu apparaît donc, comme sa racine première, la miséricorde. La vertu de ce principe se retrouve dans tout ce qui en dérive, et même là elle agit plus fortement, comme la cause première a une influence plus forte que la cause seconde » (ST Ia.21.4).
Dans une Lettre que nous avons déjà souvent feuilletée, Tolkien écrivait, de façon très thomiste, si je puis dire :
Frodo a effectivement « échoué» en tant que héros, tel que le conçoivent les gens simples : il n’a pas résisté jusqu’à la fin; il a renoncé, lâché prise. Je ne dis pas « gens simples » avec mépris : ils voient souvent clairement la simple vérité et l’idéal absolu vers lequel il faut diriger effort, même s’il est inaccessible. [Toutefois,] ils ne perçoivent pas la complexité d’une situation donnée située dans le Temps, dans lequel est pris un idéal absolu. Ils ont tendance à oublier cet élément étrange dans notre Monde, que nous appelons Pitié ou Miséricorde, qui est également un impératif absolu du jugement moral (puisqu'elle est présente dans la nature Divine).
Lettres n°246 p.457
Une autre lettre nous intéresse, qui cette fois concerne la nature et le sens de la liberté que S.T. Pinckærs appelle liberté de qualité. Nous avons vu, dans le Conte d'Arda, le lien entre liberté, subcréation et morale (cf. la liberté du subcréateur : 1/3, 2/3, 3/3) : choisir le bien consiste à « s'accomplir » :
[...] un résumé de la liberté véritable, qui consiste à sortir de soi (to remove) pour aller vers (into) la lumière, la gloire, la majesté, et ainsi accomplir sa nature, c'est-à-dire déployer ses talents, les offrir, et enrichir le monde [...]
Eh bien, je ne l'avais jamais noté, mais Tolkien l'a écrit noir sur blanc :
La curiosité humaine en vient rapidement à demander COMMENT : de quelle manière cela en est-il arrivé à exister ? Et puisque la « structure » reconnaissable suggère un dessein, la curiosité peut en venir à POURQUOI ? Mais POURQUOI, en ce sens, sous-entendant des raisons et des intentions, ne peut référer qu’à un ESPRIT. Seul un Esprit peut avoir des buts proches, d’une manière ou à un degré quelconques, des buts d’un humain. Si bien qu'une question comme « Pourquoi la vie, l’ensemble des choses vivantes, est-elle apparue dans l'Univers physique? » induit immédiatement la Question : Y a-t-il un Dieu, un Créateur-Concepteur, un Esprit dont nos esprits sont proches (puisqu'ils proviennent de lui) si bien qu'il nous soit partiellement intelligible ? Par quoi nous en arrivons à la religion et aux idées morales qui en procèdent. À ce propos je dirai seulement que la « morale » a deux aspects, en raison du fait que nous sommes des individus (comme le sont à des degrés variables toutes les choses vivantes) mais ne vivons pas, ne pouvons vivre, dans la solitude, et avons un lien avec les autres choses, de plus en plus étroit jusqu'au lien absolu que nous avons avec notre propre espèce humaine.
La morale devrait donc guider nos buts humains, conduire nos vies : a) la manière dont nous pouvons développer nos talents individuels sans les gâter ni les gâcher ; et b) sans nuire à nos proches ni interférer avec leur développement. (Au-delà de ce point, on trouve le sacrifice de soi par amour.)
Lettres n°310 pp.558-559
Évidemment, il y a quelque chose de gratifiant de trouver après coup chez le Professeur confirmation de ses analyses :).
Au passage, le niveau théologique de cette lettre est impressionnant, qu'il s'agisse du premier paragraphe de ma citation, qui synthétise la compréhension de la personne humaine par le Christianisme depuis, disons, le Concile de Chalcédoine jusqu'aux les trois derniers papes, surtout Benoît XVI (la personne comme relation), ou du second, qui récapitule ce qu'est la « morale » « chrétienne » (ni autonomie ni hétéronomie, ni légalisme ni absence de loi, etc. mais la loi de notre être, notre bien).
Poursuivons maintenant avec la contribution d'un maître-compagnon de JRRVF à côté de laquelle j'étais passé.
Au détour d'une discussion sur les destins de Túrin et Tuor,
[...] le lien établi entre destin et espérance s'avère très heureux. En effet, loin d'être réductibles à la notion classique de fatum, tel que l'explicite FdN dans un précédent post, il me semble que les destins de Túrin et de Tuor relèvent davantage de l'idée que se faisaient les anciens Scandinaves du Destin.
Au-delà de la polysémie de cette notion (une quinzaine de termes en vieux norrois révélant les plus fines nuances qui soient : destin individuel ou collectif, neutre, subjectif ou objectif, passif ou actif, bénéfique ou maléfique, personnifié ou symbolique, etc.), R. Boyer a longuement démontré que, loin d'être écrasés par un fatum inexorable, il est donné aux söguligir, ces hommes reconnus « dignes de donner matière à saga », de participer à leur destin, révélant en eux quelque chose qui témoigne du sacré — les incitant à accepter leur sort et à accomplir les arrêts du Destin.
Cet éminent spécialiste de la mythologie nord-germanique souligne à ce propos que cette force immanente n'est pas sans analogie avec la notion de grâce chrétienne. Abondant dans le même sens, G. Dumézil note ainsi dans son essai :
[…] il faut admettre, pour des notions comme celle de confiance [je souligne], selon les individus et les circonstances, une certaine élasticité qui peut les porter au-dessus de leur point d’équilibre, jusqu’à une foi [je souligne] proche de la notion chrétienne […].
Du mythe au roman, Paris, PUF, coll. "Quadrige", 1997 (1970), chap. VI, « La première digression mythologique : géants, dieux ases et dieux vanes », p.94
On retombe ainsi sur la notion d'espérance telle que l'explicitait Yyr [...] :-)
On voit combien cette vision des choses peut assez aisément se superposer à celle que nous avons montrée : la liberté comme participation à / accomplissement de sa nature ... c'est-à-dire de son destin, d'après la quasi équivalence faite par les Elfes entre les deux notions. Les Elfes qui, une fois de plus, réunissent pour Tolkien « le passé scandinave » et « la foi nouvelle ». Ainsi que je l'écrivais en conclusion de mon essai :
Bien entendu, le mythe d’Arda n’est pas identique, dans sa narration, au mythe chrétien, il n’est pas non plus identique aux mythes nordiques ; mais il procède de la transformation de ceux-ci au contact de la foi, son auteur s’étant délibérément inscrit dans ce désir de « de conserver une forte proportion du passé scandinave pour le mêler à la culture continentale et à la foi nouvelle » [MCE, p.37]. Cette transformation, dans la perspective tolkienienne, ne résulte ni d’une « confusion » ni d’un assemblage, mais d’une « fusion » entre deux cultures qui « se sont embrasées au contact l’une de l’autre », une rencontre qui, « considérant l’ancien et le nouveau », a produit toute sa richesse [MCE, pp.32,39].
« Estel Eruhínion » in Pour la gloire de ce monde, pp.302-303
Et, hum :) dans une des dernières notes de cette conclusion, j'écrivais que « la même rencontre entre la foi et la culture se produit en Arda pour d’autres motifs que l’espérance : exemple (connexe) du destin et du libre arbitre, dont le Conte donnera une sorte de résolution » (Ibid. p.304). Je n'avais fait alors qu'entrevoir de très loin ladite résolution (et encore !) ... Je n'imaginais pas qu'elle fût à ce point parfaite.
Pour compléter les éléments linguistiques compatibles avec une compréhension thomiste du choix libre (choisir revient à délibérer, acte de la volonté informée par l’intelligence et finalisée par le bien de la personne), à savoir :
la relation philologique possible de la volonté avec l’intériorité de la personne (ici) ;
la préséance de l’intelligence dans la délibération (là) ;
On peut ajouter :
la relation philologique possible entre le choix et ce qui coupe, donc ce qui clôt la délibération, à travers la proximité (proxémie ?) des racines elfiques « √KIR : ‘cleave, cut’ » (PE n°17 p.157) et « √KIL : ‘choose, select’ » (PE n°22 p.149).
Enfin, nous avions régulièrement croisé des références évangéliques qui, à chaque fois, résumaient ou rassemblaient un aspect de la question. En voici une qui, depuis le début, me semble le faire pour l'ensemble de la question :
mettez en œuvre votre salut,
car c’est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire
selon son dessein bienveillant.
Philippiens 2,12-13
La contradiction apparente de ce verset (mettez vous à l'œuvre puisque c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire) étant manière de poser à la fois la question du libre arbitre et la réponse à cette question. La mythopoésie tolkienienne peut aider à le comprendre.
Voilà. C'est tout pour le moment :).
Si j'en ai le loisir, je reviendrai partager quelques notes de lecture pour une mise en relation avec d'autres auteurs (comme cela a été fait avec Jean Jaurès).
Hors ligne
#112 30-09-2020 22:46
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Bravo Yyr pour ces extraits des lettres qui confirment si bellement les recherches et lectures de ce fuseau :)
Hors ligne
#113 05-10-2020 15:48
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Si j'en ai le loisir, je reviendrai partager quelques notes de lecture pour une mise en relation avec d'autres auteurs (comme cela a été fait avec Jean Jaurès).
Eh bien c'est le cas aujourd'hui, si l'on peut appeler loisir l'état de faiblesse associé au mal de gorge traditionnel :).
P. Manent : la liberté comme qualité intrinsèque de l'action
La présente recherche m'a poussé à découvrir Pierre Manent et à lire ces jours-ci son essai sur La loi naturelle et les droits de l'homme, PUF, Paris, 2018.
Le philosophe, dans cet essai, a cherché à comprendre comment l'autorité des droits de l'homme en est venue à se substituer à celle de la loi naturelle. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui en découle pour la compréhension de la liberté. Alors qu'auparavant, on comprenait l'homme comme libre sous ou à partir de la loi, avec cette substitution la liberté précède la loi et, au final, le Droit, garante de la liberté en question, détermine la loi, laquelle n'indique plus le sens et la valeur de l'action mais l'organisation des conditions extérieures à l'action : la question posée « n’est plus la question qui se pose à l'agent, la question pratique et “intérieure” du choix réfléchi » (perspective antique et médiévale), mais « celle qui se pose à l'“artisan”, ou à l'artificer, la question mécanique et “extérieure” de la meilleure manière d'organiser la cohabitation ou la compatibilité des désirs de pouvoir » (perspective moderne, plus spécialement hobbesienne ici). Cette substitution s'accompagne d'un changement de rapport au monde, à l'homme et à l'éthique, que rassemble la proposition moderne : « l’homme est l'être qui a des droits », une proposition qui sonne « comme notre définition de nous-mêmes, notre définition de l'homme et de notre perspective sur l’homme, qui serait venue se substituer heureusement à d’autres définitions et perspectives, telles que : l'homme est la créature de Dieu, ou, l’homme est un animal politique ». (*)
D'où le contraste entre deux libertés :
la liberté pour les Modernes, c’est d’abord la levée des empêchements à [ce qui est compris comme] la nature [:] ce désir de puissance, cette machine désirante, il s’agit de le, de la libérer, c’est-à-dire d’ôter les obstacles qui s’opposent à son déploiement ou entravent celui-ci.
[...] pour résumer le contraste entre le choix réfléchi et la liberté de nécessité, contraste qui nous livre la strate la plus profonde de l'opposition entre la liberté des Anciens et la liberté des Modernes, je dirai quelque chose comme ceci : l'agent libre se soucie davantage de la qualité intrinsèque de son action que des obstacles extérieurs à celle-ci, tandis que l'individu libre se soucie davantage des obstacles extérieurs à son action que de la qualité intrinsèque de celle-ci.
La loi naturelle et les droits de l'homme, pp.96-97, 99
Ce qui nous ramène à la différence de perspective entre liberté du subcréateur et liberté melkorienne ; cf. la distinction faite par Servais Théodore Pinckærs entre liberté de qualité et liberté d'indifférence (cf. ce message (note ***)).
Pierre Manent souligne aussi comment ce contraste se décline dans notre rapport à la mortalité :
Si, dans la perspective de la liberté moderne, la vie consiste principalement à ôter les obstacles au mouvement de la vie, à son mouvement matériel et nécessaire, le libre individu rencontre la mort du corps comme l'obstacle par excellence. [...]
Cette orientation de la liberté moderne modifie profondément le caractère de la mort. Étant désormais un obstacle extérieur à écarter ou éloigner au lieu d’être un déterminant intrinsèque de la vie humaine auquel faire place et donner sens, la mort tend à devenir un accident extrinsèque qui ne réclame de nous d'autre effort, mais celui-ci infatigable et incessant, que de la rendre de plus en plus rare ou de plus en plus tardive.
Ibid., pp.99-101
À cette déclinaison très tolkienienne s'en ajoute encore une dernière : le contraste entre l'activisme et le mouvement économique et pulsionnel (régime d'autorisation des droits) et l'action réglée par la loi morale (principe de la loi naturelle), les deux étant corrélés négativement :
En nous abandonnant de plus en plus complètement, de plus en plus résolument, à l’inertie du laissez-faire, laissez-passer, [...] nous mettons notre foi dans le postulat qu’une certaine inaction, ou une certaine abstention, est à l'origine des plus grands biens. Tandis que gonflent et s’accélèrent les flux qui emportent les hommes en même temps que les produits de leurs activités, nous ôtons les freins et nous abstenons des actions qui seraient susceptibles de modérer et de diriger le mouvement des hommes et des choses.
Ibid., pp.130-131
Où l'on retrouve le contraste tolkienien (et la même corrélation négative) entre la Machine et la subcréation : entre le « recours à des plans ou procédés (appareils) externes » et le « développement des pouvoirs ou des talents internes qui nous sont propres » (Lettres, n°131 p.210), entre « la tragédie, la vacuité, de toute machine », et ce qui seul peut « touch[er] au cœur des choses » (Lettres, n°75 p.131) — cf. le fuseau de référence ;).
Yyr
PS : je recevais justement de la part d'un ami une citation de Lord Acton (auteur de l'aphorisme bien connu : « le pouvoir corrompt ; le pouvoir absolu corrompt absolument »):
Liberty is not the power of doing what we like, but the right of being able to do what we ought.
La liberté n’est pas le droit de faire ce que nous voulons, mais le droit d’être en mesure de faire ce que nous devons.
Lord (John Emerich Edward Dalberg) Acton, « The Roman Question », in The Rambler, vol. II, New Series, January 1860, pp.137-154
__________________________________________________
(*) Je donne ici, un peu comme je l'avais fait pour celui de Jacques Maritain, un condensé et fil directeur du travail de Pierre Manent.
Condensé et fil directeur relatifs à ma recherche (son essai est plus vaste) que, par commodité, je découpe et numérote au fur et à mesure.
1. À partir du discrédit porté aujourd'hui à la notion de loi naturelle :
[La notion de loi naturelle] présente cette caractéristique d'avoir été radicalement discréditée par la philosophie moderne et d’être aujourd'hui l'objet du mépris unanime de l’opinion éclairée. Celle-ci l’exclut du débat public pour son archaïsme supposé et l'obstacle qu’elle opposerait à la reconnaissance et à la mise en œuvre des droits humains. On ne peut dire qu’elle reste absolument sans honneur puisqu'elle est l’objet de savantes études, historiques ou systématiques, et que certains secteurs de la pensée catholique continuent d'y recourir comme à une notion pertinente ou même indispensable pour s'orienter dans le monde humain. En tout cas, rejetée dans le passé ou confinée dans une tradition unique et singulière, quoique vénérable, elle est absente des débats moraux et politiques dans lesquels elle joua jadis un rôle central. On pourrait dire sans paradoxe que c’est par son absence, ou par le décret d’illégitimité dont elle est frappée, qu’elle contribue aujourd'hui à donner forme au débat public, ou à ce qui en tient lieu. C'est ainsi que je résumerai, un peu cavalièrement peut-être, mais assez fidèlement je crois, la situation faite parmi nous à la loi naturelle, à la notion même ou au principe de la loi naturelle.
La loi naturelle et les droits de l'homme, pp.1-2
2. Et de la substitution moderne opérée au profit des « droits » :
À l’idée chrétienne, ou biblique, d’une humanité qui commence sous la loi, et qui, obéissante ou désobéissante, reste sous la loi, se substitue celle d’une humanité qui commence dans une liberté ignorante de toute loi, et qui, une fois forcée par la nécessité de se donner des lois, ne le fera que sous la condition et dans l'intention de préserver l'intégrité de sa liberté sans loi : le citoyen moderne, en se plaçant sous la loi qu’il a produite, entend rester, selon la formule du Contrat social, « aussi libre qu'auparavant ».
En d’autres termes, la loi désormais n’a de validité ou de légitimité que si elle vise à garantir les droits humains et se borne à cette finalité.
Ibid., p.8
3. Substitution opérée par séparation, individualisation, dénaturalisation du titulaire des droits — lorsqu'il a fallu fonder rationnellement la perspective moderne d'une liberté antérieure à la loi, ne pouvant faire autrement que de prendre pour titulaire des droits cet individu distingué par la nature elle-même, on s'est attaché à comprendre l'état de nature comme ce qui rassemble tout ce qui est naturel en l'homme en tant qu'individu séparé :
En rassemblant tout ce qui est naturel en l'homme dans l'individu séparé, c'est-à-dire dans la séparation comme telle, en condensant la force et le sens de la nature dans son pouvoir séparateur, on vide l'ensemble du phénomène humain de toute autre détermination naturelle que la séparation en individus, on le « dénaturalise » radicalement. Une fois la validité ou l'autorité de la nature circonscrite dans le fait brut de la séparation radicale, ce qui est proprement humain peut être construit et déconstruit à notre guise, puisque dépourvu d’une base naturelle dont nous devrions reconnaître la force déterminante ou inspirante. De tout caractère humain, nous pouvons dire désormais qu’il est « construit », et qu’il est donc possible et éventuellement urgent de le « déconstruire ».
Ibid., pp.10-11
Cette opération d'individualisation et de séparation ayant certainement été favorisée par celle de la science moderne :
On peut penser que la physique nouvelle, par les promesses que contenait la réduction des quatre causes aristotéliciennes à la cause efficiente, acquit sur les esprits un tel empire que la tentation devint irrésistible de penser le monde humain, y compris et d’abord la vie politique, dans les mêmes termes, et que dès lors l’individu-conatus, l'individu-vivant-en-mouvement, apparut ou fut élaboré comme l'élément causal efficace qui était nécessaire à l'intelligibilité et à l'ordonnancement du monde humain.
Ibid., pp.22-23
4. L'auteur montre comment on comprit la loi comme organisation des conditions extérieures à l'action :
— avec Hobbes (l'élément de base est l'individu avide de pouvoir) :
En condensant les ressorts de l’action dans le désir de pouvoir, Hobbes ne laissait pas de place aux raisons de l'action et postulait ou impliquait que celles-ci sont indifférentes ou sans force déterminante. La question posée par Hobbes n’est plus la question qui se pose à l'agent, la question pratique et « intérieure » du choix réfléchi, mais celle qui se pose à l'« artisan », ou à l'artificer, la question mécanique et « extérieure » de la meilleure manière d'organiser la cohabitation ou la compatibilité des désirs de pouvoir, qui se ressemblent en ceci qu'ils sont « sans raison ».
N’étant pas « touchée » par les questions pratiques, la raison du « nouveau philosophe » ou du « nouveau Savant » se trouve incapable et peu désireuse de les « toucher » de son côté, incapable et peu désireuse d’entrer dans les raisons de l'agent. L'intelligence chargée d'éclairer le monde humain dédaigne d’entrer dans la question de l'action, et de se faire science pratique ou au moins de faire sa place à la science pratique. Déclinant d'éclairer où de guider l'agent dans son action, elle consacre toutes ses forces à déterminer puis à organiser les conditions extérieures de l’action. C'est ainsi que la doctrine de Hobbes installe les hommes sur le plan de légalité des droits, ou de l’égale liberté, par le moyen de la peur qu’inspire le Souverain. Pour le reste, tant qu'ils obéissent au Souverain, les citoyens font comme bon leur semble, le philosophe ou le savant n’a rien à en dite ni en penser.
Ibid., pp.24-25, 26
— et Machiavel (partir des hommes tels qu'ils agissent en fait et non tels qu'ils devraient agir moralement) :
Sortir de la condition pratique [morale], surmonter ou dépasser cette condition, c’est donc, pour Machiavel, congédier la conscience, ce qu’il fait fort explicitement et même emphatiquement, en particulier lorsqu'il presse le prince, ainsi que nous l’avons vu, d’« apprendre à pouvoir ne pas être bon » et de « savoir entrer dans le mal » quand c’est nécessaire. Le plus significatif dans ce conseil répété par Machiavel, ce n’est pas qu’il invite le prince à faire le mal quand les circonstances l’exigent, c’est qu'il lui demande pour cela de renoncer d'avance à sa conscience, c'est-à-dire au guide et au juge naturel des actions humaines.
C’est cet effacement ou arrachement de la conscience, de cette capacité humaine dégagée seulement en contexte chrétien, qui résume et accomplit la sortie de la condition pratique que Machiavel encourage et promeut. L'effacement ou l’arrachement du guide et juge intérieur conduit à chercher nos éléments d’orientation à l'extérieur, c’est-à-dire dans le monde tel qu’il est saisi non plus selon nos dispositions pratiques mais selon des points de vue théoriques variés.
Ibid., pp.40, 41
— voire Luther :
Le propre et la pointe de la Réformation luthérienne se concentrent dans le principe de la « foi seule » — sola fide — par lequel Luther sort du marasme d’une vie hantée par la conscience du péché. Par le saut de la foi, il parvient à une confiance ou une certitude — une fiducia — qui, si elle n'appartient pas bien sûr à l’ordre théorique, tend à arracher le croyant à l’ordre pratique, dans la mesure où elle accède immédiatement à un Dieu qui par sa grâce ne transforme pas réellement le pécheur, ne le sanctifie pas, mais le soustrait à sa colère en prenant sur lui son péché. On pourrait dire : où il y avait un chrétien agissant, ou un agent chrétien, il y a désormais simplement un croyant.
Ibid., p.42
5. Avec un paradoxe — concevoir le Droit (au sens moderne) antérieur à la Loi (au sens antique et médiéval), c'est « mettre la charrue avant les bœufs » :
La déclaration et la promotion des droits humains supposent en effet l’existence préalable d'un monde humain déjà ordonné selon des règles ou des finalités qui ne dérivent pas simplement des droits humains. Si l’on souhaite par exemple étendre les droits d’accès à l’université de manière judicieuse, il convient d’abord de se former une idée un peu nette du sens de l'institution universitaire, une « idée de l’université ». Pour que les « nouveaux droits » signifient un progrès social et moral effectif, encore faut-il qu’ils n’obscurcissent pas, ou n’endommagent pas le sens de l'institution à laquelle on entend donner un accès plus large.
Ibid., pp.54-55
6. Et pour conséquence la prédation du Droit à l'égard du monde, avec une triple captation :
— métaphysique — le droit comme droit d'accès indifférent au réel :
l’idée des droits tend à devenir une forme vide en quête de sa matière, et tout, littéralement tout peut devenir matière pour cette forme. N'importe quel aspect du monde humain, du plus manifeste jusqu’au plus secret, est désormais exposé à une prise légitime. Son architecture infiniment complexe et différenciée est livrée à un droit d'accès indifférent à cette complexité. Déclarer les droits humains d’une manière aussi parfaitement indéterminée et indéterminante, c’est accorder à quiconque l'autorisation formelle de prendre la chose quelconque du monde humain à laquelle il se juge ou se sent avoir droit. Et comment tous ne réclameraient-ils pas leur droit à toutes choses quand toutes choses ont été déclarées matière des droits humains ?
Ce qui est perdu de vue en particulier, c’est le rôle déterminant et spécifique de la loi comme règle de l'action, puisque le droit, maintenant compris comme antérieur à la loi et indépendant d’elle, se présente à nous comme principe suffisant de l’action [...].
Ibid., pp.55, 57
— anthropologique — le droit définit l'homme (dans tous les sens de l'expression) :
[la proposition moderne :] l’homme est l'être qui a des droits [...] sonne comme notre définition de nous-mêmes, notre définition de l'homme et de notre perspective sur l’homme, qui serait venue se substituer heureusement à d’autres définitions et perspectives, telles que : l'homme est la créature de Dieu, ou, l’homme est un animal politique. Cette définition a acquis, il est vrai, l'autorité dont bénéficiaient jadis d’autres définitions. Elle n’est cependant pas du même type. Non seulement bien sûr son contenu est différent, mais elle est différente aussi en tant que définition, ou dans sa forme de définition.
Ibid., p.57
— éthique — « la loi » peut devenir « esclave des droits », et l'on arrive, entre autres, à ce que le philosophe appelle ici « le spectre du sujet autonome » : « une notion qui n’a pas de sens dans la compréhension classique de l'agir humain, et qui pour cela fut écartée explicitement comme une chimère conçue par le démon de l’analogie, en l'occurrence l'analogie entre l'agent individuel et le corps politique » (p.73 : contrairement au corps politique, l'agent individuel, en toute rigueur de termes, ne peut donner la loi à ses actions ; il peut se maîtriser, ce n'est pas la même chose) :
L'idée de l'autonomie n'a pour ainsi dire rien à voir avec celle de la maîtrise de soi. De fait, l'idée de l'autonomie n’a acquis l'autorité qu’elle possède aujourd'hui qu’à proportion que l'idée du pouvoir de âme sur le corps, ou de la maîtrise de soi, perdait la sienne. Les deux idées sont exclusives l'une de l'autre, elles s'opposent comme celle d’un ordre naturel, d’un « ordre de l'âme » que la maîtrise de soi manifeste et fait valoir, et celle d'un ordre qui est tout sauf naturel puisqu'il est au contraire censé être produit par le sujet lui-même dans l'opération par laquelle il se commanderait à lui-même et obéirait à lui-même.
Ibid., p.75
7. D'où la compréhension moderne de la liberté comme levée des obstacles, avec, incidemment, une compréhension ambivalente de la nature (et de la maîtrise de la nature puisque la liberté ainsi défendue consiste à se soumettre à sa nature ... cf. C. S. Lewis, l'abolition de l'homme, 1943) :
Il importe de ne pas l'oublier en effet, la liberté moderne est née fort amie de cette nature qu’elle traiterait, ou ferait mine de traiter ensuite de si haut, elle est née en vérité et s’est comprise comme un prolongement et un besoin de celle-ci. Plus précisément, la liberté moderne est née comme nature libérée, comme nature désentravée : la liberté pour les Modernes, c’est d’abord la levée des empêchements à [ce qui est compris comme] la nature [:] ce désir de puissance, cette machine désirante, il s’agit de le, de la libérer, c’est-à-dire d’ôter les obstacles qui s’opposent à son déploiement ou entravent celui-ci. Bref, laissez-faire, laissez-passer, telle est la formule simple mais prodigieusement séduisante de la liberté moderne, qu’il s’agisse de la circulation des blés, des travailleurs, des idées, ou des pulsions. Il y a toujours une partie de la société, un secteur d'activité, un aspect de la nature humaine, un domaine de l'être qui est encore entravé. Il y a toujours des obstacles, hommes et choses, qui empêchent ou ralentissent le mouvement. Il y a toujours une liberté nouvelle, des droits nouveaux à promulguer afin de désentraver, dégager, libérer la nécessité naturelle qui était déjà là et faisait sentir sa pression.
Ibid., pp.95-97
Une compréhension incompatible avec les notions de loi naturelle, de choix réfléchi et de libre arbitre :
On formule un lieu commun si l'on pose que pour les Modernes, la notion de loi naturelle est insoutenable, en somme privée de sens, car incompatible avec la définition de l’homme comme liberté, voire directement contraire à celle-ci, définition qui ne ferait qu’un avec la conscience que nous prenons de nous-même comme « sujet », comme « individu », ou précisément comme « conscience de soi ». La loi ne peut avoir de sens pour les hommes, du moins pour les hommes parvenus à cette conscience de soi, que si elle est un produit, ou une expression de leur liberté.
De fait, les philosophes les plus importants ou les plus influents dans l'élaboration du projet libéral sont pour ainsi dire tous des critiques résolus et explicites de la conception grecque du choix réfléchi comme de la conception chrétienne du libre arbitre et de la conscience. S'il est certain qu'ils veulent libérer les hommes des entraves qui les retiennent et les contraignent, on peut douter que les hommes qu’ils veulent libérer soient des agents capables de l'opération pratique complète que les Grecs appellent donc un choix réfléchi et les chrétiens un acte libre.
Ibid., pp.95, 98
Mais davantage perçue comme un processus concurrentiel (cf. Jean-Claude Michéa, l'empire du moindre mal : essai sur la civilisation libérale, 2007) :
Pour les pères du libéralisme, la décision qui détermine l’action est la dernière étape d’un processus en somme mécanique, un processus concurrentiel qui donne l'avantage à la « préférence » la plus forte, processus dont l'individu est le cadre et le témoin, mais dans lequel il n'intervient pas comme un agent véritablement libre.
Ibid., p.98
8. Avec, au final, deux conceptions de la liberté (cf. Servais Théodore Pinckærs entre « liberté de qualité » et « liberté d'indifférence ») :
pour résumer le contraste entre le choix réfléchi et la liberté de nécessité, contraste qui nous livre la strate la plus profonde de l'opposition entre la liberté des Anciens et la liberté des Modernes, je dirai quelque chose comme ceci : l'agent libre se soucie davantage de la qualité intrinsèque de son action que des obstacles extérieurs à celle-ci, tandis que l'individu libre se soucie davantage des obstacles extérieurs à son action que de la qualité intrinsèque de celle-ci.
Ibid., p.99
Le contraste se retrouvant (non pas uniquement mais clairement, comme s'il s'agissait de la pierre de touche) dans le rapport à la mort :
Si, dans la perspective de la liberté moderne, la vie consiste principalement à ôter les obstacles au mouvement de la vie, à son mouvement matériel et nécessaire, le libre individu rencontre la mort du corps comme l'obstacle par excellence.
Vue dans cette perspective, la mort du corps n’ouvre pas un domaine nouveau, une expérience inédite, elle n’introduit pas d’interrogation essentielle ou urgente dans la teneur ou la trame intime de la vie, elle est simplement le plus grand obstacle matériel susceptible d'interrompre le mouvement matériel et nécessaire de la vie. [...] La sécurité du corps, la conservation, le confort et la santé du corps deviennent le souci de plus en plus obsédant, de plus en plus exclusif même, de l'individu-vivant-et-libre.
L'agent libre ne se rapporte pas ainsi à la mort. [...] Ce n’est pas qu’il regarde la mort sans ciller, c’est qu'agissant il regarde d’abord la règle de l’action, et que la mort et la peur de la mort ne peuvent plus venir au premier plan de son attention. On pourrait dire : l'individu qui voit dans la vie une suite d'obstacles à écarter, et dans la mort le plus grand obstacle à écarter, finit par ne plus voir dans la vie que la mort qui le menace, tandis que l'agent, trouvant dans la vie une pluralité de motifs et de règles d'action qu'il importe de combiner droitement, a devant lui un champ pratique fort rempli, que la mort, aussi à craindre soit-elle, ne saurait venir occuper à elle seule, ni même en général dominer.
Cette orientation de la liberté moderne modifie profondément le caractère de la mort. Étant désormais un obstacle extérieur à écarter ou éloigner au lieu d’être un déterminant intrinsèque de la vie humaine auquel faire place et donner sens, la mort tend à devenir un accident extrinsèque qui ne réclame de nous d'autre effort, mais celui-ci infatigable et incessant, que de la rendre de plus en plus rare ou de plus en plus tardive.
Ibid., pp.99-101
(Cf. le tout récent opuscule d'Olivier Rey, l’idolâtrie de la vie, 2020)
9. Telle est l'aporie de la perspective des droits : même si la loi naturelle n'est pas de l'ordre de l'explicite (cf. Jacques Maritain, la loi naturelle ou loi non écrite, 1986), il ne peut pas ne pas y avoir de loi naturelle :
La loi naturelle, ce sont les principes pratiques que les hommes ne font pas puisqu’ils appartiennent à leur nature, mais qui motivent, éclairent et orientent les lois que font les hommes. S'il n'y a pas une instance ou une ressource comme la loi naturelle, il ne saurait y avoir de loi humaine proprement dite puisque les hommes n'ont alors aucun moyen d'évaluer ce qu'il leur plaît d'appeler loi, aucun moyen d’abord de savoir s’il s’agit bien du dispositif pratique appelé loi, comme on le voit aujourd’hui où la loi, en devenant de plus en plus exclusivement loi de garantie des droits, loi d'autorisation, est en voie de perdre entièrement ce qui fait sa nature de loi, c’est-à-dire de règle de l’action. Il est bien vrai que la loi que suivent les hommes n’a de sens que rapportée aux hommes qui la produisent, mais la loi naturelle est précisément la médiatrice de ce rapport : la loi humaine n’a de sens que rapportée à la nature des hommes.
Ibid., pp.125-126
10. Et la corrélation désastreuse qu'elle entraîne, avec, d'une part, l'activisme et le mouvement théorique, économique et pulsionnel (régime d'autorisation des droits), et, d'autre part, l'inaction et l'abstention de l'action réglée par la loi morale (principe de la loi naturelle) (« en [...] garantissant [...] le taux d’imposition existentielle le plus bas possible », J-C. Michéa, l'empire du moindre mal : essai sur la civilisation libérale, pp.35-36) :
En nous abandonnant de plus en plus complètement, de plus en plus résolument, à l’inertie du laissez-faire, laissez-passer, [...] nous mettons notre foi dans le postulat qu’une certaine inaction, ou une certaine abstention, est à l'origine des plus grands biens. Tandis que gonflent et s’accélèrent les flux qui emportent les hommes en même temps que les produits de leurs activités, nous ôtons les freins et nous abstenons des actions qui seraient susceptibles de modérer et de diriger le mouvement des hommes et des choses. [...] La grammaire de la vie humaine s'est réduite pour nous au pâtir et au jouir. Entre ces deux modes de la passivité qui ont toute notre attention et qui fournissent la matière de tous nos nouveaux droits, nous n'avons plus de place pour l’agir. Au commencement de l'arc du développement moderne, nous avons délibérément abandonné la loi qui commande et donne la règle de l’action, en faveur de l'État qui organise les conditions de l'action, une action désormais jugée non selon sa règle ou sa fin mais selon ses effets. Depuis lors la règle de l’action n’a cessé de s’étioler et l’action de s’amoindrir tandis que les effets de nos activités, amplifiés par nos abstentions, devenaient toujours plus écrasants. L'animal agissant est aujourd’hui prisonnier du dispositif si audacieux et si ingénieux qu’il avait construit pour échapper à l'urgence, et se soustraire à la difficulté, de la question pratique. Piégé dans le non-agir, il traque, dans une sorte de fièvre terminale, les ultimes recoins de l'existence sociale ou morale qui échappent encore au laissez-faire et où l'idée même de la loi pourrait subir sa défaite finale.
Ibid., pp.130-131
Hors ligne
#114 05-10-2020 16:53
- Elendil
- Lieu : Velaux
- Inscription : 2008
- Messages : 1 200
Re : La question du Libre Arbitre
Merci pour ce très intéressant partage. Je ne tenterai pas d'en faire une présentation aussi détaillée, mais l'analyse de Pierre Manent me semble très complémentaire à celle de Pierre-André Taguieff dans son dernier ouvrage , l’Émancipation promise (éd. du Cerf, 2019).
Celui-ci ne part pas d'un postulat chrétien comme semble faire Manent, mais déconstruit, précisément, l'idée d'émancipation aujourd'hui conçue comme l'alpha et l'oméga de l'action politique. Le livre est d'une érudition rare, ce qui rend le propos parfois difficile à suivre dans les premiers chapitres, mais l'analyse se met en place progressivement et la synthèse est remarquable.
E.
Hors ligne
#115 05-10-2020 23:45
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Je confirme l'intérêt de ces deux livres fort intéressants, non seulement pour le propos mais parce que Pierre Manent écrit toujours avec élégance et que P.-A. Taguieff brasse comme à son habitude une somme de références impressionnantes.
S.
Hors ligne
#116 08-10-2020 14:49
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Merci à tous les deux pour cette référence :)
Hors ligne
#117 08-10-2020 14:49
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
J. Ellul : la liberté comme médiatisation de la puissance de Dieu
Deuxième (re)lecture récente : Jacques Ellul, Éthique de la Liberté, Labor et Fides, 2019.
La (superbe ;)) réédition de l'Éthique de la Liberté (en un seul tome) a été l'occasion pour moi de relire d'un œil neuf un passage important où, désireux de privilégier l'éthique à la métaphysique de la liberté, Ellul insiste sur la médiation établie au bénéfice de l'homme par Dieu entre Lui et la Création :
Malgré la séparation et la chute, Dieu décide de maintenir la médiatisation qu’il avait établie au profit d’Adam en Éden. Dieu ne gérait pas lui-même sa création. Il avait confié à Adam cette gestion. Par la séparation, l’homme n’est plus le gérant de la création pour Dieu. Il a voulu devenir le maître de cette création – et il l’est. Mais il l’exploite dans des conditions tout autres que celles que Dieu avait posées. L’homme est exactement le vigneron de la vigne dont parle Jésus, et qui veut garder à la fois le produit et la propriété [Mt 21, 33-46 = Mc 12, 1-12 = Lc 20, 9-19]. Il dénature cette création, il l’exploite à mort, ne lui laissant aucun repos et la soumettant à la férocité de son appétit.
[Cf. le parallèle avec le thème tolkienien de la Machine (fuseau idoine).]
Réciproquement cette création ne lui est plus amicale, elle lui produit des chardons et des épines. Elle est danger, refus, hostilité. Les relations entre l’homme et la création n’ont plus réciproquement rien à voir avec ce que Dieu avait voulu.
[Cf. le parallèle avec le thème tolkienien du « Marrissement des Hommes » (« le Conte d'Adanel », HoMe X, pp.345-349).]
Et dans sa patience, dans son respect de l’homme, Dieu laisse faire. Pourtant il est le Seigneur. Mais il ne veut pas plus exercer une seigneurie directe, établie en dehors de la participation de l’homme qu’il ne l’avait voulu pour Adam. Seulement, il est impossible de restituer à tous les hommes ce pouvoir de médiateur entre le Seigneur et la création. Cela n’est strictement possible qu’au profit de celui qui reconnaît cette seigneurie. Sans quoi cela ne voudrait absolument rien dire – ou plutôt cela impliquerait non plus la patience et l’amour de Dieu, mais la démission de Dieu et son anéantissement. Si l’homme était réinvesti de sa fonction médiatrice sans reconnaître expressément que Jésus Christ est le Seigneur, cela voudrait dire d’une part que Dieu remet à l’homme non la gérance mais la pleine propriété de la création – et de ce fait d’autre part que le projet de Satan, dans l’Éden, a finalement réussi. Or, si Dieu donne à l’homme cette fonction médiatrice, c’est précisément pour que l’homme, confessant que l’Éternel est Dieu, exerce pour Dieu son pouvoir. Lorsque ce pouvoir de Dieu prend la forme et le visage de la seigneurie de Jésus Christ (et c’est à la vérité la seule forme, le seul visage de cette puissance souveraine de Dieu que nous puissions connaître), cela implique que cette Seigneurie ne s’exercera pas autrement que par l’intermédiaire de l’homme. Mais évidemment pas par l’intermédiaire de tout homme. Prétendre que l’homme qui ne connaît pas, ou ne reconnaît pas Jésus Christ, puisse être le médiateur de sa seigneurie, a pour conséquence rigoureuse que n’importe quel homme est Jésus Christ et qu’il n’y a aucune relation entre ce serviteur Seigneur et Dieu.
Seul celui qui confesse la Seigneurie de Jésus peut être fait par Dieu représentant de cette seigneurie. Or, pour être ce représentant, l’homme doit justement être libre. C’est en tant qu’homme libre que la créature est médiatrice de la Puissance de Dieu. C’est dans la mesure où il est restitué dans la liberté que l’homme exerce la seigneurie de Christ. Retenons alors ces deux termes : « Cette seigneurie ne s’exerce que par l’intermédiaire de l’homme. » « Celui-ci ne peut être qu’homme libre pour être cet intermédiaire. » Dans cette liberté, l’homme est fait vicaire, Roi, Sacrificateur (1 P). Il n’y a pas d’autre raison, pas d’autre signification à sa liberté que d’être exactement cela (*). Toutes les orientations et décisions de la liberté dérivent de cette fonction médiatrice. Mais aussi, les limites. Et aussi les personnes qui sont appelées à cette liberté. Celle-ci n’est pas une sorte de néant qu’il faut remplir, de force indéterminée à utiliser, de champ de possibles ouverts qu’il faut exploiter, de tout un « n’importe quoi » à faire. Cette liberté est signifiante de la place vicaire de l’homme et réciproquement.
__________________________
(*) [Note d'Ellul] Je me retrouve ici en plein accord avec TILLICH (Systematic Theology I) lorsqu’il affirme que par la justification l’homme trouve la liberté en devenant un être nouveau – « l’esclavage et la crainte ont disparu, l’obéissance a cessé d’être obéissance et est devenue inclination libre [...] » [...] et la liberté crée une moralité nouvelle entièrement axée sur l’amour.
Jacques Ellul, Éthique de la Liberté, pp.133-135
Où l'on retrouve exactement ce que nous avons vu quant à la compréhension de la liberté substantielle ou de qualité, et de son rapport subcréateur à la puissance divine, ainsi qu'à l'obéissance : une liberté « signifiante de la place vicaire de l’homme et réciproquement » ; opposée à ce que d'autres appellent la liberté d'indifférence, ici décrite comme une « sorte de néant », de « force indéterminée » ou de « tout un “n'importe quoi” à faire ».
La superposition est d'autant plus intéressante qu'Ellul part généralement d'une métaphysique tirant davantage vers le nominalisme (mais il s'agit d'un nominalisme incomplet — Sosryko et moi en avons discuté) quand celle de Tolkien s'appuie plus classiquement sur une métaphysique réaliste, comme saint Thomas.
NB : Ellul part ici du Christ comme type, modèle, exemple (= « Seigneur ») de l'homme libre. La théologie thomasienne, sur ce point comme sur d'autres, n'est pas différente : « le principe premier de toutes choses est le Fils de Dieu : “par lui tout a été fait” [Jean 1,3]. [...] Il est le Modèle originel que toutes les créatures imitent [...] » (cité par J-P. Torrell, Saint Thomas en plus simple, p.190, cf. pp.187-193).
Ayant parlé du rapport subcréateur de la liberté à la puissance divine, une formulation spécifiquement tolkienienne, je termine avec un témoignage d'Ellul qui montrera que je ne force pas la connivence :
Je pense que chaque homme a, en effet, un certain pouvoir de créer dans la sphère qui est la sienne, c'est-à-dire inventer ce qui n'existait pas encore et qui mérite d'exister.
La Création n'est pas finie. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme un monde qui est à achever, et l'homme a effectivement ce travail d'achever cette Création de Dieu. [...]
[Cf. le parallèle avec le thème tolkienien de l'achèvement du monde et de l'accomplissement des choses par les Hommes en HoMe X, pp. 36-37, 251, 318, 405.]
La poésie est une création — poiein, créer — et c'est la véritable création de l'homme. S'il se borne à philosopher ou à faire de la théologie comme tel, c'est transmissible intellectuellement, mais ça n'est pas le tout de l'homme. Et, si d'autre part, il se borne à faire de la littérature, ça n'est pas le tout de l'homme non plus. Alors que, dans la poésie, le tout de l'homme transparaît. Et c'est cela qui me donne à la fois la passion de la poésie et le respect pour la poésie — tout ce qui est qualifié de poésie n'étant pas de la poésie (sourire).
Entretiens avec Jacques Ellul, menés par Serge Steyer (1994), 37-38èmes minutes
Hors ligne
#118 08-10-2020 17:47
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Cher Yyr,
pour prolonger le parallèle entre Ellul et Tolkien quant au rôle de la poésie :
Lorsque l'on tient l'objet, il est vain d'en parler, lorsqu'on vit dans la paix et la liberté, pourquoi en ferait-on un objet de discours ? L'existence suffit, et la joie d'en jouir. Quand la plénitude est là, que pourrait-on lui ajouter ? L'amant avec l'objet aimé n'écrit point de poèmes, la poésie naît comme fruit de l'absence et du déchirement. Affirmation verbale de l'amour quand celui-ci n'est plus que fumée, regret, inquiétude, et que prend à la gorge l'incertitude de l'être.
J Ellul, L'Illusion politique, Robert Laffont, 1965, p. 13
Dans La parole humiliée, il oppose le « parler pour ne rien dire » au parler utile d'une part et au parler créateur d'autre part, ce dernier étant ici désigné par lui comme lui « la poésie, le mythe, le récit indispensable de l'historique légendaire » (1981, p. 172). Plus loin, il associe « la parole oubliée, qui est celle de la Création, la parole figée qui est celle de la philosophie, la parole chantée, qui est celle de la poésie », précisant immédiatement après que « l'homme est fait pour fait pour vivre de ces paroles, mais elles lui sont devenues incompréhensibles » (p. 215).
C'est dans son commentaire du livre biblique de L'Ecclésiaste/Qohelet , qu'Ellul développe le lien entre poésie et création :
Il y a, pour moi, une sorte de mystère. Et Je crois qu'il tient au mystère de la création poétique elle-même. Le poète créateur, vrai créateur, forge sa langue en même temps que sa proclamation. Il ne peut y avoir de séparation entre la forme et et le fond. Il n'y a pas une idée à communiquer, qu'il s'agirait ensuite de mettre en vers! Certes non! Nous sommes bien en présence du jaillissement d'une source profonde, et il n y a pas de distinction entre les propriétés de l'eau et le cheminement souterrain qu'elle s'est frayé jusqu'au jour, sa voie, son expression.
Ainsi le poète n'est pas un homme qui pense et qui a un beau style. Il a la parole de sa pensée, celle-ci ne pourrait être exprimée autrement. Il pense au fur et à mesure que les mots eux-mêmes viennent comme évocateurs de cette pensée. [...] Il y a vraiment un poiein - une création.
J. Ellul, La raison d'être, Seuil, 1987, p. 27
Enfin, dans la série d'entretiens publiés l'année de sa mort :
Je n'ai jamais voulu que la poésie soit une évasion du monde dans lequel je vivais, mais, qu'elle me permette de trouver une raison de vivre, malgré tout, et envers et contre tout. La poésie, pour moi, n'est pas une évasion mais une bouffée d'oxygène dans un monde qui nous étouffe.
Patrick Chastenet, Entretiens avec Jacques Ellul, La Table Ronde, 1994, p. 205
Difficile de ne pas penser à plusieurs passages de Faërie, les Lettres ou Mythopoeia dont ces quelques vers :
Je n'emprunte pas votre chemin plat
dénotant ci et ça par ci et ça
votre immuable monde où rien
entre artisan et art ne crée de lien.
La Couronne de Fer ne m'a pas encore
fait plier mon petit sceptre d'or.
*
[...] au Paradis,
derrière l'horizon du Jour infini
[...] le Terre Bénie [..] montrera
that all is as it is, and yet made free
[...]
les têtes des poètes s'embraseront,
leur harpes se mettront au diapason
et dans le tout, chacun fera son choix.
[there each shall choose for ever from the All]
J.R.R. Tolkien, Mythopoeia, in : Faërie et autre textes, p. 311-313
S.
Hors ligne
#119 08-10-2020 18:20
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Whâââ ! :)
& Je me demande comment j'ai pu lire la raison d'être sans relever ce passage !
Merci beaucoup :) :) :)
Hors ligne
#120 12-10-2020 15:23
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Note : À mon sens, Pierre Manent ne part pas vraiment « d'un postulat chrétien » (bien qu'il s'articule assez bien avec lui, on ne trouvera quasi aucune référence théologique, et il proposera une approche de la loi naturelle finalement novatrice) et il reste aussi à un niveau strictement philosophique. Sur ces deux points, on pourrait dire que Jacques Ellul, dans les extraits que j'ai donnés, fait exactement l'inverse (bien que, le fait est assez rare pour être souligné, on y trouve ce « minimum de métaphysique » indispensable). D'où l'ordre dans lequel j'ai donné ces revues, puisque l'auteur qui vient maintenant recouvre ces deux démarches, si je puis dire ;).
R. Brague : la liberté comme accès au Bien
Troisième et dernière récente lecture : Rémi Brague, Des vérité devenues folles : la sagesse du moyen âge au secours des temps modernes, Salvator, 2019.
Dans cet ouvrage, qui rassemble 9 conférences prononcées au cours de la dernière décennie, le spécialiste du moyen âge reprend et développe la thèse chestertonienne d'après laquelle le monde moderne ne peut faire que s'emparer d'idées antécédentes tout en étant incapable de les faire vivre. (*)
Parmi ces idées devenues folles, celle de la liberté, traitée dans son cinquième chapitre, « Liberté et création » (pp.93-109).
Voici ce qu'il en dit dans l'introduction générale de l'ouvrage :
Quant aux idées, vertus ou vérités que j'envisage de relever [...], il me faut d’abord exposer leur généalogie, tout particulièrement en ce qui concerne les biens de l'esprit que l’on considère généralement comme des inventions modernes ou comme ayant dû attendre l’époque moderne pour trouver les conditions de leur épanouissement. Je montrerai que nous aurions une meilleure vision de leur noblesse en retrouvant leurs racines dans l’origine véritable de la culture occidentale, non seulement « Athènes » mais aussi « Jérusalem » : tant la nature (chapitre 4) que la liberté (chapitre 5) s’enracinent dans la Bible hébraïque. Non que leurs concepts s’y trouvent en tant que tels, puisque ces outils ont été forgés par la seule philosophie grecque. Néanmoins, la conception biblique les met en jeu sous une forme narrative.
Rémi Brague, Des vérité devenues folles, p.17
Et voici quelques extraits de son introduction de la question au début du chapitre qui lui est consacré :
Lorsque nous étions de jeunes enfants, nous lancions à la figure de nos parents ou de nos enseignants des : « Je ferai ce que je veux ! » À présent, dégrisés, nous nous rendons compte qu’il s'agissait d'un défi de taille... [...]
En France, comme dans d’autres pays tels que l'Espagne, lorsqu'un taxi est disponible et recherche un client, il porte une sorte de signal sur lequel est indiqué « libre ». Pour beaucoup de nos contemporains, « être libre » c’est l’être à la manière dont le taxi est « libre ». Cela signifie qu’il est vide, qu’il ne va nulle part en particulier, et qu'il peut être emprunté et hélé par quiconque est en mesure de payer. Cette même ambiguïté se retrouve, non seulement dans le cas du concept fixe de liberté, mais aussi dans celui de la notion dynamique de « libération ». Prenons l’expression « libération de la sexualité », supposée résumer l'évolution des mœurs en Occident, notamment dans les années soixante. Quand je l’entends, je ne peux m'empêcher de penser immédiatement à la « libération » de l'énergie nucléaire et à ses conséquences, qu’elles soient positives ou négatives. [...]
Dans le domaine politique, [...] nos institutions [...] sont le plus souvent [...] comprises comme des systèmes permettant à chacun de donner libre cours à ses passions, ce qui équivaut à s'assurer la liberté d’être esclave. [...] le principe directeur de nos sociétés : permettre à chaque individu de vivre le genre de vie dans lequel il n’offrira aucune résistance à ce qui le pousse vers n'importe quelque caprice que ce soit.
Ce que nous confondons avec la liberté, dans ces situations, c’est une flexibilité complète, un abandon total à ce qui nous gouverne, de sorte que nous ne ressentons aucune réticence à céder. Spinoza avait déjà démasqué une telle liberté factice en disant que l’ivrogne pensait qu’il était libre de boire, le moulin à paroles pensait qu’il était libre de bavarder, et ainsi de suite [...].
Ibid., pp.94-95
On retrouve ici ce que nous avons vu, dans le Conte d'Arda, quand la liberté est détachée de son principe subcréateur, là où il s'agirait d'être libre à l'égard du bien : pour paraphraser Rémi Brague, il s'agit de la liberté d'être esclave de l'Anneau.
L'auteur revient alors aux fondements de l'idée occidentale de la liberté, et en particulier à la Bible : « L'idée nouvelle et fondamentale qu'elle introduit est l'idée d'un nouveau commencement radical ». Il en donne trois exemples. D'abord « le nouveau commencement tout court, le nouveau commencement dans l'être, c'est-à-dire l'idée de la création ». Ensuite « autre nouveau commencement, plus accessible à la mémoire humaine, à savoir la création d'un peuple » (à partir et à rebours duquel, dans le développement intellectuel de la vision biblique du monde, l'idée d'une création du monde a probablement été acquise) et, au niveau de l'individu, celui de « la liberté en tant que spontanéité et créativité ». Enfin, « dans la vie morale, un nouveau commencement est apporté par le pardon ». Pour l'auteur, « nous sommes confrontés à trois idées — création, liberté et pardon — qui constituent une sorte d'ensemble d'anneaux borroméens. Je me demande si la liberté est, d'une part, intellectuellement pensable sans l'idée de création et, d'autre part, vivable pour l'être humain sans l'idée du pardon » (ibid., pp.99-102).
L'auteur étudie alors le lien entre ces trois anneaux, c'est-à-dire le lien de celui de la liberté à celui de la création et à celui du pardon (qui est aussi une re-création) :
Liberté et création
La foi en la création rend la liberté compréhensible comme liberté pour le bien. En dépit des catastrophes naturelles et des crimes humains possibles, le monde est l'œuvre d'un Dieu bienveillant [...]. Son objectif ultime est le même que le nôtre. Par conséquent, notre lutte pour le bien n'est pas l'affaire d'un naufragé, seul sur un radeau de sens improvisé flottant sur un océan de non-sens. Cela correspond à la tendance globale du monde, pris à son niveau le plus profond envers et contre toutes les apparences. [...]
[Cf. le parallèle avec HoMe X, p.379 : « ce monde [qui] a des fondations qui sont bonnes, et [qui] tend par nature au bien ».]
Si nous imaginons Dieu, par analogie [avec nous-mêmes], comme un être rationnel, [...] nous trouverons en nous un équivalent de l'acte créateur dont nous supposons la présence en lui. Cet équivalent est notre capacité à initier une série de causes par une décision de notre liberté. La liberté est l'équivalent pour l'homme de l'idée de la création par Dieu. Chaque acte libre est une sorte de création à plus petite échelle. [...] Ce n'est ni un désir aveugle ni un caprice, mais une volonté bienveillante, raisonnable, imprégnée de sagesse et de logos, qui nous a mis au monde, et avec nous tout ce qui a conduis à notre existence [...]. Nous deviendrons, littéralement, les interlocuteurs de Dieu.
Création et pardon
L'expérience chrétienne fondamentale est que nous ne faisons pas ce que nous voulons et ne voulons pas ce que nous faisons. Du point de vue de l'historien des idées, c’est une pensée nouvelle qui a vu le jour chez Augustin. Mais les Pères latins mettent l’accent sur la faiblesse de la volonté, dans le sillage de la lamentation de Paul : « La volonté est présente en moi ; mais comment faire ce qui est bien, je ne le trouve pas » (Romains 7,14-25 ; citation verset 18, ma traduction). On trouve un avant-goût de cette expérience chez les païens comme chez les Juifs: chez les païens comme Ovide, Sénèque ou Épictète ; chez les Juifs, dans un texte de la bibliothèque de Qumran. D’un autre côté, on ne trouve pas de concept clair de la liberté de vouloir dans l’Antiquité préchrétienne. Les mots que nous traduisons par « liberté » — eleutheria, en grec ; libertas, en latin ; comme, d’ailleurs, herụ̄t, en hébreu, et, plus tard, ḥurriya, en arabe — désignent tous le statut social de celui qui n’est pas esclave, et rien de plus.
Cette nouvelle vision chrétienne de la liberté est en quelque sorte complexe. Une religion plus simple, comme l'islam, insiste sur le fait que l'homme est l’esclave de Dieu. Dans la langue arabe courante, les êtres humains sont appelés « les esclaves » (al-‘ibād). En outre, certains juristes affirment que l'objectif de la loi, ou du moins de certains de ses commandements, est « le simple asservissement » (ta ‘abbud maḥḍ) de l'homme. Certes, la miséricorde de Dieu est invoquée dans les sources islamiques et rappelée avec insistance à l'esprit du musulman pieux dans la vie quotidienne. Mais cette miséricorde consiste simplement en la volonté de Dieu de ne pas prendre en compte les péchés et de laver les taches qu’ils laissent derrière eux. La nature originelle de l’homme (fitra) — lequel, soit dit en passant, est censé être essentiellement et éternellement soumis à Dieu, muslim en arabe (Coran 7,172) — reste inaltérée.
Le christianisme est plus compliqué. Il prend au sérieux la liberté de l’homme. Il prend le péché — soit la décision implicite de l'homme de vivre éloigné de Dieu — avec le plus grand sérieux et le respecte. Il se montre donc quelque peu pessimiste, puisqu'il admet que la liberté humaine a été blessée au point de perdre sa capacité de faire le bien qu’elle reconnaît et approuve, et même dont elle rêve, et que la liberté est maintenant trop faible pour désirer réellement ce bien, et encore moins pour le provoquer. Par conséquent, le Dieu des chrétiens a dû monter une opération délicate — que les théologiens nomment « économie du salut » — pour que l’homme devienne capable de guérir sa liberté boiteuse.
Ibid., pp.102-105
Où l'on retrouve :
- le double parallèle entre liberté divine et Création et liberté humaine et subcréation — avec la Création intelligible parce qu'étant œuvre du logos, et donc, par la subcréation, nous devenons « les interlocuteurs de Dieu » ;
- toute la problématique du Marrissement et de la Guérison d'Arda : notre liberté a été blessée et a besoin d'être guérie.
Enfin, Rémi Brague de compléter son tableau en prenant deux exemples du domaine pré-humain pour illustrer la nature de la liberté :
La liberté comme libre croissance
La croissance libre de la plante nous place devant un très intéressant paradoxe. [...] Les plantes sont composées de substances terrestres ou aqueuses (les scientifiques modernes diraient solides ou liquides). En tant que telles, elles sont lourdes par nature. [...] Néanmoins, les plantes se développent vers le haut. Elles plongent leurs racines dans les profondeurs pour pouvoir puiser des matières nutritives dans l'humidité terrestre, mais aussi pour avoir une base solide afin de pouvoir s'élever de plus en plus haut vers le soleil. Cette croissance s’accompagne d’une capacité, voire la présuppose, à résister à la tendance des corps lourds d’atteindre la position la plus basse possible. [...] Or, ce qui est libre croissance pour l'arbre est une contrainte pour chaque partie du bois dont il est fait. La liberté apparaît déjà comme une façon pour les choses de résister aux tendances spontanées des éléments qui les composent. L'exemple de la croissance des végétaux nous montre que nous devons rabaisser, voire sacrifier, certaines dimensions de notre propre être afin de devenir ce que nous sommes vraiment.
[L'auteur ajoute aussi un commentaire qui ne serait pas sans déplaire au professeur : « Il y a une façon subalterne de regarder l’arbre et une façon éminente de le faire. La première le voit comme une masse de bois, voire comme un matériau de construction, la seconde perçoit en lui la vie. »]
La liberté comme libre accès au Bien
Mon second exemple est le phénomène le plus humble pour lequel nous utilisons l'adjectif « libre », à savoir la « chute libre ». Nous pouvons en tirer des enseignements quant à notre propre liberté. Cela a été très clairement vu par Augustin, qui a repris l’image et l’a élevée à la dignité d’une pensée philosophique dans son célèbre « mon poids, c'est mon amour » (pondus meum amor meus). [...]
[L'auteur précise que, si la théorie de la gravité que présuppose cette vision est à présent obsolète, elle peut toujours avoir un sens, non pas comme description de la réalité physique, mais comme métaphore élémentaire]
Or, selon cette théorie, les corps élémentaires recherchent leur place naturelle. [...] Il en va ainsi parce qu’ils veulent arriver là où ils seront pleinement ce qu’ils sont — dans le vocabulaire technique d’Aristote : là où ils atteindront leur « entéléchie », leur complet accomplissement. Ainsi, ils atteignent leur propre bien. J'insiste sur l'adjectif « propre ». À Dieu ne plaise que cette liberté consiste à céder à la contrainte extérieure ou à la tentation intériorisée. La liberté est le déploiement de ce que nous sommes réellement et essentiellement, au cœur de notre être. Atteindre ce noyau n’est pas une tâche facile, mais au contraire, cela demande beaucoup de travail. [...]
L'idée la plus répandue selon laquelle la liberté se réalise par le choix ne suffit pas. La vraie liberté est un choix qui provient de tout notre être, et non d’une faculté qui pourrait soupeser deux options contradictoires et faire pencher la balance en faveur de l’une d'elles. [...] Avoir à choisir n’est pas la forme la plus pure de la liberté. La tentation est récurrente de conférer à l’option « mauvaise » la même dignité qu'à la « bonne ». Pire encore, l’idée que l'expérience du mal pourrait nous permettre de mieux connaître le bien et de le choisir avec plus de détermination. En fait, le mal nous aveugle à sa propre nature. La liberté est ce qui nous permet d'atteindre le Bien.
Ibid., pp.107-109
Rémi Brague synthétise et rassemble, avec l'art de la concision et de la précision qui est le sien, tout ce que nous avons vu de la (vraie) liberté du subcréateur chez Tolkien :
- le sens de la liberté des Incarnés est leur accomplissement, inscrit dans leur nature ;
- la liberté est le moyen pour les créatures rationnelles d'atteindre le Bien ;
- le Bien est la finalité (la « cause finale ») de la liberté.
(autant de propositions interchangeables)
Enfin, n'oubliant pas le moindre détail de notre enquête, le Maître nous précise :
Ici, nous pourrions peut-être rendre justice à une intuition de base du philosophe Henri Bergson : un acte libre est quelque chose de rare ; dans l’ensemble, nous nous mouvons en suivant de vieilles ornières et faisons ce à quoi nous sommes habitués. « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l’expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu’on trouve parfois entre l’œuvre et l’artiste. »
Ibid., p.108
Nous renvoyant à l'inédit tolkienien qui précisait, nous l'avons vu, que « les Eldar estimaient que n'étaient “libres” que les efforts de “volonté” qui étaient dirigés vers un but pleinement conscient (directed to a fully aware purpose) » (avec Gandalf donnant l'exemple d'une créature faisant pleinement usage de son libre arbitre).
Yyr
Devant Rémi Brague, je resterai toute ma vie un padawan — en plus, si vous connaissez son humour (et son goût immodéré pour le calembour), il a vraiment quelque chose de Yoda ;)
__________________________________________________
(*) Je donne ici en note de larges extraits de son introduction, car ils éclairent remarquablement :
à la fois la réflexion de Chesterton (que nous avons régulièrement évoquée sur JRRVF, sans nous y arrêter plus que ça) :
Le romancier, essayiste et homme d'esprit aux multiples facettes, G. K. Chesterton (décédé en 1936) définissait le monde dans lequel nous vivons, «le monde moderne», d’une phrase devenue célèbre, voire galvaudée, dans certains milieux. Selon Chesterton, le monde moderne est « saturé de vieilles vertus chrétiennes virant à la folie » [Orthodoxie 2010 (1908), Climats, Paris, p.50]. Permettez-moi de revenir sur cette définition.
Ce mot d’esprit est souvent repris sous une forme plus générale qui évoque non des « vertus » mais des « idées » ou des « vérités » [:] le libellé authentique mérite correction, car cette dernière formulation, plus générale, s'avère en dernière analyse plus profonde et plus vraie. Chesterton donne, tout de suite après, la cause de cette dérive vers la folie des vertus : « Elles ont viré à la folie parce qu’on les a isolées les unes des autres et qu’elles errent indépendamment dans la solitude ». Mais il ne nous dit pas ce qu'est la folie — étant donné qu’il nous a fourni une réponse très sensée un peu avant dans le même livre : « Le fou est un homme qui a tout perdu sauf sa raison » [ibid., p.32]. Le monde moderne s’enorgueillit de se voir comme tout à fait rationnel. Il se pourrait qu’il se soit mis dans une situation aussi impossible que le pauvre gars décrit par Chesterton. Non en exaltant la raison, mais en agissant à l'encontre d’autres dimensions de l'expérience humaine, la privant ainsi du contexte qui lui donne tout son sens. [...]
J'aimerais à présent poser une question : est-il logique de parler de « vertus chrétiennes », de vertus que nous pouvons sérieusement qualifier avec l’adjectif « chrétiennes », c'est-à-dire de vertus censées être spécifiquement chrétiennes et que l’on ne trouverait pas ailleurs ? Je répondrai : Non.
Vingt ans plus tard, Chesterton a clairement nuancé sa formule trop hâtive et lui a donné une transcription de loin plus heureuse :
Le fait en question est le suivant : le monde moderne — ainsi que les mouvements modernes — vit sur son capital catholique. Il puise et épuise les vérités qui sont encore présentes de par le monde dans le vieux trésor de la chrétienté ; y compris, bien entendu, les nombreuses vérités connues de l'Antiquité païenne et cristallisées dans la chrétienté. Mais le monde moderne ne déclenche pas vraiment de nouveaux enthousiasmes qui lui soient propres. La nouveauté est une affaire de noms et de marques, comme dans la publicité moderne ; à tout autre égard ou presque, la nouveauté est simplement négative. Le monde moderne ne peut pas faire démarrer des choses nouvelles qu’il serait susceptible de porter très loin dans l'avenir. Au contraire, il s'empare de vieilles choses qu’il est absolument incapable de prolonger. Voici les deux traits marquants de nos idéaux moraux modernes. Tout d’abord, ils sont empruntés ou arrachés des mains de l'Antiquité ou du Moyen Âge. Ensuite, ils se fanent très vite dans les mains des Modernes.
[« L’humanisme est-il une religion ? », dans La Chose. Pourquoi je suis catholique, Climats, Paris, 2015, pp.30-31]
Selon Chesterton, et dans le sillage d’auteurs antérieurs tels qu'A. J. Balfour ou Charles Péguy, le monde moderne est fondamentalement parasitaire en ce qu’il exploite des idées prémodernes. On notera l’importante précision selon laquelle l’héritage médiéval incluait « bien sûr, de nombreuses vérités qui étaient connues de l'Antiquité païenne mais qui s'étaient cristallisées en chrétienté ». Le nonchalant « bien sûr » est loin d’aller de soi ou, du moins, d’être largement admis, car beaucoup mettent l'accent sur la rupture radicale entre les ères « païenne » et chrétienne. Le passage entre le monde ancien, et la vision qui lui était liée, et ce qui lui a succédé, période que l’on nomme habituellement « Moyen Âge », peut être dépeint suivant différentes nuances, parmi lesquelles la représentation moderne de la table rase permettant un nouveau départ à partir de zéro.
Quoi qu’il en soit, la thèse fondamentale tient bon — à savoir, que le monde moderne ne conserve pas indemne le capital sur lequel il vit, mais l’altère. Car il tord chacun des éléments qu’il emprunte aux mondes antérieurs dans le but de le faire servir ses propres buts.
Rémi Brague, Des vérités devenues folles, « introduction », pp.9-11
et la propre démarche de Rémi Brague (que nous n'avons que très peu croisé jusqu'ici, alors que la proximité spirituelle avec Tolkien est des plus étroites) :
• Trois idées devenues folles [...]
1. L'idée de création par un Dieu de raison sous-tend l'hypothèse que l'univers matériel peut être compris par les êtres humains. Mais la pensée moderne supprime la référence à un Créateur et coupe le lien entre la raison que l’on suppose présente dans les choses et la raison qui gouverne, ou du moins devrait gouverner, nos actes. Ce déchirement du tissu de la rationalité produit ce que j’appellerai, si vous m'autorisez ce jeu de mots, un logos low cost. Il favorise le retour d’une sorte de sensibilité gnostique. Nous sommes des étrangers dans ce monde ; notre raison n’est pas de même espèce que la raison qui imprègne l’univers matériel. [...]
2. L'idée de providence a été reprise par la pensée moderne, mais « sécularisée » et déformée. L'homme de l'omnibus de Clapham continue de croire au progrès et, bien qu’il doive admettre ses échecs, il est surpris et indigné lorsque les choses tournent mal. Nous croyons, plus ou moins, que nous pouvons faire ce que nous voulons, suivre toutes nos passades, et que l'humanité trouvera une voie pour échapper à long terme aux conséquences désastreuses des politiques que nous suivons. [...]
3. L'idée de réclamer la clémence pour ses fautes et de demander pardon a été conservée, elle est même omniprésente dans nos pays européens. Nous vivons encore dans une « culture de la culpabilité » (Ruth Benedict). On dirait même que nous assistons à un retour des grandes processions de flagellants contemporaines de la peste noire, à la différence près que nous préférons flageller nos ancêtres plutôt que nous-mêmes. En tout cas, il n’y a plus de lien entre le repentir et l’espoir d’être pardonné. Nous obtenons ainsi une sorte de sacrement pervers de confession privé d’absolution. [...]
• Le projet
Le monde moderne interprète les idées qu’il corrompt selon une tonalité particulière, ce que j'ai tenté ailleurs de décrire comme étant le projet de la modernité, ou plutôt la modernité en tant que projet, à l'opposé de ce que j'ai appelé une tâche. Un projet est quelque chose que nous décidons d’entreprendre, alors qu’une tâche nous est confiée par une puissance supérieure : la nature, à la manière païenne, Dieu, à la manière biblique.
Supposons, à présent, que le monde moderne tire ses fondements d’un projet voué à long terme à échouer. Cela par manque de légitimité : le but de cette entreprise, depuis le coup de clairon de Francis Bacon, est d’apporter aux êtres humains beaucoup de bonnes choses, telles que la santé, la connaissance, la liberté, la paix, l'abondance. [...] Mais il y a un hic : la vision moderne du monde reste incapable de nous fournir une explication rationnelle des raisons pour lesquelles il est bon qu’il y ait des êtres humains pour jouir de ces bonnes choses [cf. Brague, Les Ancres dans le ciel : l'infrastructure métaphysique, Seuil, Paris, 2011]. [...] en particulier, qu’en est-il des vertus ou des idées — ou plutôt des vérités — qu’il a menées à la folie ? La thèse que je formule est qu’elles doivent être sauvées de la camisole de force, libérées de l’asile de fous et qu’elles doivent retrouver leur santé mentale et leur dignité — une dignité qui est prémoderne par nature, c'est-à-dire enracinée dans la vision du monde ancienne et médiévale.
• Retour au Moyen Âge ?
J'ai émis, ailleurs, la thèse assez provocatrice que ce dont nous avions besoin était un nouveau Moyen Âge [Cf. Brague, Le Propre de l'homme : sur une légitimité menacée, Flammarion, Paris, 2015 (2013), pp.186 s.]. Ce que je voulais dire par là n’a bien entendu rien à voir avec l'image complètement négative d’« âge des ténèbres », car cette image provient elle-même de la guerre de propagande menée par le projet moderne en quête de sa propre légitimité et luttant, pour elle, contre un épouvantail [Cf. Brague, Au moyen du Moyen Âge : philosophies médiévales en chrétienté, judaïsme et islam, Flammarion, Paris, 2008 (2006), pp.58-61]. L'ère médiévale, telle que la recherche historique nous permet de mieux la connaître, a été une période durant laquelle richesse et misère, innovation et conservation, lumière et obscurcissement, bonheur et détresse étaient inextricablement mêlés. Soit dit en passant, c’est là une caractéristique partagée par toutes les périodes que nous connaissons au cours de l’histoire, y compris par celle dans laquelle nous devons vivre aujourd’hui. [...]
La fable antique des deux besaces que nous portons, l’une sur la poitrine et l’autre sur le dos, a bien saisi le problème [Ésope, fable n°303]. Il nous est facile de remarquer assez clairement la stupidité des gens qui nous ont précédés, alors que nos défauts, qui nous restent inconnus, pourraient bien faire de nous la risée des générations à venir. [...] Je voudrais plutôt renverser la perspective et plaider pour une sorte de retour à une sorte de Moyen Âge. J'ai pris la précaution de dire à deux reprises « une sorte de », afin d'éviter les malentendus et les caricatures.
[...] L’intention de cet ouvrage est celle-ci : sauver les vertus, les idées ou les vérités que le projet moderne a conduites à la folie, en retrouvant la forme prémoderne de ces bonnes choses. Ce qui me pousse à me lancer dans cette entreprise n’est pas un goût d’antiquaire pour le passé, encore moins un esprit nostalgique ou réactionnaire. Laissons les morts enterrer les morts. Au lieu de préparer ce retour nécessaire par nostalgie du passé, je le fais, tout au contraire, parce que je suppose que la forme prémoderne de certaines idées fondamentales pourrait s'avérer plus stable que leur perversion moderne, donc plus riche d’avenir et mieux à même de nourrir notre espérance.
Ibid., pp.11-16
Hors ligne
#121 13-10-2020 05:51
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
Dans La parole humiliée, il [Jacques Ellul] oppose le « parler pour ne rien dire » au parler utile d'une part et au parler créateur d'autre part, ce dernier étant ici désigné par lui comme lui « la poésie, le mythe, le récit indispensable de l'historique légendaire » (1981, p. 172). Plus loin, il associe « la parole oubliée, qui est celle de la Création, la parole figée qui est celle de la philosophie, la parole chantée, qui est celle de la poésie », précisant immédiatement après que « l'homme est fait pour fait pour vivre de ces paroles, mais elles lui sont devenues incompréhensibles » (p. 215).
Si je puis me permettre, la parole oubliée, si j'en crois mon exemplaire du livre d'Ellul en question, est ici celle de la création... sans majuscule, même si, dans l'esprit de l'auteur, cela pouvait éventuellement revenir un peu au même quant au fond du propos de l'ouvrage...
B.
P.S. : le temps me manque pour participer, mais j'avoue être assez désespéré par toutes ces critiques plus ou moins systématiques de la « Modernité » partagées ici à des degrés divers, a fortiori sous couvert de parler de la liberté, de la vie, du bien, de la création, de poésie ou d'émancipation... Si Tolkien, tout antimoderne qu'il ait été, ne doit renvoyer fondamentalement qu'à ce genre de visions du réel et des êtres humains, c'est triste.
Hors ligne
#122 13-10-2020 11:48
- Elendil
- Lieu : Velaux
- Inscription : 2008
- Messages : 1 200
Re : La question du Libre Arbitre
P.S. : le temps me manque pour participer, mais j'avoue être assez désespéré par toutes ces critiques plus ou moins systématiques de la « Modernité » partagées ici à des degrés divers, a fortiori sous couvert de parler de la liberté, de la vie, du bien, de la création, de poésie ou d'émancipation... Si Tolkien, tout antimoderne qu'il ait été, ne doit renvoyer fondamentalement qu'à ce genre de visions du réel et des êtres humains, c'est triste.
Allons donc, Hyarion, tu sais fort bien que les discussions dont tu parles ne représentent qu'une partie de l'activité de JRRVF et ne sont certes pas majoritaires dans les études tolkieniennes, que ce soit en France ou à l'étranger. Sans doute même prennent-elles plus de place ici du fait même qu'Yyr est actuellement un des contributeurs les plus actifs, mais on ne peut pas le lui reprocher. Que ne nous distilles-tu pas les résultats préliminaires de tes propres recherches, qui portent sur des sujets bien différents ?
J'avoue, moi, avoir de la tristesse à lire ta propre critique. Comme si finalement il était désespérant qu'il soit seulement concevable de problématiser la Modernité, de questionner ses fondements ou les directions qu'a pris son développement... en somme comme s'il ne fallait pas seulement que le Progrès avec majuscule règne sur les corps (ce qui est indéniable dans nos pays, à l'exception possible des monastères et des pèlerins sur le chemin de Compostelle  ), mais sur les âmes ? Il est indéniable que les progrès techniques ont permis une spectaculaire amélioration de la sécurité alimentaire pour le plus grand nombre, ainsi qu'une amélioration conséquente du niveau et de l'espérance de vie. Pour autant, ils n'ont pas eu que des conséquences heureuses, comme les deux derniers siècles le montrent amplement. On pourrait même dire qu'aujourd'hui les progrès techniques sont les meilleurs alliés des dictatures : la Chine tient plus fermement son peuple que l'URSS jadis les peuples de l'empire russe. Le questionnement me semble donc légitime, notamment sur les plans que tu évoques, dont la compréhension est aujourd'hui inextricablement liée à celle de la Modernité.
), mais sur les âmes ? Il est indéniable que les progrès techniques ont permis une spectaculaire amélioration de la sécurité alimentaire pour le plus grand nombre, ainsi qu'une amélioration conséquente du niveau et de l'espérance de vie. Pour autant, ils n'ont pas eu que des conséquences heureuses, comme les deux derniers siècles le montrent amplement. On pourrait même dire qu'aujourd'hui les progrès techniques sont les meilleurs alliés des dictatures : la Chine tient plus fermement son peuple que l'URSS jadis les peuples de l'empire russe. Le questionnement me semble donc légitime, notamment sur les plans que tu évoques, dont la compréhension est aujourd'hui inextricablement liée à celle de la Modernité.
Après tout, concernant l'évolution de la société moderne, Tolkien était sans doute beaucoup plus pessimiste que nous tous. Pessimiste, mais pas désespéré... 
E.
Hors ligne
#123 13-10-2020 17:52
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Bien, je nous invite à poursuivre ailleurs cette digression, si la commande 'répondre' devait se révéler trop tentante ;).
Hors ligne
#124 14-10-2020 21:59
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Merci Yyr pour cette nouvelle “fiche” (ah!ah!) de lecture :)
Si je puis me permettre, la parole oubliée, si j'en crois mon exemplaire du livre d'Ellul en question, est ici celle de la création... sans majuscule, même si, dans l'esprit de l'auteur, cela pouvait éventuellement revenir un peu au même quant au fond du propos de l'ouvrage...
Ellul n'est pas très rigoureux dans l'usage des majuscules et pour avoir travaillé sur les manuscrits de l'auteur, je confirme l'ambiguïté à la source. Pour la citation proprement dite, tu as raison et je me suis permis de corriger le texte publié car non seulement Ellul signifie bien cela ailleurs déjà (cf. p. 57 : « Dieu créant par la Parole, c'est Dieu non pas hors de sa création, mais Dieu avec elle » ; « Comme au début de la création, quand Dieu dit [...] » ; p. 59 : « Adam s'affirme comme le chef de la création lorsque Dieu fait défiler devant lui tous les animaux »; p. 60,61, 66, etc. etc.) mais de plus Ellul fait ici référence à une étude Nelly Viallaniex sur Kierkagaard (cf. « le chant du monde » mentionné à la 3e phrase suivante) ainsi qu'à un psaume (Ps 19) lorsqu'il commente immédiatement après la citation :
La création tout entière parle, mais l'homme plutôt que d'écouter cette parole veut voir le secret de cette création, voir, qui provoque la demande scientifique.
J. Ellul, La Parole humiliée, p. 215
En fait, cette citation de La Parole Humiliée est un résumé d'un développement écrit pour la préface d'un livre de Nelly Viallaneix sur Kierkegaard. Ellul y reprenait déjà la trilogie des paroles captives dans les mêmes termes mais, cette fois, l'auteur ou l'éditeur n'avait pas oublié la majuscule :
Parole « oubliée », celle de la Création, que l'homme noie dans le vacarme de la vie (moderne), de la politique et de la presse. Mais on peut, dans le silence retrouvé, entendre de nouveau la symphonie du monde. Parole « figée » : Kierkegaard se livre à une étude « prophétique » de la communication, du langage et du mystère de la parole ; il se trouve en présence d'une confusion qui ne peut être dépassée que par une dialectique nouvelle, anti-hégélienne : la « dialectique qualitative ». Parole « chantée », enfin : c'est la poésie, qui est une fête, mais qui ne trouve son sens que dans le passage du poète au témoin. Ainsi tout peut être « repris », tout peut être ré-entendu. Il ne faut pas se hâter de proclamer que l'univers est condamné, que le péché règne, que le passé est une fatalité. Une autre vie s'ouvre que celle imaginée par l'homme. Kierkegaard, à la lumière unique de la Parole de Dieu, ne condamne pas les paroles d'homme, ou le chant de la Création, il en discerne la misère. La misère et non le mal.
J. Ellul, Préface à N. Viallaneix, Ecoute, Kierkegaard, t. I, Cerf, 1979, p. XV-XVI.
S.
Hors ligne
#125 17-10-2020 02:59
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
L'usage aléatoire des majuscules chez Ellul peut expliquer, en effet, l'ambiguïté (relative) ressentie à la lecture.
Merci pour tes précisions éclairées, Sosryko.
B.
P.S.: pour mémoire, ma réponse à Elendil se trouve dans le fuseau précédemment indiqué par Yyr.
Hors ligne
#126 16-12-2020 22:21
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Merci pour ce très intéressant partage. Je ne tenterai pas d'en faire une présentation aussi détaillée, mais l'analyse de Pierre Manent me semble très complémentaire à celle de Pierre-André Taguieff dans son dernier ouvrage, l’Émancipation promise (éd. du Cerf, 2019) [où il] déconstruit, précisément, l'idée d'émancipation aujourd'hui conçue comme l'alpha et l'oméga de l'action politique. Le livre est d'une érudition rare, ce qui rend le propos parfois difficile à suivre dans les premiers chapitres, mais l'analyse se met en place progressivement et la synthèse est remarquable.
J'ai pu lire l'ouvrage en question.
Hé bé ! Il n'y va pas avec le dos de la cuillère !! — mais comme il n'est pas chrétien, je suppose que c'est permis ;).
P-A. Taguieff : la critique de l'émancipation
L'Émancipation promise est un ouvrage très enrichissant, pour moi surtout sur la part du Marxisme dans l'histoire de « la grande tâche de notre temps [:] l'émancipation » (Heinrich Heine, cité p.9). L'analyse de l'auteur recoupe en effet notre sujet, en ce qu'il dissèque l'idée de l'émancipation des Modernes ayant viré à ce qu'il nomme l'émancipationnsime : c-à-d. « son idéologisation », « sa mythologisation », empreintes « d'utopisme et de messianisme » : « refus des déterminismes », « abolition des limites », « suppression des liens », « rejet des héritages », « rupture avec le passé » ... et, finalement, la volonté de « faire table rase » de ce qui nous précède, une volonté qui explose dans la Terreur révolutionnaire et le Totalitarisme, notamment marxiste : « création d'un monde nouveau grâce à une re-création de l'homme ». Soit la forme qu'a prise dans la Modernité ce que nous avons appelé la liberté d'indifférence.
On peut résumer la compréhension de la liberté et de son gauchissement par l'auteur à l'aide de quelques morceaux choisis (et leurs échos à G.K. Chesterton et à Bombadil ;)) :
« Plus une chose est noble dans sa perfection, dit un écrivain hébreu, plus elle est horrible dans sa décomposition. » (Mendelssohn)
L'émancipation est aujourd'hui une idée devenue folle.
Lorsque l'impératif d'émancipation perd toute mesure et se laisse saisir par le goût de l'absolu, il dérive vers l'idéal chimérique de l'autonomie absolue. Surgit le rêve d'une auto-création, enveloppant le désir d'être cause de soi. De là, la tentation de s'engager dans la poursuite de l'impossible même : ne rien devoir à personne. Ce qui conduit à ériger l'ingratitude en vertu cardinale.
L'idéal serait [...] de pousser le « plus que nous le pouvons le souci de ne subordonner à rien ce que nous sommes » (Bataille). Soit l'impossible même.
« Pareils à ces bouffons de Dostoïevski qui se vantent de tout, montent aux étoiles et finissent par étaler leur honte dans le premier lieu public, nous manquons seulement de la fierté de l'homme qui est fidélité à ses limites, amour clairvoyant de sa condition. » (Camus) [...] Face aux bricolages précieux des nouveaux prêcheurs d'« émancipation », seul un grand rire serait véritablement émancipateur.
On peut voir dans le progrès, en tant qu'objet de désir, une « nostalgie renversée, faussée et viciée, tendue vers le futur », selon la formule de Cioran. Quant à la foi dans le Progrès, fondement de l'utopie technicienne des Modernes, ces fervents d'un avenir peint en rose, elle enveloppe le projet de « refaire l'Éden avec les moyens de la Chute ». [...] Chez les Modernes, la quête d'un nouvel Éden est indissociable d'une émancipation absolue.
Camus avait aperçu l'imposture de ces professeurs d'optimisme : « Il n'a pas été dit que le bonheur soit à toute force inséparable de l'optimisme. Il est lié à l'amour — ce qui n'est pas la même chose. » (Camus)
P-A. Taguieff, L'émancipation promise, le Cerf, 2019, pp.9,27,81-82,307,299,311-314,324
Cette quête de l'émancipation, reliée au projet moderne, où l'on concevra le règne de la liberté comme celui de la « domination », du « contrôle » ...
« Prométhée a été l'émancipateur primitif, et toute l'énergie libre a procédé de lui. » (Michelet) [...] « La philosophie ne s'en cache pas. Elle fait sienne la profession de foi de Prométhée : “en un mot, j'ai de la haine pour tous les dieux” [Eschyle, Prométhée enchaîné, 975]. [...] Dans le calendrier philosophique, Prométhée occupe le premier rang parmi les saints et les martyrs. » (Marx)
« Le cercle des conditions de vie entourant l'homme, qui jusqu'ici dominait l'homme, passe maintenant sous la domination et le contrôle des hommes qui, pour la première fois, deviennent les maîtres réels et conscients de la nature, parce que et en tant que maîtres de leur propre vie en société. [...] La vie en société propre aux hommes qui, jusqu'ici, se dressait devant eux comme octroyée par la nature et l'histoire, deviennent maintenant leur acte propre et libre. [...] C'est le bond de l'humanité du règne de la nécessité dans le règne de la liberté. » (Engels)
La grande menace pesant sur tout individu humain, c'est qu'il soit dépossédé du droit de « contrôler sa propre vie » (Chomsky). On peut dire la même chose en employant le mot « autonomie » : le pire, pour toute personne, c'est s'être dépouillée de sa capacité d'autonomie.
Ibid., pp.151,270,275
... fut très tôt comprise comme un projet total et absolu visant, en fin de compte, un « remodelage [...] de l'espèce humaine » :
« Le genre humain, qui a cessé de ramper devant Dieu, le Tsar et le Capital, devrait-il capituler devant les lois obscures de l'hérédité et de la sélection sexuelle aveugle ? L'homme devenu libre [...] se haussera à un niveau plus élevé et créera un type biologique et social supérieur, un surhomme, si vous voulez. » (Trotski) [...] Dans ces pages de Trotski, l'utopie révolutionnaire de l'émancipation semble se confondre avec le mythe de la régénération, du remodelage, de la re-fabrication de l'espèce humaine. L'humanité doit être re-créée pour être améliorée ou perfectionnée.
Ibid., pp.265-266
Mais, et ses partisans les plus lucides en étaient conscients, la dynamique d'une telle liberté est, par définition, destructrice, morgothienne :
L'utopie de l'homme émancipé présuppose un imaginaire de la radicalité révolutionnaire reposant sur le refus des médiations, voire une diabolisation de ces dernières. De ce rejet [...] dériv[e] une conception « spontanéiste » de la liberté [...].
[Une telle utopie] ne peut « produire ni une œuvre positive ni une opération positive », car le positif est toujours quelque chose de déterminé et de différencié : « il ne lui reste que l'opération négative ; elle est seulement la furie de la destruction ». [...] Vouloir élever la « liberté absolue sur le trône du monde », c'est en effet rester sur le plan de l'universel abstrait. Or, l'« unique œuvre et opération [d'une telle liberté] est [...] la mort » [...]. (Hegel)
Ibid., pp.207,163-164
Soit l'antithèse de la liberté comme subcréation.
Pour l'auteur, cette déclinaison de la liberté d'indifférence repose sur une « illusion spéculative devenue évidence fondatrice » :
Chez les Modernes, l'illusion spéculative devenue évidence fondatrice tient à la conjonction, sous divers modes, de la révolte inconditionnée et de l'émancipation indéterminée, sans limites. [...] Pour tenter de concevoir cette illusion récurrente, il faut se représenter une temporalité spécifique, orientée par un changement sans fin. L'émancipationnisme [...] provient d'une transposition dans l'espace idéologico-politique moderne des croyances et des normes constitutives d'une sommaire métaphysique mobiliste, opposant le changement à l'ordre stable comme le bien au mal. [...] On en trouve la théorisation dans l'utopie de la « révolution permanente » et sans fin.
C'est pourquoi cette question n'intéresse pas seulement la logique de l'épistémologie, mais aussi la philosophie politique [:] « Dans les révolutions, l'abstraction essaie de se soulever contre le concret. Aussi la faillite est-elle consubstantielle à toute révolution. » (Gasset)
Ibid., pp.318,338
That's all folk :)
Yyr
Hors ligne
#127 17-12-2020 10:59
- Elendil
- Lieu : Velaux
- Inscription : 2008
- Messages : 1 200
Re : La question du Libre Arbitre
Merci pour ces quelques éléments glanés dans un livre très riche. Il manque à mon goût ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans le livre : le parallèle philosophique injustifié qui se met progressivement en place entre l'émancipation politique concrète des Juifs dans les pays d'Europe de l'Ouest, et l'idée utopique d'une émancipation généralisée du genre humain dans tous les domaines. C'est là où Taguieff se montre le plus intéressant, notamment lorsqu'il analyse la gestation de cette utopie chez le jeune Marx et la façon dont elle s'articule chez lui avec un antisémitisme d'une violence que je ne soupçonnais pas. Cela vient notamment expliquer les raisons de la persécution ultérieure des Juifs après la Révolution d'Octobre en Russie, ainsi que le concept d'émancipation de l'humanité comme arrachement à son histoire et à ses idéaux antérieurs.
E.
Hors ligne
#128 19-12-2020 00:45
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Tout-à-fait d'accord avec toi : c'est aussi le plus intéressant et le plus enrichissant selon moi.
J'admets n'avoir pas eu la force d'en rendre compte — et je craignais aussi partir dans le HS ...
Hors ligne
#129 31-12-2020 23:48
- Yyr
- Lieu : Reims
- Inscription : 2001
- Messages : 3 299
Re : La question du Libre Arbitre
Conclusion : sub specie æternitatis — à l'aune de l'éternité
En guise de conclusion (conclusion de ma recherche, pas de la discussion ;)), je vous propose une lecture suivie de la première partie de la Lettre n°64 (Lettres, pp.114-115). Dans ma recherche, j'avais relevé son occurrence de free will, sans lui trouver de place dans les développements qui précèdent. Il me semble, en fait, qu'elle permet de récapituler ces derniers.
20 Northmoor Road, Oxford
Mon très cher petit,
J'ai décidé de renvoyer un autre aérogramme, non un airgraph, dans l'espoir de pouvoir ainsi te remonter un peu plus le moral. [...] Tu me manques vraiment beaucoup, et je trouve vraiment tout cela extrêmement dur à supporter, pour moi-même et pour toi. Le gâchis complet et stupide causé par la guerre, non seulement matériel mais moral et spirituel, est tellement consternant pour ceux qui doivent l'endurer. Et l’a toujours été (malgré les poètes), et le sera toujours (malgré les propagandistes) — non bien sûr qu’il n’ait été, qu'il ne soit et qu'il ne sera nécessaire d’y être confronté dans un monde mauvais.
Mais la mémoire humaine est si courte et si éphémères sont ses générations que dans seulement 30 ans environ il y aura peu ou pas de gens à posséder cette expérience directe qui seule touche vraiment le cœur. C’est le chat échaudé qui nous en apprend le plus sur le feu.
Je suis quelquefois horrifié à la pensée de la somme de détresse humaine qui existe actuellement dans le monde entier : les millions de personnes séparées, tourmentées, gaspillant leur vie sans aucun bénéfice — sans parler de la torture, de la douleur, de la mort, du deuil, de l'injustice. Si l’angoisse était visible, pratiquement la totalité de cette planète plongée dans les ténèbres serait enveloppée dans une dense vapeur sombre, cachée à la vue stupéfaite des cieux !
Le « monde mauvais » est un thème tolkienien récurrent, celui d'un monde soumis au Mal, à la Mort et à la Machine, qui reprend celui, plus largement biblique, d'un monde gouverné par la Chute : « la faiblesse fatale de toute chose bonne par nature dans un monde mauvais, corrompu et contre nature » (Lettres, p.98). Un monde où, de façon « nécessaire », nous sommes confrontés à un « gâchis [—] matériel [,] moral et spirituel ». Certes, Tolkien parle ici du « gâchis complet et stupide » causé « par la guerre », mais on sait que, pour lui, « il existe d'autres sortes de maux tout aussi néfastes », dont la guerre ne constitue que « l'explosion », A&H HS n°2, p.44). Cette explosion ne fait que « multiplie[r] la bêtise par 3 et son pouvoir par lui-même : ainsi nos jours précieux sont gouvernés par (3x)² avec x = l'obtusité humaine habituelle » (Lettres, p.111).
Notre terre ainsi « plongée dans les ténèbres », décrite comme enveloppée dans « une dense vapeur sombre (a dense dark vapour) », ne peut manquer de renvoyer aux « immenses fumées et vapeurs (vast smokes and vapours) » d'Angband qui « souill[èrent] la lumière des premiers matins du monde » (Silm, chap.13) comme à « l'ombre pesante » venue du Mordor en « dévorant la lumière » (SdA, V.4), ainsi qu'à celles, plus effrayantes encore parce que tissées de Vide même, des « noires vapeurs (black vapours) » d'Ungoliant faites de « pure Obscurité (an Unlight) où les choses semblaient ne plus être » (Silm, chap.8), tout comme la « vapeur noire (black vapour) » façonnée par son rejeton à partir « des ténèbres mêmes (of veritable darkness itself) » « aveugl[ait] non seulement les yeux mais encore l'esprit, si bien que le souvenir des formes et des couleurs, et de toute lumière visible, en était effacé [—] la nuit avait toujours été, et elle serait toujours : la nuit était tout » (SdA IV.9).
Ici comme ailleurs, les représentations du monde primaire appellent celles du monde secondaire pour s'y associer sous la plume d'un Tolkien qui, au soir de sa vie, parlera de notre monde comme « ce Royaume Déchu d'Arda, où l'on vénère les serviteurs de Morgoth » (Lettres, p.582).
Et les fruits de tout cela seront principalement funestes — d’un point de vue historique. Mais l’aspect historique n’est pas, bien sûr, le seul. Toute chose et tout acte a une valeur en soi, en dehors de ses « causes » et de ses « effets ». Aucun homme ne peut évaluer ce qui est réellement en train de se passer en ce moment sub specie æternitatis.
Il ne me paraît pas exagéré de considérer que tout Tolkien est là.
Plus haut, Tolkien disait que « cette expérience directe » du Mal « touche vraiment le cœur ». S'il dépasse le cadre de cette discussion (et les moyens disponibles) d'en faire le tour, résumons-le sommairement : l'expérience du cœur est, précisément, au cœur, voire le cœur, de la mythopoésie tolkienienne (voire de la théorie du langage de Tolkien). La même expression revient quelques semaines plus tard. En contrepoint de « la vacuité de toute machine » et de « la Chute », qui s'associent pour détourner nos désirs de subcréation « vers un Mal nouveau et horrible », le père et le fils partagent leurs observations des bouvreuils et des martinets, qui eux « touchent au cœur des choses » (Lettres, p.131). Le cœur de l'homme et le cœur des choses ont une valeur située au-delà de « l'aspect historique » — « l’apparente Anankê de notre monde » (p.149). Eh bien, la mythopoésie tolkienienne n'est rien d'autre que cette tentative d'y accéder : la mythologie, pour Tolkien, est cette tentative, par le langage et la poésie, de mise en rapport des choses et des actes avec leur « valeur en soi », c'est-à-dire « sub specie æternitatis » — à l'aune de l'éternité.
Confère le sujet serpent de mer de l'allégorie chez Tolkien : d'une certaine façon, Tolkien ne cesse d'être « allégorique ». Ainsi lorsque, à la même époque, il partage à Christopher que « nous essayons de vaincre Sauron avec l'Anneau », si bien que « le prix à payer est, comme tu le sais, de faire de nouveaux Sauron, et de lentement transformer en Orques les Hommes et les Elfes », il précise aussitôt : « non pas que dans la réalité les choses soient aussi nettes que dans une histoire » (Lettres, p.118). Ainsi du SdA : il « est né de “l'allégorie” et ses guerres sont toujours dérivées de la “guerre intérieure” de l'allégorie dans laquelle le Bien est d'un côté et les divers modes du mal de l'autre » tandis que « dans la réalité (extérieure) les hommes se trouvent des deux côtés — ce qui entraîne une alliance hétéroclite d'Orques, de bêtes, de démons, d'hommes ordinaires honnêtes par nature, et d'anges » (p.123). Ce langage mythique, allégorique dans un certain sens, permet d'atteindre le cœur des choses. Par ce langage, Tolkien s'est mis « à transformer [s]on expérience en des formes et symboles autres à travers Morgoth, les Orques et l'Eldalie (représentant la beauté et la grâce de la vie et de l'artisanat) et ainsi de suite » (p.127) : « le désir d'exprimer [s]on sentiment sur le Bien, le Mal, le juste et l'infâme [...] a engendré Morgoth et l'Histoire des Gnomes » (p.118).
Au sein de cette mythologie, noter le statut intermédiaire du SdA dont les protagonistes « vivaient à la lisière du mythe ; ou plutôt, cette histoire expose le passage de “mythe” à l'Histoire ou à la Domination des Hommes ». Et lorsque l'Ombre surgira de nouveau, « plus jamais (sauf avant la Fin) un démon maléfique ne sera physiquement incarné sous la forme d'un ennemi ; il dirigera des Hommes et le réseau complexe des êtres à demi malfaisants et des bons faillibles, et laissera un doute brumeux quant au choix d'un camp, autant de situations qu'il aime tout particulièrement [...] ; ce sera, et c'est déjà, notre sort le plus dangereux » (Lettres, p.294).
D'où nombre de contresens bien connus, dès lors que l'on passe à côté de ce rapport mythopoétique entre le monde primaire et le monde secondaire : comme sur la dimension chrétienne (l'extrait Lettres p.294 se poursuit en redisant, en écho à Lettres p.246, que la vérité religieuse ne peut apparaître comme dans notre réalité primaire puisqu'elle est déjà dans le symbolisme de la réalité secondaire), le manichéisme (Vinyamar avait bien saisi la problématique) ou la sexualité (avec ce récent contrepoint) — cf. les interviews récemment traduites.
Tout ce que nous savons, et cela dans une large mesure par l’expérience directe, c'est que le Mal travaille avec un pouvoir étendu et avec un succès perpétuel — en vain : car ne faisant toujours que préparer le sol pour qu'un Bien inattendu y pousse. Il en est ainsi en général, et il en est ainsi dans nos vies. [...]
Mais il reste encore quelque espoir que les choses s’arrangent pour nous, même sur le plan temporel, dans la miséricorde de Dieu. Et bien que nous ayons besoin de tout le courage et le cran humains qui nous sont innés (la vaste somme de courage et d'endurance existant chez l’homme est formidable, tu ne crois pas ?) et de toute notre foi religieuse pour faire face au Mal qui peut nous arriver (comme aux autres, si Dieu le veut), nous pouvons quand même prier et espérer. Ce que je fais.
Le paradoxe entre le « pouvoir étendu [et le] succès perpétuel » du Mal d'un côté, et sa « vanité » de l'autre (cf. ailleurs le contraste entre « le poids déprimant de l'éternelle iniquité humaine » et « en même temps, [le fait] que le Bien existe toujours », Lettres, pp.120-121), fait écho à cette présentation mémorable de Tolkien à Amy Ronald : « je suis chrétien, et à vrai dire un catholique [romain], si bien que je ne m’attends pas à ce que “l’Histoire” soit autre chose qu’une “longue défaite” — même si elle comporte (et dans une légende peut les contenir de manière plus claire et émouvante) quelques exemples ou aperçus de la victoire ultime » (Lettres, p.362). Nous retrouvons ce que nous avons développé dans la présente discussion quant à providence (ou la grâce) à l'œuvre dans le Légendaire et gouvernée par la Pitié à la racine de la liberté et de la puissance du Créateur, i.e. « dans la Miséricorde de Dieu » : « on ne peut jouer un thème qui ne prend pas sa source ultime en moi, [et] nul ne peut changer la musique malgré moi. Celui qui le tente n'est que mon instrument pour concevoir des merveilles qu'il n'aurait pas imaginées lui-même ! » (SCLI, p.10, trad. modifiée). Cf. Manwë : « Eru demeure le Seigneur de Tout, et meut toutes les voies de ses créatures, même la malice du Marrisseur, en ses ultimes desseins » (HoMe X, p.241), et le Commentaire de l'Athrabeth : le « Drame [qui se joue] dépend de Son dessein et de Sa volonté quant à son commencement et à son déroulement, en chacun de ses détails et de ses instants » (HoMe X, p.335) — Dieu demeure souverain.
En attendant, ici-bas, dans notre « nature tout entière enchaînée dans la cause à effet matérielle, la chaîne de la mort » (Lettres, p.148), il nous reste à « faire face au Mal », avec « courage », « endurance » et « foi », et, pour ceux qui le peuvent, à « prier et espérer ». Les héros du Conte d'Arda, eux aussi, tendus entre la souffrance et l’espérance, depuis l’Ainulindalë jusqu’à l’Athrabeth en passant par le Seigneur des Anneaux, continuent « à espérer et à peiner » (SdA, VI.3, p.1303). Contrairement à la « longue défaite » et au « succès perpétuel [du] Mal », dont nous faisons « l'expérience directe », la « victoire Ultime » du « Bien inattendu » est attendue dans une « espérance » fondée dans « notre nature [et] notre état primordial [:] si nous sommes effectivement les Eruhin, les Enfants de l’Unique, alors [...] de l’ensemble de Ses desseins, l’aboutissement doit être pour la joie de Ses Enfants » (HoMe X, p.320) — ou, comme les Valar pouvaient y encourager les Númenóréens : « espérez [...] qu'à la fin, même les moindres de vos désirs s'épanouiront (shall have fruit) [puisque] l'amour d'Arda fut semé en vos cœurs par Ilúvatar ; or Il ne sème pas sans raison (to no purpose) » (SCLI, pp.263-264, trad. modifiée).
Autrement dit, le thème tolkienien du « Monde mauvais » est indissociable de celui du « Salut » (cf. plus loin, et Lettres, pp.332,357). De même, dans le Légendaire, le thème du Marrissement d'Arda est lié à celui de la Guérison d’Arda (cf. « Estel Eruhínion : de la Chute et de l'Espérance dans le Conte d'Arda »). C'est ce que les fonctions du Conte de Fées — évasion, consolation et recouvrement — peuvent aider à percevoir (cf. « Avant-propos : Till the world is mended »).
Et tu as été un présent si spécial pour moi, à une période de chagrin et de souffrance morale, et ton amour, se déployant immédiatement, presque au moment où tu es né, m'a prédit comme si tu m'avais parlé que je serais toujours consolé par la certitude que cela ne connaîtra jamais de fin. Il est probable que nous (we shall) nous retrouverons, sous l'œil de Dieu, « tout entiers et unis » (in hale and unity), dans peu de temps, très cher petit ; et il est certain que nous avons un lien spécial qui durera au-delà de cette vie
Après qu'aient été pour ainsi dire récapitulés les principaux thèmes tolkieniens, et juste avant qu'apparaisse la mention du libre arbitre, voici le « lien spécial » entre J.R.R. et Christopher Tolkien. Il ne s'agit pas tant du lien de l'amour du « fæder suna his ágnum, þám gingstan nalles unléofestan — père à son propre fils, le dernier-né [mais] en aucune façon le moins aimé » (Lettres, p.103) (*) que, me semble-t-il, d'une très profonde communion d'esprit et de sensibilité entre eux. Cette communion spirituelle, particulièrement intense pendant l'engagement de Christopher en Afrique du Sud entre fin 1943 et début 1945 au vu des Lettres, devient même à cette époque comme le creuset de la mythopoésie tolkienienne.
Que cette communion soit intense, il suffit pour s'en convaincre de lire le père le répéter à son fils : « tu me manques » (Lettres, pp.107,111,114,135). Non seulement parce qu'il voudrait avoir encore auprès de lui « mon secrétaire et critique », mais aussi parce que « nous sommes si proches (so akin) » (p.118), proches au point que la vie du père, à cette époque, tourne autour des lettres du fils (p.127), qu'il va à l'église pour lui (p.119), et qu'il va jusqu'à lui confier : « j'ai toujours une curieuse sensation de réminiscence dès qu'il est question de l'Afrique, ce qui m'émeut toujours profondément. Il est vraiment étrange que toi, mon très cher petit, tu sois retourné (sic) là-bas » (p.123).
Cette communion, qui pourrait être décrite au moyen de cette image des Inklings : « cette fête de l'esprit et de cet échange entre âmes » (Lettres, p.150), est (au moins) triple. Elle est religieuse, le partage de la foi revenant régulièrement entre eux, avec le discernement des esprits qui l'accompagne hic et nunc et qui fait dire à Tolkien, dans une formule qui anticipe celle de sa lettre à Amy Ronald : « toi et moi appartenons au camp toujours vaincu mais jamais complètement soumis » (Lettres, p.133). Et aussi : « nous sommes nés à une sombre époque et trop tard (pour nous) » (pp.98-99) (**), mais « nous sommes entre les mains de Dieu » (p.111). Cette communion dans la surnature se prolonge tout aussi souvent par une communion dans la nature, qui inspirera à Tolkien des descriptions remarquables : « la lumière argentée du printemps sur les fleurs et les feuilles » (p.110), ce coucher de soleil « des plus magnifiques » surplombant l'horizon d'« un rivage de plusieurs rangées de flamboyants chérubins d'or et de feu, traversés ici et là par des voiles brumeux comme de la pluie pourpre » (p.137), ou cette scène hivernale « d'une beauté à couper le souffle », avec au matin « les arbres comme des fontaines immobiles aux branches ramifiées se découpant contre une lumière dorée, et, tout en haut, un bleu pâle et translucide », et la nuit venue « le brouillard [qui] s'est levé et une lune ronde [éclairant] la scène d'en haut [:] vision d'un autre monde ou d'un autre temps » (p.158). Communion dans l'écriture, enfin : Christopher pourra suivre l'avancement de ce qui ne s'appelait encore que « l'Anneau », à l'époque où, bientôt arrivé « au cœur, où tous les fils doivent être réunis » (p.121), Tolkien menait Frodo et Sam aux portes du Mordor, parfois « dans la douleur » (p.105), versant « beaucoup de sueur pour quelques pages » (p.107), devant se « débatt[re] » avec des « passage[s] récalcitrant[s] » (p.112). Outre son avis esthétique (Shelob, p.122 ; Gamgee, pp.125,131), son avis critique global devient nécessaire, car « ce livre en est venu à t'être de plus en plus destiné, de sorte que ton avis importe plus que celui de quiconque » (p.135) ; « c'est surtout ce que tu penses que je veux entendre, car depuis longtemps c'est principalement à toi que je songe en l'écrivant » (pp.152-153).
— toujours soumis, bien entendu, au mystère du libre arbitre, par lequel l'un comme l’autre nous pourrions rejeter le « salut ». Auquel cas Dieu arrangerait les choses différemment ! [...]
La mention du « libre arbitre » arrive alors enfin, comme pour rassembler et résumer tout ce qui précède, aussi bien les principaux thèmes tolkieniens que le lien entre le père et le fils, de la façon suivante : le véritable enjeu du libre arbitre, ce à quoi il se rapporte ultimement, « sub specia æternitatis », le seul vrai choix, consiste à accepter ou « rejeter le “Salut” ». Sosryko l'avait déjà dit :
Le libre arbitre (Free Will) : il s’agit effectivement d’un élément essentiel de la pensée de Tolkien (et de la théologie tout cours ;-)). Mais tu commets il me semble une erreur en pensant que l’être humain (selon la Bible comme selon Tolkien) est libre de choisir de son comportement à chaque instant et à tous les niveaux de son existence. Tolkien est conscient de cela, lui qui qualifie Dieu « as the one wholly free Will » [L156], et surtout il sait que le seul enjeu du libre arbitre des hommes est le Salut (cf. « the mystery of free will, by which either of us could throw away 'salvation' » (L64]). Ainsi, Tolkien sait que Dieu ne veut que le Salut des hommes mais qu'il leur laisse aussi la liberté de l’accepter ou de le refuser. Voilà le domaine d’application du libre arbitre de l’homme : accepter le Salut ou le refuser.
Petite question en passant : as-tu une idée, Sosryko, de ce que Tolkien entend par « Auquel cas Dieu arrangerait les choses différemment » ?
(si l'un accepte le Salut tandis que l'autre le rejette, qu'entend-il par « arranger les choses » ?)
Nous retrouvons exactement ce passage de l'Écriture que j'avais donné et que Tolkien devait bien connaître tant il récapitule et résume la nature, la finalité et le paradoxe apparent du libre arbitre dans le Conte d'Arda comme dans la Bible : « mettez en œuvre votre salut, car c’est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant » (Philippiens 2,12-13) :
La nature du libre arbitre : par notre vouloir et notre faire — subcréateurs —, mettre en œuvre notre salut ;
Sa finalité : selon le dessein bienveillant de Dieu ;
Le paradoxe apparent : c'est Dieu — Créateur — qui donne réalité aussi bien à notre salut qu'à notre vouloir et à notre faire.
Le mystère ne constitue un paradoxe, nous l'avons vu, qu'à partir d'une définition de la liberté et de la puissance conçues indépendamment de l'essence divine — liberté d'indifférence et autonomie absolue de la créature. À partir d'une définition de la liberté du sub-créateur dépendante de la réalité créatrice, la contradiction disparaît : l'homme qui déploie sa nature et ses talents selon le dessein bienveillant de Dieu est au contraire celui qui déploie son être et donc sa liberté, tandis que celui qui en est empêché « gaspill[e sa] vie ».
Bien entendu, le Conte d'Arda n'est pas un traité de théologie ou de philosophie (même s'il en contient de véritables en interne). La mythopoésie tolkienienne se fait ici « un véhicule du Mystère » et opère (ou s'efforce d'opérer) un « recouvrement » (Faërie, pp.82,121) du mystère du libre arbitre. Et, s'il n'est pas le seul thème du Légendaire à faire l'objet d'un tel recouvrement, il est celui qui participe de chacun des autres thèmes : l'homme vivant, la pitié, le don de soi, la pauvreté, le royaume, la mort, l'espérance, la conjugalité, la sagesse, la mémoire, etc.
Terminons par un mot sur la deuxième partie de la lettre, où Tolkien partage à Christopher l'avancement de l'histoire de « l'Anneau ». On pourrait croire que nous sommes passés à un autre sujet — à tort. Car la partie précédente de la lettre se décline dans ce monde secondaire qui « grandit et pousse encore » et « se déploie » — certains éléments à venir étant entrevus tandis que d'autres surviennent « de manière inattendue ». Tout en décrivant à Christopher ce qui devra probablement advenir, il sait que « cela se passera certainement d'une manière très différente lorsqu'on en sera à l'écriture elle-même, car le tout semble s'écrire de lui-même une fois que je suis lancé, comme si la vérité était révélée à ce moment-là, jusque là seulement imparfaitement aperçue » (Lettres, p.154).
Et, après une dernière récrimination à l'égard de la Machine (c'est-à-dire à la part de « l'humanité et [d]es ingénieurs en particuliers [qui] sont à la fois stupides et malveillants, en règle générale » et qui empêchent la machine d'être « réservé[e] à des usages raisonnables »), la lettre du père à son fils s'achève par l'expression renouvelée de tout son amour et du « lien spécial » qui les unit :
[Je n'ai] sans toi personne avec qui partager mes pensées. J'ai commencé au tout début à écrire « l'H. des Gnomes » dans des baraquements militaires bondés, remplis du son des gramophones — et te voilà maintenant dans la même prison. Puisses-tu, toi aussi, en réchapper — plus fort. Prends soin de toi, en ton âme et ton corps, de toutes les façons possibles et adéquates, pour l'amour que tu portes à ton Père.
Ailleurs, Tolkien redira la même chose de façon « allégorique » comme pour « touche[r] au cœur » : « et voilà où tu en es : un Hobbit parmi les Urukhai. Porte ton hobbitude dans ton cœur, et songe que toutes les histoires ressemblent à cela quand on est dedans » (Lettres, p.118).
Tolkien n'écrivait-il pas le Seigneur des Anneaux et les autres légendes du Conte d'Arda pour « l'élucidation de la vérité et l’encouragement de la morale dans ce monde réel, au moyen de l'antique procédé qui consiste à les illustrer dans des figures inhabituelles, procédé qui pourrait conduire à une “prise de conscience” (‘bring them home’) » (Lettres, p.277) ? Si l'on a saisi ce que Tolkien met derrière la vérité et la morale, il ne me paraît pas exagéré de résumer sa déclaration à « l'encouragement » tout court, c'est-à-dire, littéralement, à redonner cœur — à Christopher, et « à ceux qui ont soif » (Lettres, p.145).
Aujourd'hui réunis « sous l'œil de Dieu, “tout entiers et unis” », ils nous laissent en héritage, fruit du « lien spécial » qui était le leur, une histoire, celle de la Terre du Milieu, qui tire sa « valeur en soi » d'« au-delà de cette vie » — « sub specie æternitatis ».
Yyr Tolkiendil
(*) On sait que Tolkien exprima son affection à Michaël dans les mêmes termes :
Ne vois-tu pas pourquoi je me soucie tellement de toi et pourquoi tout ce que tu fais me concerne de si près ? Gardons pourtant nos cœurs dans l'espérance et la foi (let us both take heart of hope and faith). Le lien entre père et fils n'est pas fait que de chair périssable : il doit aussi avoir quelque chose d'æternitas en lui. Il est un lieu appelé le “paradis” où le Bien qui est ici inachevé s'accomplit et où les histoires non écrites, et les espoirs non réalisés, se poursuivent. Nous rirons peut-être à nouveau ensemble ...
Lettres, p.85, trad. modifiée
(**) Hum ... Mon propre père me l'a souvent dit aussi ;).
Hors ligne
#130 01-01-2021 02:26
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Merci Yyr pour cette relecture de la lettre 64, à la fois conclusion de multiples recherches et trouvailles, louange d'une pensée et d'une œuvre qui nous touchent toujours autant, hommage au fils et au père, et feu d'artifices de souvenirs, avec ces renvois à tant de développements de JRRVF dont certains remontent à bientôt deux... décennies ! Voilà une belle manière de débuter l'année nouvelle !
Hors ligne
#131 20-01-2021 23:59
- Hyarion
- Inscription : 2004
- Messages : 2 581
Re : La question du Libre Arbitre
All we have to decide is what to do with the time that is given us. (Tout ce qu'il nous appartient de
décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti.)
J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, I, 2 (“The Shadow of the Past”).
De passage assez récemment à la Male-Selve (lors du Nouvel An) entre deux couvre-feux, me revoilà de passage ici...
Si j'en crois mon souvenir d'une ancienne notification reçue, il me semble que le dernier message de Yyr avait déjà été publié en novembre dernier, avant de disparaître rapidement, ce en quoi j'avoue qu'il ne m'apparaît pas être totalement une nouveauté, même si le premier jet a, à l'évidence, été largement complété depuis. ^^'
Ayant été un de ceux qui ont suivi le déroulement du présent fuseau depuis le début, et puisqu'il a été récemment question de conclusion, je prends mon courage à deux mains pour participer jusqu'au bout à l'effort, en essayant donc moi-même de « conclure ». Et même si, de fait, je ne crois pas qu'il y ait vraiment matière à une poursuite de la discussion, histoire d'essayer de mieux commencer cette année que ne s'est terminée la précédente, je vais tâcher d'essayer de rester constructif... en espérant en tout cas que ce message ne finira pas déplacé ailleurs... ^^
Le texte qui suit était initialement précédé d'une sorte de préambule que l'on trouvera finalement dans un autre fuseau (dans le sillage d'une digression de Yyr issue de considérations « taguieffiennes » commencées — ici et surtout là — dans le présent fuseau sur le libre arbitre) : https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic. … 780#p89780
Dans sa lettre n°64, évoquée précédemment par Yyr ici même, J. R. R. Tolkien a donc écrit notamment ceci à son fils Christopher T. :
Il est probable que nous nous retrouverons, sous l'œil de Dieu, « tout entiers et unis », dans peu de temps, très cher petit ; et il est certain que nous avons un lien spécial qui durera au-delà de cette vie - toujours soumis, bien entendu, au mystère du libre arbitre, par lequel l'un comme l'autre pourrions rejeter le « salut ». Auquel cas Dieu arrangerait les choses différemment ! [...]
J. R. R. Tolkien, lettre n°64 (30 avril 1944) à Christopher Tolkien.
Ma grand-mère, disparue il y aura déjà dix ans cette année, qui a longtemps fait le catéchisme dans sa paroisse catholique, qui m'a élevé avec ma mère, et qui me manque toujours aujourd'hui, me parlait effectivement de cela — notamment quand j'étais enfant —, de ces retrouvailles au-delà de cette vie, au-delà de la mort... Ce serait (sera ?) bien, même si l'on ne peut pas le savoir ici-bas, et que la question ne se posera qu'à l'heure de ma propre mort. Peut-être, qui sait ? En tout cas, je n'ai pas oublié d'où je viens.
S'agissant du libre arbitre — ce pouvoir de choisir, cette faculté à librement vouloir, penser et agir, ce pouvoir créateur de la volonté se déterminant elle-même en tant que commencement premier —, sans vouloir rivaliser avec l'avalanche d'érudition des nombreux messages précédents du présent fuseau, je dirais d'emblée simplement que, dans ce monde plein d'incertitudes, nous avons des choix à faire, à partir des histoires que nous choisissons de nous raconter, que ces histoires soient le fruit direct d'un héritage ou le fruit de sa propre idiosyncrasie, ou bien d'un peu de tout cela à la fois, ce dont témoigne sans doute notamment, au moins en partie, ce que Tolkien a pu concevoir s'agissant de Faërie. Si l'on se penche toutefois plus particulièrement sur le cas, décidément incontournable, du christianisme, à la lumière notamment de certaines lectures dans le cadre de mes propres recherches, j'aurai bien quelques très modestes considérations à partager (humblement !) concernant le libre arbitre, qu'il soit question d'un libre arbitre à exercer dans son quotidien et à tous les niveaux de son existence d'une part, ou bien d'un libre arbitre qui ne serait à exercer, fondamentalement, qu'en acceptant ou refusant le « salut de l'âme » censé être accordé par le Dieu personnel de la Bible.
Avec cette histoire de libre arbitre, nous nous heurtons facilement à ce problème de la part de religieux à attribuer à la notion et à l'origine de celle-ci. Pour Nietzsche, ainsi qu'il l'a écrit dans son Crépuscules des idoles en 1888, les choses semblaient claires :
Erreur du libre arbitre. — Il ne nous reste aujourd’hui plus aucune espèce de compassion avec l'idée du « libre arbitre » : nous savons trop bien ce que c'est — le tour de force théologique le plus mal famé qu'il y ait, pour rendre l'humanité « responsable », à la façon des théologiens, ce qui veut dire : pour rendre l'humanité dépendante des théologiens... Je ne fais que donner ici la psychologie de cette tendance à vouloir rendre responsable. — Partout où l'on cherche des responsabilités, c'est généralement l'instinct de punir et de juger qui est à l'œuvre. On a dégagé le devenir de son innocence lorsque l'on ramène un état de fait quelconque à la volonté, à des intentions, à des actes de responsabilité : la doctrine de la volonté a été principalement inventée à fin de punir, c’est-à-dire avec l'intention de trouver coupable. Toute l'ancienne psychologie, la psychologie de la volonté n'existe que par le fait que ses inventeurs, les prêtres, chefs des communautés anciennes, voulurent se créer le droit d'infliger des peines — ou plutôt qu'ils voulurent créer ce droit pour Dieu... Les hommes ont été considérés comme « libres », pour pouvoir être jugés et punis, — pour pouvoir être coupables : par conséquent toute action devait être regardée comme voulue, l'origine de toute action comme se trouvant dans la conscience (— par quoi la plus radicale manipulation in psychologicis était fait principe de la psychologie même...). Aujourd'hui que nous sommes entrés dans le courant contraire, alors que nous autres, les immoralistes, cherchons, de toutes nos forces, à faire disparaître de nouveau du monde l'idée de culpabilité et de punition, ainsi qu'à en nettoyer la psychologie, l'histoire, la nature, les institutions et les sanctions sociales, il n'y a plus à nos yeux d'opposition plus radicale que celle des théologiens qui continuent, par l'idée d'un « ordre moral du monde », à infester l'innocence du devenir avec le « châtiment » et la « faute ». Le christianisme est une métaphysique de bourreau...
Friedrich Nietzsche, Le Crépuscules des idoles, traduit de l'allemand par Henri Albert, traduction révisée par Jean Lacoste, in Œuvres, Tome II, collection Bouquins, Paris, Robert Laffont, 1993, réimpr. 2009, « Les Quatre grandes erreurs », 7., p. 979-980.
Peut-on échapper au paradigme chrétien lorsque l'on traite du libre arbitre en relation avec l'œuvre d'un écrivain comme Tolkien ? Cela semble a priori difficile. Nietzsche nous invitant indirectement à tenir forcément compte de cette vision du monde, qui était celle de Tolkien, vision d'un monde « déchu » marquée notamment du sceau de la « faute » et donc du « péché », j'ai choisi de partir de deux éléments conjoints pour réfléchir, de mon côté, à la question : la pensée d'Augustin d'Hippone, dit saint Augustin — que Nietzsche ne manque pas de critiquer dans ses écrits, au même titre que Paul de Tarse, dit saint Paul — et le mythe du Péché originel d'Adam et Ève...
Pourquoi Augustin d'Hippone ? Parce que c'est probablement un des penseurs chrétiens les plus intéressants à lire, quel que soit le rapport que l'on peut avoir au christianisme. J'avais évoqué fugacement sa pensée dès le début des échanges sur le présent fuseau, autant assumer jusqu'au bout. Par là-dessus, l'Afrique romaine, patrie d'Augustin d'Hippone, faisait partie des sujets que j'ai eu l'occasion d'étudier à l'université. Il n'est pas sûr que Tolkien ait été un grand lecteur d'Augustin, du moins de façon directe, mais les très nombreux écrits de l'auteur de La Cité de Dieu ont été tant lus et tant copiés au Moyen Âge, et sa théologie si largement transmise par Thomas d'Aquin, que ledit Augustin devait bien être une référence familière audit Tolkien, ce que semblent du reste avoir bien compris la plupart des commentateurs.
Pourquoi le mythe du Péché originel d'Adam et Ève ? Parce qu'avec Tolkien, on y revient toujours... mais surtout parce que c'est, de mon point de vue, l'un des mythes les plus intéressants de toute la Bible. Il est, du reste, plus ou moins à la source de toute chose d'un point de vue chrétien : il est l'explication à un monde supposé « déchu », à une condition humaine évoluant entre libre arbitre et grâce divine permettant le « salut de l'âme »... Il est aussi l'occasion d'évoquer, pour commencer, avant le partage de quelques lectures, un tableau.

Jacopo Robusti, dit Tintoret ou Le Tintoret (1518/1519-1594).
Le Péché originel, c.1551-1552.
Huile sur toile, 150 x 220 cm.
Venise, Gallerie dell'Academia.
Le Péché originel est un de mes tableaux préférés du grand Tintoret. À défaut de pouvoir me rendre à Venise, j'ai pu le voir à Paris en mars 2018, à l'occasion de l'exposition « Tintoret, naissance d'un génie » au Palais du Luxembourg. Il fait partie des œuvres peintes par l'artiste entre 1551 et 1556, caractérisées par la place essentielle qu'y occupe le nu féminin, dans un contexte de probable concurrence avec Titien, en ce milieu du XVIe siècle. À l'époque, Tintoret n'est pas encore marié, et certains se demandent si les nus féminins de cette période du peintre ne pourraient pas avoir un rapport avec la maîtresse de l'artiste, mère de sa fille Marietta. Il est probable que J. R. R. Tolkien a vu ce tableau, lors de sa visite (matinale) de la Gallerie dell'Academia le 4 août 1955, durant son séjour à Venise avec sa fille : il évoque, dans son journal de voyage, “the Tintorettos” comme comptant parmi les tableaux qui l'ont intensément intéressé, ému, ou les deux à la fois, mais sans que l'on sache précisément ce qu'il pensait de tel ou tel tableau en particulier.
J'ai longtemps été intrigué par le regard d'Ève... Un regard si mystérieux, vague, comme dans un rêve... ou un mythe (cela fait penser un peu, en ce sens, à l'effet de la brume dans le film Excalibur, chef d'œuvre de John Boorman). Je n'étais pas certain que les reproductions du tableau dans les livres, que j'avais vues depuis l'enfance, soient fidèles à ce regard, mais une fois enfin devant la toile originale à Paris, j'ai pu constater combien le pinceau du Tintoret avait su effectivement donner cette impression de vague et de mystère, à peu près indescriptible... Chef-d'œuvre.
Adam fait a priori ici figure de repoussoir vis-à-vis du spectateur : c'est hors du tableau, dans le dos du (supposé) premier homme que nous voyons la scène. Ève est, au contraire, une figure d'ouverture, et c'est à peu près au-dessus de sa tête qu'apparait, assez discrètement, celle du serpent. Un détail savoureux ajoute au plaisir que l'on peut avoir à contempler la scène : la nuque d'Adam est halée, alors que la peau de son dos est d'une couleur plus pâle. Le premier homme, qui apparaît ainsi plus dévêtu que nu, est-il vraiment le premier homme, celui qui ignorait le vêtement — au sens le plus prosaïque du terme — avant la Chute ? On a pu voir dans ce détail un élément caractéristique de l'humour un peu impertinent du Tintoret et je suis d'accord avec cette analyse, car si Tintoret était incontestablement catholique, il n'en était pas moins un esprit autonome et audacieux, fin lecteur de la Bible, sans doute notamment en langue dite vulgaire — avant que l'Église catholique n'interdise les traductions du Livre développées sous l'influence de la Réforme protestante. L'humour du Tintoret — que l'on pourra aussi retrouver dans un tableau comme La Princesse, saint Georges et saint Louis (1551), autre chef d'œuvre du maître vénitien conservé à la Gallerie dell'Academia (et également exposé à Paris en 2018) — fait partie des aspects de son art de peintre que j'apprécie le plus.
Un peu plus sérieusement, cette nuque halée d'Adam peut être in fine de nature à relativiser le côté repoussoir du personnage s'agissant du spectateur : ce dernier peut s'identifier à Adam dans le sens où le fruit défendu peut symboliser non seulement la source du Péché originel, mais aussi le choix supposé devoir être celui du chrétien depuis lors, par ce que Tolkien appelle lui-même le « mystère du libre arbitre ».
À présent, passons à Augustin d'Hippone, par qui nous reviendrons ensuite à Adam et Ève.
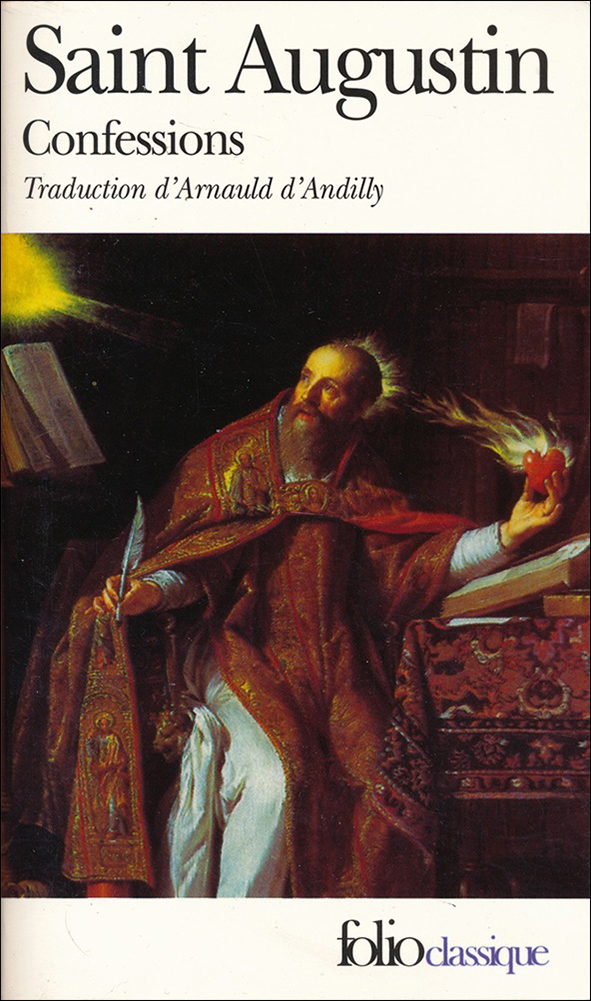
Il y avait longtemps que je n'avais pas relu les célèbres Confessions de saint Augustin... Les lire, ou les relire, du moins dans l'édition qui est la mienne, en l'occurrence celle proposant la traduction faite par le conseiller d'État, poète, écrivain, arboriculteur, frondeur et janséniste Robert Arnauld d’Andilly (1671), c'est se plonger dans deux époques à la fois, l'époque du traducteur, le XVIIe siècle français et sa langue classique dont Arnauld d'Andilly sait se servir avec clarté, et l'époque de l'auteur, nettement moins proche de nous, les IVe et Ve siècles de notre ère durant lesquels l'Afrique romaine incarna de façon singulière cette Antiquité tardive marquée par la disparition progressive de l'Empire romain d'Occident.
Né à Thagaste (aujourd'hui Souk-Ahras, en Algérie) en 354 de notre ère, d'un père païen tolérant et d'une mère chrétienne pieuse, converti lui-même au christianisme en 386, mort à Hippone en 430 lors du siège de la cité par les Vandales, Augustin peut difficilement être appréhendé comme penseur, auteur et fidèle chrétien sans tenir compte du contexte dans lequel il a vécu toute sa vie (hormis quelques années passées à Rome et à Milan) : celui d'un territoire nord-africain de l'Empire romain (allant de la Libye au Maroc actuels) où le christianisme s'est diffusé précocement, dès la fin du Ier siècle de notre ère, mais non sans difficultés jusqu'au succès des IVe et Ve siècles, et où cette nouvelle religion monothéiste fut caractérisée par son intransigeance et son conservatisme, sources d'un schisme lors de la longue crise donatiste de 312-411. Les attaques — pouvant faire sourire aujourd'hui — d'un Augustin notamment contre « Jupiter tonnant et adultère » que « la coutume » autorise dans des « fables impudiques » (cf. Confessions, Livre premier, chapitre XVI), font écho à la situation du christianisme africain de ce temps-là, christianisme qui eut à s'imposer face à un polythéisme (ou paganisme) qui resta longtemps vivace en Afrique romaine, de même que la civilisation municipale des cités africaines, qui conserva longtemps son fonctionnement traditionnel romain, et au sein de laquelle ce fut davantage sous le règne des Vandales (à partir de 430) que sous l'Empire romain d'Occident finissant que la christianisation pu s'approfondir, soit après la mort d'Augustin, évêque d'Hippone de l'an 395 jusqu'à son décès (précisément en 430). Pour qui serait intéressé par le sujet, je renvoie à l'excellente synthèse de l'historien Christophe Hugoniot que j'ai lu quand j'étais à la fac, qui est encore à portée de main dans les rayons de ma bibliothèque, et dont voici les références bibliographiques : Christophe Hugoniot, Rome en Afrique. De la chute de Carthage aux débuts de la conquête arabe, Paris, Flammarion, coll. « Champs Université », 2000.
C'est dans les années 397-400 qu'Augustin écrit ses Confessions, pleines de lyrisme et de sincérité. Il y raconte notamment ses années de jeunesse, une jeunesse étudiante apparemment « dissipée » et vis-à-vis de laquelle il éprouvait visiblement une grande culpabilité. Je partage ici quelques passages :
Il faut maintenant que je raconte mes impuretés passées, et ces voluptés charnelles qui ont corrompu la chasteté de mon âme. Et ce qui me porte à ce récit n'est pas que je les aime, Seigneur, mais c'est au contraire, afin que je continue à vous aimer toujours davantage. Car je vous aime, ô mon Dieu, et j'aime l'amour que j'ai pour vous : et c'est par le mouvement de cet amour que je veux repasser dans ma mémoire avec amertume et avec regret les désordres de ma jeunesse ; afin que ce souvenir amer et cuisant serve à me faire goûter d'une manière encore plus sensible les douceurs ineffables que je trouve en vous, et qui ne sont ni trompeuses comme les fausses douceurs de la terre, ni funestes comme ces vaines délices : mais qui sont solides, heureuses et assurées. C'est vous, mon Dieu, qui rassemblez et réunissez en votre seul et unique amour toutes les puissances de mon esprit et de mon cœur, que le vice et les passions avaient divisées en tant de parties, lorsque m'éloignant de votre unité suprême je me suis répandu dans la multiplicité des créatures, et me suis égaré en tant de routes perdues. [...]
Saint Augustin, Confessions, traduction d'Arnauld d'Andilly établie par Odette Barenne, édition présentée par Philippe Sellier, Paris, Gallimard, « Folio classique », 1993, rééd. 2005, Livre II, Chapitre premier, p. 65-66.
Je vins à Carthage, où je me trouvai aussitôt environné de toutes parts des feux de l'amour infâme. Je n'aimais pas encore, mais je désirais d'aimer (*) : et dans ma pauvreté et mon indigence des biens du ciel, laquelle était d'autant plus grande qu'elle était plus secrète et plus cachée à mes yeux, je me voulais mal de ce que je n'étais pas encore assez pauvre. Comme je désirais d'aimer, je cherchai un objet que je pusse aimer. Les chemins sûrs, et où il ne se rencontrait point de pièges et de périls, m'étaient devenus odieux. Mon cœur était tout sec et tout affamé dans la privation et le besoin où il était de cette nourriture intérieure, qui est vous-même, mon Dieu : mais je ne sentais point cette faim spirituelle, et je n'étais touché d'aucun désir pour cet aliment céleste et incorruptible. Ainsi le peu de soin que j'avais de le rechercher ne procédait pas de mon abondance, mais de ma nécessité : et mon dégoût ne venait pas de ce que j'en fusse rassasié et rempli, mais au contraire de ce que j'en étais trop dépourvu et trop vide. Ce défaut de la seule bonne nourriture que mon âme pût recevoir, l'avait rendue toute languissante et toute malade : et comme elle était couverte d'ulcères, elle se jetait misérablement hors d'elle-même, souhaitant d'adoucir l'ardeur et l'inflammation de ses plaies en goûtant les plaisirs voluptueux de l'attouchement des créatures sensibles et animées, pour lesquelles on a d'autant plus d'amour qu'elles sont vivantes, et qu'on aimerait point si elles ne l'étaient pas. [...]
C'était ainsi que je corrompais la source de l'amitié par les ordures et les impuretés de mes débauches ; et que je ternissais sa splendeur et sa lumière par les vapeurs infernales qui sortaient comme de l'abîme de mes passions charnelles et vicieuses. [...] Je ne saurais, mon Dieu, vous bénir assez de votre miséricorde, lorsque je me souviens combien par votre bonté vous mêlâtes de fiel et d'amertume dans la douceur sensuelle que je goûtais. Car aussitôt que je me vis aimé selon mon désir, que j'eus obtenu en secret la jouissance de ce que j'aimais, et que je fus ravi de me voir lié avec les nœuds de l'amour, je me vis aussitôt cruellement déchiré comme avec des verges de fer toutes brûlantes par les jalousies, les soupçons, les craintes, les colères, et les piques.
(*) : Formule célèbre : Nondum amabam et amare amabam. Dans les Lettres portugaises (1669), la religieuse éprise d'un officier français s'écrie « J'ai éprouvé que vous m'étiez moins cher que ma passion » (lettre V). Chateaubriand, Proust ont illustré cette remarque aiguë.
Saint Augustin, Confessions, op. cit., Livre III, Chapitre premier, p. 87-88.
À noter que ces années de jeunesse « débauchée » furent aussi, pour Augustin, celles de la paternité : il eut, à seulement 17 ans, un fils d'une concubine avec laquelle il vécut quatorze ans (son fils, Adéodat, mourut jeune, en 389-390).
Les passages des Confessions cités donne une première idée de la façon dont Augustin d'Hippone conçoit l'amour humain. « Je n'aimais pas encore, mais je désirais d'aimer » (« Nondum amabam et amare amabam ») : l'être humain est en fait un immense élan amoureux, mais Dieu est censé être la visée profonde de l'amour. Il semble que pour Augustin, il en soit de l'amour comme de la sexualité : ils font partie de la nature humaine créé, sans être une conséquence de la Chute, mais c'est l'influence du péché sur l'amour et la sexualité qui constitue « LE » problème, encourageant l'amour de la création plus que du Créateur. Pour Augustin, quels que soient ses mérites et ses bonnes actions permises par le libre arbitre ici-bas, le chrétien est un pécheur sa vie durant, du fait de sa volonté pervertie par le péché : il doit attendre en espérance le « salut » de Dieu, don gratuit du Créateur, à la base de la théologie augustinienne de la grâce divine, laquelle aura une très longue postérité jusqu'à nos jours. Après avoir accordé une certaine importance au libre arbitre durant ses premières années de conversion, Augustin basculera à partir de 394 dans une pensée insistant sur la primauté de la grâce. Cependant, il considère que cette primauté ne dispense pas le chrétien d'agir dans le « bon sens », vers le Bien, en préférant notamment l'amour-action altruiste (la charité, agapê) à l'égoïste amour-passion. Un tel choix à l'aune de la foi n'est pas sans conséquences néfastes dans un contexte d'évangélisation. Augustin, en ce sens, a ouvert la voie à une tendance hélas assez lourde chez les chrétiens, celle de vouloir amener vers la « Vérité » en se réclamant d'un certain amour du prochain et d'un certain amour de Dieu au nom desquels tous les moyens peuvent être bons, y compris l'autorité et donc la contrainte, comme le rappelle Paul Veyne dans son très riche ouvrage L'Empire gréco-romain :
D'ordinaire, Augustin perçoit mieux que tout autre le danger qu'il y a à s'identifier à ses bonnes intentions conscientes (*). Mais il lui arrive aussi d'être dupe lui-même. Il est autoritaire et batailleur ; il affirme ainsi que l'amour justifie l'exercice de l'autorité : aimer autrui, c'est vouloir le bien d'autrui, son vrai Bien, à savoir Dieu ; on aime son prochain parce que Dieu est en lui ou du moins pour qu'il soit en lui, on l'aime « dans le Christ ». On pourra donc, par exemple, contraindre autrui, le « forcer à entrer » dans l'orthodoxie (**), puisque c'est pour son bien et que la contrainte finira bien un jour par l'amener sincèrement (***) à ce Dieu qui est son vrai Bien. D'où le fameux « aime et fais ce que tu veux » : quoi que tu fasses, à condition d'être animé par cet amour de Dieu en le prochain (serait-ce malgré lui), alors ce que tu fais est bon, y compris la contrainte.
La sincérité, la cohérence et les mobiles élevés de saint Augustin ne peuvent être mis en doute, du moins dans une religion au cœur de laquelle sont, au nom de la charité, l'autorité pastorale, l'amour pour le pasteur, l'obéissance et l'hétéronomie. Mais il semble difficile de le nier : la charité, comme voulant le bonheur éternel du prochain, jointe à l'organisation hiérarchique de l'Église, a produit en ce bas monde beaucoup plus d'effets d'autorité que d'effets de bonté.
(*) Peter Brown, La Vie de saint Augustin [(1967), Paris, Seuil, 1971], p. 233-234 et 271-272.
(**) : C'est le fameux compelle intrare.
(***) : Un opuscule génial d'Augustin, le De utilitate credendi, fonde avant la lettre la sociologie des idées, en effaçant la barrière entre l'intellect individuel et le milieu. Augustin avait constaté que des schismatiques, les donatistes, contraints contre leur conscience de rentrer dans le giron de l'Église catholique, avaient fini par s'imprégner de la vérité imposée et par y adhérer sincèrement.
Paul Veyne, L'Empire gréco-romain, Paris, Éditions du Seuil, 2005, rééd. coll. « Points Histoire », 2015, 9. « Païens et charité chrétienne devant les gladiateurs », 9, p. 725.
Il est temps, à présent, via Augustin et l'étude de ses idées en particulier en matière de sexualité, au mythe du Péché originel d'Adam et Ève.
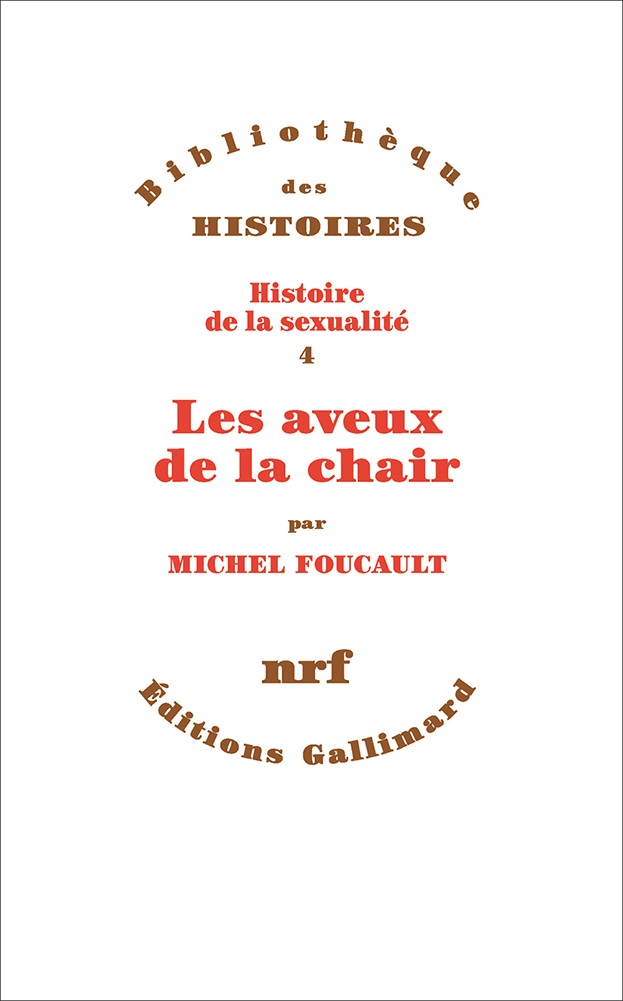
Il y a déjà trois ans, paraissait Les Aveux de la chair de Michel Foucault (édition de Frédéric Gros, Gallimard, 2018), quatrième tome resté jusque-là inédit de sa fameuse Histoire de la sexualité, cette parution intervenant trente-quatre après la mort de l'auteur. Dans cet ouvrage fort stimulant, Foucault étudie la conception par les Pères de l'Église d'une doctrine sexuelle chrétienne au cours des cinq premiers siècles de notre ère. Ce travail de recherche sur le christianisme et la sexualité de l'Antiquité tardive, parallèlement aux recherches de l'historien Peter Brown, qui fut un ami de Foucault, suggère l'existence d'une révolution sexuelle qui ne serait pas celle habituellement associée aux années 1970. Auteur d'un long compte-rendu de lecture des Aveux de la chair pour la revue L'Histoire (n°448), l'historien Patrick Boucheron — qui présente les documentaires de la série « Quand l'histoire fait dates » diffusée sur la chaîne ARTE et que notre ami Silmo a fort pertinemment signalé, il y a quelque temps, dans un autre fuseau — résume ainsi la perception que l'on peut aujourd'hui avoir du propos de Foucault, inscrit dans une époque, déjà un peu lointaine, où l'on percevait de profonds bouleversements des mœurs dans les années 1960-1970 et encore au début des années 1980 à l'époque où Foucault écrivit ses dernières pages : « La révolution sexuelle n'aura pas lieu - et Foucault, en maître ironique du scepticisme, nous rappelle qu'elle n'a peut-être jamais eu lieu, sinon au temps des Pères de l'Église, et pas exactement comme on l'aurait espéré » (cf. Patrick Boucheron, « Foucault, Augustin et la chair », L'Histoire n°448, p. 32-37). Il est vrai que l'on a eu tort de rendre le christianisme seul responsable d'un âge démesurément long de répression et d'interdits sexuels, alors que le ver de l'austérité était déjà, à divers égards, dans le fruit des pensées antiques avant les temps chrétiens, mais Boucheron lisant Foucault a-t-il pour autant raison de nier qu'il y ait eu une révolution sexuelle il y a environ un demi-siècle ? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'évolution des mœurs en Occident à partir de ces fameuses années 1960 et 1970 — qui ont bien été des années de grandes ruptures —, sachant notamment que je suis personnellement d'accord avec l'historien Robert Muchembled pour identifier une ère du plaisir ayant succédé, à partir de 1960 (et plus ou moins jusqu'à nos jours), à « une longue période de glaciation sexuelle victorienne » s'étalant de 1800 à 1960 (cf. Robert Muchembled, L'Orgasme et l'Occident, Une histoire du plaisir du XVIe siècle à nos jours, Éditions du Seuil, 2005, rééd. coll. « Points Histoire », 2008)... mais ce ne sera pas ici directement notre sujet.
Dans l'histoire de la sexualité occidentale étudiée par Michel Foucault, celui-ci situe aux temps chrétiens de l'Antiquité tardive un changement profond de mentalités en matière de sexualité, celle-ci n'étant pas refoulée comme on pourrait le croire, mais au contraire placée au cœur du sujet sexuel construisant désormais un rapport à ses pensées et à ses désirs que l'on pourrait succinctement résumer à une formule : connaître son désir, le dire et obéir (en se soumettant à un dispositif de pouvoir). C'est à cette aune, en s'appuyant notamment sur les textes de Tertullien, Jean Chrysostome, saint Cyprien, Jean Cassien, Clément d'Alexandrie, Grégoire de Nysse, etc., que Foucault étudie, dans les deux premiers chapitres de son ouvrage, les pratiques du baptême, de la pénitence en public, de la confession, ainsi que la mystique chrétienne de la virginité. Cependant, last but not least, le troisième et dernier chapitre est consacré à la pensée d'Augustin d'Hippone, et plus précisément à sa doctrine sur le mariage ainsi qu'à sa conception de la concupiscence, lesquelles sont présentées comme étant à la base de l'éthique sexuelle du christianisme occidental.
La thèse de Foucault est que la pensée augustinienne a, en fait, littéralement libidinisé le sexe. En matière de liens conjugaux aux temps des Pères de l'Église, le fait est que, d'emblée, notamment selon Jean Chrysostome, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'acte sexuel dans le cadre du mariage chrétien n'a pas pour but premier la procréation, mais plutôt le service mutuel que l'on rend à son conjoint pour pouvoir le sauver de la concupiscence. C'est en partant de cette idée du mariage entre hommes et femmes conçu comme un lien de société qui est par lui-même un bien, sans pour autant être dépendant en soi de la procréation (même si celle-ci a évidemment toute son importance dans ce cadre), qu'Augustin d'Hippone articule sa conception de la sexualité du couple marié autour du mythe (érigé en dogme) du Péché originel et de la Chute. Cela amène naturellement Foucault à s'intéresser à la sexualité d'Adam et Ève vue par Augustin, et à identifier ce dernier comme inventeur de la libido, conçue comme conséquence du péché originel et caractérisé par un involontaire structurel, propre à l'être humain « déchu », qu'est le libidinal du sexe.
[...] Il ne faut pas imaginer que les humains avant le péché étaient aveugles. Ève n'avait-elle pas vu « que le fruit était bon à manger » et agréable à voir ? Ils pouvaient donc voir leur propre corps. Mais faut-il admettre qu'en effet ils portaient leurs regards sur leur sexe ? Non car celui-ci était recouvert du « vêtement de la grâce » — vêtement qui faisait que, d'une part, leurs membres ne se révoltaient pas contre leur volonté et que, d'autre part et en conséquence, on n'y prêtait pas attention et on ne cherchait pas à connaître ce que ce vêtement pouvait cacher (1). Mais avec la faute et la grâce qui se retire, le châtiment apparaît : c'est la « désobéissance en retour », la reproduction physique, dans le corps et très précisément par le sexe, contre la volonté humaine de l'insurrection par laquelle l'homme s'était dressé contre Dieu. Or cette révolte tire à elle le regard et l'attention : « Pour frapper leur désobéissance par réciprocité (reciproca inoboedientia), il se produisit un mouvement tout nouveau d'impudeur corporelle qui rendit leur nudité indécente, la leur fit remarquer et les remplit de confusion (fecitadtentos redditque confusos)[2]. » Sous le régime de la grâce, l'inattention du regard et l'usage volontaire du sexe étaient liés, faisant que celui-ci était visible sans risquer jamais d'être nu. La chute, en revanche, lie l'attention des yeux et l'involontaire du mouvement, faisant que le sexe est nu, mais avec une telle honte, un tel sentiment d'humiliation après un orgueil si trompeur qu'on cherche à le rendre, lui, signe et effet de la révolte, physiquement invisible. D'un mot, le sexe « surgit », dressé dans son insurrection et offert au regard (3). Il est pour l'homme ce que l'homme est pour Dieu : un rebelle. Homme de l'homme, érigé devant lui et contre lui, comme Adam, homme de Dieu, a senti qu'il devait se cacher après sa désobéissance. On peut alors définir ce « quelque chose » qui a, avec la chute, modifié l'usage innocent du sexe qui aurait été possible au paradis. Ce n'est pas un organe nouveau — la distinction des sexes préexistait et la faute ne l'a pas rendue mauvaise (4) ; ce n'est pas un acte — il avait déjà sa place et sa fonction, et cette fonction, il la conserve encore. C'est la forme involontaire d'un mouvement qui fait du sexe le sujet d'une insurrection et l’objet du regard. Visible et imprévisible érection.
Notons, bien sûr, le fait que la libido ainsi conçue se caractérise essentiellement par le sexe masculin, ses formes et ses propriétés. Elle est originairement phallique. Augustin se rend bien compte de l'objection possible et il tâche de trouver le symétrique, chez la femme, de l'indécent mouvement qui a fait honte à l'homme en lui signalant la révolte en lui-même, donc sa déchéance : « Ce n'est pas un mouvement visible que la femme a voilé ; ce que l'homme éprouvait, elle l'éprouva elle-même, quoique d'une manière plus secrète ; tous deux voilèrent ce que chacun d'eux éprouvait à la vue de l'autre. » Et peut-être parce qu'il sentit ce qu'avait d'artificielle cette symétrie faisant voiler à la femme ce qui est en elle invisible, et sans doute aussi pour conserver le thème déjà évoqué de la pudeur à l'égard du désir réciproque, Augustin ajoute dans le même passage : « L'homme et la femme rougirent, ou bien chacun pour soi, ou bien l'un pour l'autre (5). » La femme voile ce qui provoque le mouvement que l'homme doit cacher ; et celui-ci doit voiler ce qui provoque le mouvement caché en la femme. De toutes façons, la visibilité de l'organe masculin est au centre du jeu.
Et il faut noter en outre que ce jeu manifeste l'entrée de l'homme dans le règne de la mort. Mort par rapport à la grâce de Dieu qui lui est retirée ; mort aussi en ce monde, puisque la mortalité désormais devient maladie fatale ; mort enfin, on le verra, puisque c’est par le rôle indispensable de l'union sexuelle dans la naissance que le péché originel se transmet de génération en génération. Dans le mouvement involontaire du sexe et la visibilité qui lui est liée, l'homme doit reconnaître la mort : « Dans ce mouvement de révolte qui s'élève en la chair contre l'âme rebelle et qui les obligea à couvrir leur nudité, ils sentirent cette première mort où l'âme se trouve délaissée de Dieu (6). » Antérieurement la plupart des exégètes voyaient dans la mort physique l'explication, sinon de l'apparition des sexes, du moins de leur usage. Pour Augustin, l'acte sexuel n'a pas à attendre l'effacement des générations pour s'exercer, mais l'involontaire qui le hante maintenant signifie une mort spirituelle dont la fin successive des existences terrestres est aussi une manifestation. Le corps qui échappe à la volonté de l’homme est aussi un corps qui meurt : le retrait de la grâce tout à la fois soustrait cette maîtrise et actualise la mort (7).
À ce mouvement qui traverse et emporte tous les actes sexuels, qui les rend tout à la fois visibles et honteux, et qui les lie à la mort spirituelle comme à leur cause, à la mort physique comme à leur accompagnement — à ce mouvement ou, plus exactement : à sa forme et à sa force involontaires —, Augustin donne le nom de libido. C'est elle qui marque ce qu'il y a de spécifique dans les actes sexuels de l'homme déchu ; ou, en utilisant les mots d'un autre vocabulaire : la libido n'est pas un aspect intrinsèque de l'acte sexuel qui lui serait lié analytiquement. Elle est un élément que la faute, la chute et le principe de « réciprocité de désobéissance » lui ont associé synthétiquement. En circonscrivant cet élément, en fixant son point d'émergence dans la métahistoire, Augustin pose la condition fondamentale pour dissocier ce « bloc convulsif » selon lequel on pensait l'acte sexuel et son danger intrinsèque. Il ouvre un champ d'analyse et en même temps il dessine la possibilité d'un « gouvernement » des conduites sur un tout autre mode que l'alternative entre l'abstention ou l'acceptation (plus ou moins volontiers concédée) des rapports sexuels.
(1) : « Non adtenti, ut cognoscerent quid eis indumento gratiae praestaretur », SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIV, 17 (39).
(2) : [Ibid., XIV, 17 (39-40).]
(3) : Dans ce passage, AUGUSTIN ne reprend pas l'indication du De Genesi ad litteram sur le regard inducteur de concupiscence. Les yeux ne font ici que constater. Dans les deux livres Sur la grâce de Jésus-Christ et le péché originel, il souligne surtout qu’avant la chute il n'y avait pas de raison d'avoir honte : « Ce que Dieu avait fait ne devait inspirer aucune confusion à l'homme qui n'avait pas à rougir de ce que Dieu avait jugé à propos de créer en lui : cette nudité primitive de l'homme ne blessait le regard ni de Dieu ni de l'homme lui-même », II, 34.
(4) : Cf. dans le Contra Julianum, III, 16, l'affirmation que la distinction des sexes ne serait pas mauvaise ; même si aujourd’hui les hommes étaient à ce point dominés par la concupiscence que tous leurs actes sexuels se feraient contre les lois et les règles, « la condition des corps, tels que Dieu les a créés », resterait la même.
(5) : Ibid., IV, 62. Cf. également V, 23.
(6) : SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIII, 15. Cf. Sermon 179, 4 : « Nos premiers parents, après avoir péché, se sont fait des ceintures pour couvrir les parties honteuses du corps, qui nous donnent la vie et en même temps la mort » ; Discours sur le Psaume 9, 14 : « Les portes de la mort » sont peut-être à interpréter « comme les sens du corps et les yeux qui furent ouverts dans l'homme après qu'il eut goûté le fruit défendu ».
(7) : SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIV, 15, 2.
Michel Foucault, Histoire de la sexualité, IV. Les Aveux de la chair, édition établie par Frédéric Gros, collection « Bibliothèque des Histoires », Paris, Gallimard, 2018, III. Être marié, (3. La libidinisation du sexe), p. 336-338.
Il se trouve que cet éclairage de Foucault lecteur d'Augustin sur le mythe d'Adam et Ève m'a permis, au passage, d'identifier la possible signification d'un détail méconnu de la célèbre tapisserie (broderie) de Bayeux, visible dans la bordure en bas de la scène 13 indiquant « HIC : WIDO : AD DVXIT hAROLDVM ADVVILGЄLMVM : NORMANNORVM : DVCЄM » (« Ici, Guy [de Ponthieu] amena Harold [Godwinson] à Guillaume, duc des Normands »)...

Détail de la Tapisserie (broderie) de Bayeux, dite aussi Broderie de la reine Mathilde (Scène 13, bordure du bas), XIe siècle (c. 1070).
Broderie de laines sur toile de lin, 50 x 683,8 cm (taille complète de la broderie).
Bayeux, Musée de la Tapisserie.
Ce mystérieux couple nu, surpris en « pleine action », est généralement assez peu commenté, certains l'ayant simplement identifié comme un appel à la sexualité, plus précisément à la sexualité conjugale dans le cadre marital propre au XIe siècle. Je soupçonnais auparavant ce couple d'être éventuellement directement Adam et Ève, même si l'on pouvait toujours y voir deux de leurs descendants suivant les croyances chrétiennes de l'époque quant aux origines de l'humanité, mais le fait que ces deux personnages nus puissent être Adam et Ève eux-mêmes pourrait bien se confirmer, littéralement, à travers cet éclairage augustino-foucaldien décrivant l'instant décisif de l'épisode de la Genèse qui serait ainsi représenté sur la broderie : « La femme voile ce qui provoque le mouvement que l'homme doit cacher ; et celui-ci doit voiler ce qui provoque le mouvement caché en la femme. De toutes façons, la visibilité de l'organe masculin est au centre du jeu. »
Ainsi, à travers le péché originel, Adam et Ève ne découvrent pas le commerce charnel et le désir d'amour, qui étaient déjà là auparavant mais de manière innocemment maîtrisée : dans le sillage du péché, ils découvrent la nudité, le désir incontrôlé (manifeste, chez l'homme, aussi bien par l'érection que par l'impuissance), la honte, la mort, et aussi la possibilité de se tromper selon les choix que l'on fait. Ayant désobéi à Dieu, connaissant la Chute, les êtres humains se trouvent confrontés à la gestion de leur sexualité, celle-ci étant désormais marquée par des manifestations involontaires d'excitation et d'orgasme, chez l'homme comme chez la femme. Que faire face au caractère irrésistible de cet involontaire structurel ? C'est la question générale du « gouvernement » chrétien des âmes qui se trouve ainsi posée, et ici donc en particulier question de la conduite sexuelle des époux chrétiens. À cette aune, concevant le sujet sexuel comme sujet de droit, Augustin d'Hippone pense que la solution, rigoureusement codifiée, est le devoir conjugal pratiqué en suivant une doctrine rigoureuse de « volonté libidinale », selon une conception chrétienne de la chair à l'origine d'un sexe règlementaire et supposé « vrai » propre à nôtre culture occidentale. S'agissant de ce devoir conjugal qui, selon les Pères de l'Église, et comme mentionné déjà précédemment, n'est pas dépendant en soi de la procréation, Patrick Boucheron résume ainsi la chose dans son compte rendu de lecture de Foucault, qu'il cite dans la foulée : « puisqu'on ne peut échapper à la jouissance, au moins doit-on travailler à ne pas prendre du plaisir au plaisir, l'homme délivrant son épouse dévote de sa libido en l'aidant à ne pas accompagner les ébranlements inévitables du désir de son propre consentement[, lequel] pour Augustin [...] n'est pas « l'acceptation, par la volonté, d'un élément étranger ; [car pour Augustin, le consentement] est une manière pour la volonté de vouloir, en tant qu'acte libre, ce qu'elle veut en tant que concupiscence » » (Patrick Boucheron, "Foucault, Augustin et la chair", L'Histoire n°448, op. cit., p. 37, citant Foucault, Les Aveux de la chair, op. cit., p. 354).
Notons (et cela fera peut-être [encore ?] esquisser un sourire à Elendil) qu'il serait toujours intéressant d'avoir le point de vue de lecteurs et de lectrices, a fortiori s'ils sont mariés chrétiennement, au sujet de l'éventuelle actualité d'une telle conception codifiée de la sexualité conjugale, même si nous savons naturellement que, bien heureusement sur cette question, et pour citer Augustin lui-même, non vacant tempora (le temps ne chôme pas). Du reste, dans toute cette histoire de volonté libidinale, il n'est finalement a priori guère question de l'amour et de ses promesses — non pas l'amour augustinien dont Dieu est censé être la visée profonde, mais plus simplement et plus communément au jour d'aujourd'hui, l'amour défini comme cette affection réciproque entre deux personnes incluant aussi bien la tendresse que l'attirance physique —, alors que cela compte, du moins pour des esprits de nôtre époque, à bien des niveaux de relations, même sexuelles, et même dans un contexte où l'amour-sentiment et le plaisir sexuel ne dépendent pas en soi forcément étroitement l'un de l'autre. À cette aune, nous pouvons en tout cas peut-être deviner, au passage, ce que pourrait être ici l'appel de Sosryko à une certaine tempérance en vertu de laquelle « ce qui a toute sa place dans l'érotique du couple » n'a pas vocation à « prendre toute la place » (cf. Jean-Philippe Qadri, « Un secours comme son vis-à-vis », in Pour la gloire de ce monde, p. 117).
Pour ma part, mariage ou pas, j'ai plutôt tendance à suivre la réflexion sur l'amour de Michel de Montaigne dans ses Essais, réflexion que j'avais eu l'occasion d'évoquer dans un autre fuseau, l'année dernière : https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic. … 577#p88577
Pourquoi parler de tout cela ? Parce qu'avec la question du « gouvernement » chrétien des âmes, et ici en particulier de la sexualité conjugale chrétienne supposée marquée du sceau d'un involontaire libidinal issu de la Chute, il me semble que nous touchons à nouveau du doigt le problème du libre arbitre. Si l'objectif de l'être humain déchu est de bénéficier d'un « salut de l'âme » par Dieu, que doit-il faire pour y parvenir, a fortiori lorsque sa libido témoigne, entre autres, d'une dimension non maîtrisable de son être ici-bas ? L'être humain est en fait un peu coincé, entre un certain déterminisme ici-bas et l'action supposée d'un Dieu personnel tout-puissant par-delà le monde physique et de l'entendement humain. Alors que faire ? La faculté humaine à librement vouloir, penser et agir semble bien exister : c'est cela qui est censé correspondre ce que l'on appelle le libre arbitre. Mais la liberté de l'homme et de la femme est-elle de toute façon totalement entravée par le péché originel ? Augustin d'Hippone pense que oui, ce pourquoi il conçoit le libre arbitre de l'être humain comme étant dépendant de la grâce de Dieu pour choisir le « Bien ». Il a pu parfois reconnaître une certaine capacité de choix au chrétien dans son traité de jeunesse Sur le libre arbitre, mais face à la doctrine du pélagianisme qui promeut clairement la puissance du libre arbitre et de la volonté humaine pour obtenir le « salut de l'âme », Augustin durcira sa position : notamment dans son traité De la nature et la grâce, il affirme dès lors que seule l'aide divine, autrement dit la grâce, accordée aux êtres humains peut permettre le « salut », et il va encore plus loin dans ses derniers textes en évoquant une prédestination par la grâce, réservée à un petit nombre d'élus voués à être « sauvés » au sein d'une humanité perçue comme une « masse de perdition ». Mais si la volonté humaine n'a aucune prise sur l'obtention du « salut », pourquoi dès lors se prendre notamment la tête avec la sexualité et toute cette histoire de volonté libidinale, face aux irrésistibles excitations et orgasmes hérités du péché originel ? Parce qu'Augustin d'Hippone estime malgré tout que, dans la mesure où l'on ne sait pas, de toute façon, si Dieu vous accordera la grâce (peut-être que oui, peut-être que non !), il vaut mieux bien se comporter et être vertueux dans ce monde supposé « déchu », y compris donc avec un sexe règlementaire dans un cadre conjugal (cadre choisi, réalisé par le libre arbitre), sans pour autant par cela aspirer à l'obtention de la grâce en retour.
Ainsi le libre arbitre de l'homme (l'être humain) déchu peut-il apparaître comme une chose bien relative d'un point de religieux, même si la position d'Augustin concernant la grâce — position exprimée au Ve siècle de notre ère — est loin de s'être imposé de manière absolue au sein du christianisme, lequel a connu, pendant des siècles, bien des prises de tête théologiques s'agissant des rôles respectifs du libre arbitre et de la grâce dans le « salut ». La querelle de la grâce et du libre arbitre au sein de l'Église catholique — notamment aux XVIe et XVIIe siècles, dans le sillage du concile de Trente, entre les Dominicains (à la fois thomistes et augustiniens, insistant sur la toute-puissance divine) et les Jésuites (molinistes, insistant sur la liberté) — n'a jamais été tranchée par la papauté, ce qui, du point de vue de cette dernière, revient à dire, après bien des controverses et des débats contradictoires, que « maintenant, on arrête d'en parler, et on fait comme si tout le monde avait raison de penser ce qu'il pense » (au moins pour éviter un énième schisme !), sachant toutefois que le jansénisme, sorte d'ultra-augustinisme « pro-grâce », sera tout de même condamné par la papauté au XVIIe siècle.
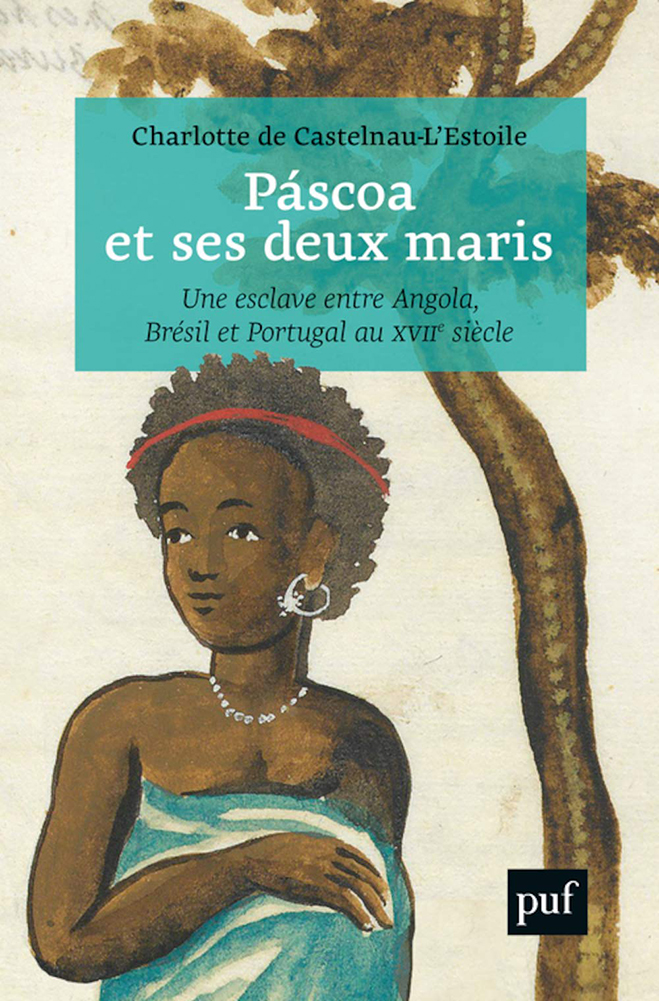
Cela m'amène, en suivant « quelque peu » — depuis l'Antiquité tardive d'Augustin d'Hippone — le cours du temps historique, à une autre lecture, celle d'un ouvrage historique de Charlotte de Castelnau-L'Estoile, Páscoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle (Paris, PUF, 2019, rééd. 2020). Ce livre, bien écrit, raconte l'histoire de Páscoa, une femme noire angolaise affranchie de la fin du XVIIe siècle, issue d'une autre culture que celles de l'Occident, baptisée lorsqu'elle était déjà une jeune fille appartenant à des maîtres, et qui, après avoir connue l'esclavage en Afrique puis à nouveau en Amérique du Sud après déportation, fut arrêtée en août 1700 par l'Inquisition à Salvador de Bahia, puis expédiée au Portugal où elle sera accusée par les inquisiteurs du tribunal du Saint-Office à Lisbonne de s'être mariée au Brésil alors qu'elle était déjà l'épouse d'un homme encore vivant en Angola. L'étude des sources du procès de Páscoa (qui dura quarante jours) par l'auteure/autrice révèle une part du destin d'une femme courageuse et intelligente (qui se défendra face ses juges, mais sera condamnée à l'abjuration et à trois années d'exil dans un forteresse au Portugal), ainsi que des réalités de l'époque. Il y a d'une part la réalité de la traite atlantique et de l'esclavage dans les territoires brésilien et angolais de l'empire colonial portugais, mais aussi la réalité du rôle très important de l'Église catholique dans les sociétés esclavagistes de l'époque, le christianisme étant alors tout-à-fait compatible avec l'esclavage, la traite massive d'esclaves entre Afrique et Brésil étant reconnu indirectement en 1585 par une bulle pontificale de Grégoire XIII (Populis ac Nationibus, à propos du remariage des « infidèles ») inspirée par les Jésuites, laquelle bulle conforta les pratiques esclavagistes de la majorité des Jésuites au Brésil ayant choisi de s'impliquer pragmatiquement dans ce processus économique liberticide, au nom de la réussite de leur mission chrétienne d'évangélisation des populations.
Ce qui interpelle particulièrement, en lisant le propos, stimulant, de Charlotte de Castelnau-L'Estoile, s'agissant de nôtre question du libre arbitre, ce sont les motivations de l'Inquisition portugaise telles que l'on peut les identifier à travers les sources liées au procès de Páscoa. Les inquisiteurs perçoivent l'accusée comme une femme intelligente, ayant compris ce qu'était le mariage, et ils jugent Páscoa « coupable du crime de bigamie et de la présomption de mauvais sentiment à l'égard de la foi catholique et du sacrement du mariage » (p. 188) mais sans s'être souciés d'une bonne part des informations ayant surgi pendant l'enquête, notamment à propos de la vie d'esclave de Páscoa, forte tête, fugitive, fréquentant intimement de façon imposée ou consentie d'autres hommes que son mari, bien au-delà d'un cas de bigamie. Le fait est que l'Inquisition « ne s'intéresse pas à la morale mais à l'hérésie » (p. 192), dont on est « légèrement » suspecté dans le cas d'un délit de bigamie, cette bigamie étant la seule chose semblant importer. « Les inquisiteurs demandent à Páscoa d'avouer qu'elle ne respecte pas ce qu'enseigne l'Église sur le mariage. Ils ne recherchent pas toutes les déviances religieuses possibles chez une esclave africaine du Brésil » (p. 198). Dans un monde où, selon la doctrine de l'Église à prétention universelle, le mariage chrétien et l'état de servitude sont compatibles et dans lequel le mariage est une obligation pour toutes celles et tous ceux qui vivent « dans le péché », les motivations de la justice inquisitoriales relèvent en fait essentiellement du maintien de l'ordre social face à de prétendues « déviances contre la foi » (p. 246-247) : même si elle essaie simplement (à nos yeux d'aujourd'hui) de reconstruire sa vie comme elle peut sur un autre continent, après une déportation l'ayant arrachée à son pays et à son conjoint (auquel elle ne semble, du reste, n'avoir été « chrétiennement » mariée en Afrique que d'une façon non conforme au rite catholique tridentin), une esclave suspectée de bigamie est avant tout source de scandale public. Cependant, l'esclave étant une personne sans droit, considérée comme un bien meuble, on peut se demander quelle place peut bien être accordé à son libre arbitre, a fortiori dans un perspective chrétienne d'aspiration au « salut », sachant qu'il est reproché à Páscoa d'avoir « péché contre son âme » (p. 246).
La question du mariage des esclaves a fait couler beaucoup d'encre dans le Brésil, dès le XVIe siècle (1). Pour les ecclésiastiques, il était important de pouvoir marier les esclaves. C'était une manière de prouver que l'état de l'esclavage n'empêchait en rien la salvation des âmes. Le mariage couronnait un parcours vers le salut : les esclaves amenés dans les mondes catholiques y étaient convertis et instruits dans la foi pour y recevoir les sacrements. Pour l'Église, il fallait pouvoir marier les esclaves, et en même temps affirmer clairement que le mariage ne rendaient pas libre et était compatible avec l'esclavage. [...]
(1) : Voir Charlotte de Castelnau-L'Estoile, « Le mariage des infidèles au XVIe siècle : doutes missionnaires et autorité pontificale », in Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 121, n°1, 2009, Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde : la curie romaine et les dubia circa sacramenta p. 95-121 (URL : www.persee.fr/doc/mefr_1123-9891_2009_num_121_1_10579 ) et « La liberté du sacrement Droit canonique et mariage des esclaves dans le Brésil colonial », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2010/6 (65e année), p. 1349-1383 (URL : https://www.cairn.info/revue-annales-20 … e-1349.htm ).
Charlotte de Castelnau-L'Estoile, Páscoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2019, rééd. 2020, chapitre 7 « Le mariage esclave et ses enjeux », p. 204.
D'un point de vue chrétien, suivant le droit canonique, pour un esclave, le libre arbitre n'existe en fait qu'à travers le libre choix de recevoir des sacrements, dont le mariage, mais le droit canonique niant tout pouvoir libérateur du sacrement vis-à-vis d'une loi humaine esclavagiste, les choses s'arrêtent là, même si, dans les sociétés esclavagistes, un sacrement comme le mariage pouvait apporter une certain dignité aux esclaves et éventuellement constituer, pour certains, une première étape vers la liberté ici-bas. Tout cela peut, en tout cas, peut-être donner une idée de ce que peut « seulement » être le libre arbitre, ici donc essentiellement dans une perspective religieuse chrétienne d'un « salut de l'âme ».
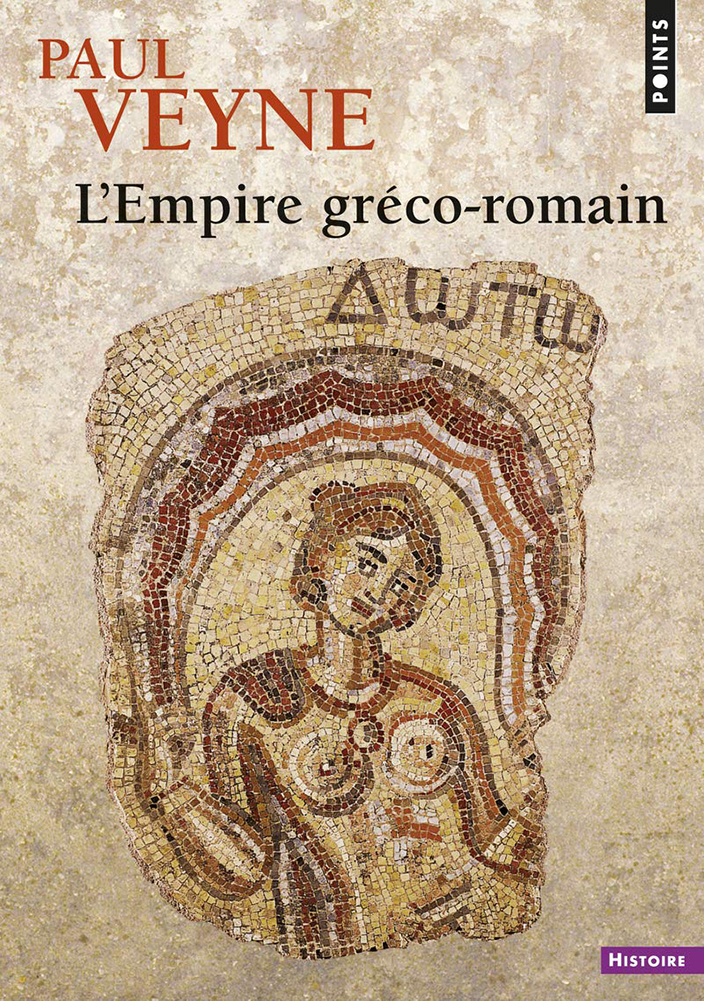
La relecture des Confessions d'Augustin m'avait déjà amené d'emblée à évoquer aussi bien le XVIIe siècle que l'Antiquité tardive. L'histoire de Páscoa m'amène finalement à remonter à nouveau quelques siècles plus en arrière, s'agissant de la question du christianisme et de l'esclavage : dans L'Empire gréco-romain (dont la belle couverture est illustrée par la mosaïque de la nymphe dite « Dotô », découverte à Saint-Rustice et conservée à Toulouse au Musée Saint-Raymond), Paul Veyne rappelle en effet que cette question s'est posée dès les premiers temps de l'histoire de la religion chrétienne.
Jésus, ou l'Évangile, n'envisageait nullement d'éventuelles applications sociales, pas plus qu'il ne songeait à renverser la domination romaine. Certes, né dans un milieu de pauvres gens et s'adressant à de pauvres gens, l'Évangile « est un livre où le prêtre est toujours en faute, où les gens comme il faut sont tous des tartuffes, où les autorités laïques se montrent comme des scélérats, où tous les riches sont damnés (1) ». Oui, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu (2), mais la raison en est que les riches ont le cœur dur ; pour être sauvés, ils devront devenir humbles et pauvres en esprit. L'utopie évangélique n'excluait ni n'approuvait l'esclavage ou la propriété privée : elle n'y pensait même pas et n'y pensera jamais (3), sauf peut-être au XIXe siècle.
En effet, les hommes sont frères moins par leur condition et leurs besoins que parce qu'ils ont tous été rachetés par le Christ : ils sont égaux et solidaires « en Christ » et quant à leur âme éternelle. Nous sommes tous frères dans le Christ, dit saint Paul, désignant par là une participation à la vie de l'Église et une communion personnelle avec le Seigneur ressuscité. L'utopie du règne de l'amour entre petites gens a pris fin ; dès que s'organisent les Églises, la charité ne consiste plus à révolutionner les rapports interhumains, mais à aimer son prochain « en Christ », c'est-à-dire à vouloir son salut éternel ; et, si l'on est le pasteur d'un petit troupeau, à exercer son pouvoir pastoral en conséquence. La grande affaire était le salut éternel, non le bonheur terrestre. Saint Paul rappelle donc aux femmes et aux esclaves que leur devoir est d'être soumis à leur maître et à leur mari, et à tous ses disciples qu'ils doivent obéir au pouvoir, qui vient de Dieu. « Veux-tu ne pas avoir à craindre le gouverneur ? Agis bien et il te louera, car il est au service de Dieu pour ton bien (4). » Les esclaves restent esclaves, mais leur maître les considère comme ses égaux en Christ (5).
(1) Ernest Renan, Histoire des origines du christianisme, éd. Rétat, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1995, Les Évangiles, chap. XI, p. 380.
(2) Mathieu, XIX, 24.
(3) Le traité pélagien De divitiis, dans l'esprit rigoriste et autoperfectionniste de Pélage, sera, au début du Ve siècle, « la critique la plus profonde et complète de la richesse et de l'inégalité sociale que l'Antiquité nous ait léguée ». Mais cette critique ne vise pas à une révolution sociale : elle enseigne aux riches à abandonner leurs richesses, afin de faire leur salut, car la richesse provient du péché et incite à pécher. Voir P. Garnsey et C. Humfress, L'Évolution du monde de l'Antiquité tardive, trad. Regnot, Paris, La Découverte, 2004, p. 221-228.
(4) Saint Paul, Aux Éphésiens, V, 21, et VI, 5 ; Aux Colossiens, III, 18 et 22 ; Aux Romains, XIII, 3-4.
(5) Chez les païens, écrit Lactance, il y a des riches et des pauvres, des maîtres et des esclaves ; or, « là où tous ne sont pas égaux, il n'y a pas d'égalité, et l'inégalité suffit à exclure la justice, qui repose sur le fait que tous les hommes naissent égaux ». On pourrait me rétorquer, continue Lactance, qu'il y a aussi des riches et des pauvres, des maîtres et des esclaves chez nous, chrétiens. Certes, mais nous les considérons comme des égaux et des frères, car ce qui compte est l'esprit et non le corps ; nos esclaves ne sont asservis qu'en leur corps, en esprit ce sont nos frères (Institutions divines, V, 14-15).
Paul Veyne, L'Empire gréco-romain, op. cit., p. 718-720.
Après avoir ainsi évoqué toutes ces lectures ou relectures, que penser du libre arbitre ? Que c'est une notion dont la discussion n'est pas aussi aisé que l'on aurait pu le croire... dans la mesure où elle me parait, tout de même, être un peu à géométrie variable, selon que l'on se place :
- soit d'un point de vue qui me parait relativement universel sur un plan simplement humain, celui de la liberté de choix et d'action à une échelle humaine qui n'est, au mieux, ni tout-à-fait animale, ni tout-à-fait divine ;
- soit d'un point de vue dont j'estime discutable la prétention universelle sur un plan humain, celui d'une pensée religieuse particulière, renvoyant à une mythologie particulière (devenue dogme), et qui semble n'accorder, notamment au regard de l'histoire de l'humanité (depuis l'Antiquité tardive jusqu'à l'époque de Tolkien, en passant par le XVIIe siècle, s'agissant de ce que j'ai pu partager ici en matière de lectures ou relectures), qu'une valeur très relative à la liberté ici-bas par rapport à la seule liberté d'opter ou non pour un salut par la grâce d'un Dieu personnel.
N.B.: S'agissant de la question de l'universalité, je conçois les deux points de vue évoqués comme procédant essentiellement, et au moins principalement, de la culture ou des cultures occidentale(s), et je reste prudent en songeant aux limites et aux particularismes que comportent bien souvent tout universalisme ou idéal universaliste (en songeant notamment, sur un plan culturel et civilisationnel, à l'actuelle situation, pour le moins difficile et paradoxale, d'un pays comme la France, dont le drame semble être d'incarner aujourd'hui une sorte d'universalisme solitaire, face à un tas d'ennemis dans le monde et aussi quelques faux alliés : amère leçon de « civilisation » et de cosmopolitisme... sur fond, peut-être, de ce crépuscule plein d'excès de tous bords auquel Chantal Delsol a consacré un livre assez récemment).
Cependant, in fine, je ne peux m'empêcher de me dire qu'en matière de libre arbitre, plutôt que de se focaliser sur un point de vue religieux particulier qui aurait en quelque sorte le monopole de l'usage du terme, il me parait bien plus préférable, ne serait-ce que dans la perspective d'appréhension ouverte en matière de pensée et d'échange, de concevoir ledit libre arbitre comme faculté à librement vouloir, penser et agir... dans le temps qui nous est imparti, dans le cadre physique connu qui est le nôtre, dans la condition (humaine) fondamentalement incertaine qui est la nôtre en ce monde, et cela quelles que soient nos différents régimes de croyances (cf. Croyances d'Henri Atlan, déjà cité ailleurs) et nôtre rapport à la métaphysique.
À présent revenons donc plus précisément à J. R. R. Tolkien, et à la conclusion de Jérôme/Yyr, à laquelle je réagirais à la fois s'agissant du libre arbitre et s'agissant d'autres aspects, le tout renvoyant à cette difficulté de discuter d'un sujet supposé commun que j'ai évoquée depuis le début.
Revenons d'abord, puisque une interrogation de Yyr restait semble-t-il en suspend, au même extrait de lettre de Tolkien qu'au début, et qui est celui-ci, pour mémoire :
Il est probable que nous nous retrouverons, sous l'œil de Dieu, tout entiers et unis, dans peu de temps, très cher petit ; et il est certain que nous avons un lien spécial qui durera au-delà de cette vie - toujours soumis, bien entendu, au mystère du libre arbitre, par lequel l'un comme l'autre pourrions rejeter le « salut ». Auquel cas Dieu arrangerait les choses différemment ! [...]
J. R. R. Tolkien, lettre n°64 (30 avril 1944) à Christopher Tolkien.
S'il faut distinguer ici le libre arbitre à exercer dans son quotidien et à tous les niveaux de son existence d'une part, et « LE » libre arbitre qui ne serait à exercer, fondamentalement, qu'en acceptant ou refusant le « salut de l'âme » censé être accordé par le Dieu personnel de la Bible, il semble bien que dans cette lettre, à l'évidence, la notion de libre arbitre ne soit entendue que dans un sens religieux. Concerne-t-elle la vie envisagée après la mort ? Sans doute en partie, puisque l'on peut toujours imaginer la supposée créature de Dieu lui dire, au dernier moment, alors qu'elle est déjà au seuil d'un possible autre monde meilleur que celui ici-bas : « Non, finalement, le salut ne m'intéresse pas. » Toutefois, Tolkien semble parler plus largement de toutes les occasions de « rejeter » le « salut » durant tout le temps qui sépare l'être humain de la mort. Personnellement, je ne sais pas trop en quoi Dieu, s'Il existe, « arrangerait les choses différemment » en cas de rejet du « salut de l'âme » « au-delà de cette vie » : est-il donc là question de l'Enfer promis aux hérétiques, schismatiques, athées et autres apostats, tous supposés être « soumis à l'esprit du Mal » selon Tolkien ? Peut-être... Cela semble faire écho au propos d'une lettre déjà citée régulièrement lors d'échanges ici et ailleurs : la lettre n°96 (30 janvier 1945), autre lettre à Christopher Tolkien, dans laquelle J. R. R. Tolkien écrit : « Naturellement, j'imagine que, en fonction de la permission accordée par Dieu, le peuple des hommes dans son ensemble (tout comme chaque individu) est libre de ne pas s'élever de nouveau mais d'aller à sa perdition et de poursuivre la Chute jusqu'à son terme ultime (tout comme chaque individu le peut singulariter). » Et l'écrivain d'évoquer plus loin « l'esprit du Mal », avec notamment l'idée qu'il se fait du « Socialisme », idée que je persiste à considérer comme grossière, injuste et insultante, et qui cependant n'est guère étonnante de la part de quelqu'un qui trouvait, à la même époque, des « qualités » à Francisco Franco... mais j'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs fuseaux ce que je pense du jugement (ni « apolitique », ni de grande portée) de Tolkien en la matière...
Je suggère humblement une possibilité : lorsque Tolkien affirme que “God would arrange matters differently!” en cas de rejet du « salut » (“salvation”) par lui ou bien par son fils, à en juger par le contexte intime de la lettre et la formulation du propos, peut-être se laisse-t-il aller, en fait, à un possible trait d'humour à l'anglaise, un peu « pince sans rire », l'« arrangement » divin n'étant dès lors pas à entendre au pied de la lettre, mais dans un sens décalé pour désigner un sort distinct du père et du fils dans l'au-delà n'ayant in fine rien de particulièrement « arrangeant » pour leur « lien spécial » père/fils. Ce n'est là qu'une simple hypothèse de ma part, naturellement, mais qui tient compte du caractère très personnel de la lettre en question.

Paul Gauguin (1848-1903).
D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1897-1898.
Huile sur toile, 139,1 × 374,6 cm
Boston, Museum of Fine Arts, Tompkins Collection.
En ce qui concerne la cohérence que l'on trouverait chez Tolkien, cohérence que ladite lettre n°64 confirmerait, et qui serait, si j'ai bien suivi, une cohérence ontologiquement chrétienne et donc à l'image de la cohérence que serait censé incarner le « Christianisme » (avec un grand C), il me semble que cela suppose un parti pris nous éloignant de la littérature, un peu comme quand l'on choisit la première option s'agissant de la question « la Bible est-elle la Parole de Dieu sur l'homme, ou bien la parole de l'homme sur Dieu ? » Libre sans doute à l'exégète chrétien de voir apparaître de la cohérence partout, et de se réjouir qu'il n'y ait plus de paradoxes ou de contradictions, dès lors que l'on affirme sans nuance que la « Vérité » est du côté de l'existence du Dieu personnel des religions du Livre et d'une action dudit Dieu (la grâce) sur les êtres humains indépendamment de leur conduite : cela ne change rien, me semble-t-il, aux interrogations de base du célèbre tableau de Gauguin (D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?), interrogations qui ne sont pas prêtes d'être résolues dès lors que l'on est animé, comme peuvent notamment l'être les sceptiques non dogmatiques, d'une quête inassouvie de la vérité, celle de ceux qui auront toujours soif et qui, en conséquence, ne se satisferont pas du positionnement des personnes qui, religieuses, ne cherchent pas la vérité avec eux mais désirent les y amener, au risque de se méprendre peut-être en cela sur la nature même de la soif d'autrui. Les contradictions ne cachent peut-être que des ignorances (les exégètes chrétiens aiment beaucoup affirmer cela), mais ce n'est pas une raison pour prétendre avoir identifié la « Vérité » à propos de nôtre condition, compte tenu des dimensions irréductibles et plurielles des modalités de la vérité (les « modes de l'englobant » dont parle Karl Jaspers). À mes yeux, la quête insatiable de la vérité dont j'ai parlé précédemment suppose d'assumer d'avoir « toujours soif », tout en assumant aussi d'envisager une part possiblement incompressible d'ignorance, et aussi même, en certaines circonstances, un certain art de la retenue en matière de « droit de savoir ». Voila dès lors ce que peut notamment signifier l'expression « la vie est mouvement », lorsqu'il m'arrive de l'employer. Parce que nous devons chercher le vrai du réel, nous ne pouvons pas (nous ne devons pas) nous satisfaire du peu de savoir que croyons posséder, nous ne savons évidemment jamais assez de choses, et pourtant ne pas savoir peut aussi faire partie de notre vie : à nous de nous débrouiller ainsi avec notre condition, en cherchant la vérité, pour ce qui me concerne, sans me douter de ce qu'elle est.
À cette aune, en songeant au passage au titre de l'ouvrage apologétique de Chateaubriand Génie du christianisme, Tolkien ne saurait m'apparaître comme génialement inspiré (en tout cas pas plus que d'autres créateurs partant, comme tout le monde, de ce qui existe autour d'eux) en matière de cohérence, d'autant plus que son œuvre n'est pas sans défauts démiurgiques, du fait même des difficultés qu'il a eu, notamment vers la fin de sa vie, à faire « parfaitement » coïncider sa subcréation avec ses préoccupations religieuses, devenues de plus en plus centrales pour lui avec l'âge, alors que cela n'avait forcément toujours été le cas par le passé...
Pour en revenir, à nouveau, particulièrement à la lettre n°64, je ne vois, au mieux, qu'un intérêt assez limité à l'associer à l'œuvre littéraire de l'écrivain, quand bien même il y est question aussi bien, d'une part, de la conception chrétienne du libre arbitre selon Tolkien que, d'autre part (NB: dans un deuxième temps, et alors que la lettre a été, du reste, publiée de façon tronquée) de la rédaction du Seigneur des Anneaux — on aurait tort, à mon sens, de refuser de faire cette distinction entre deux parties, ne serait-ce qu'en l'état actuel de notre connaissance du texte de la lettre en question.
Considérer le Seigneur des Anneaux et l'ensemble des écrits du Légendaire comme l'héritage chrétien d'un père et d'un fils, désormais réunis au Paradis sous le regard du Dieu personnel des religions du Livre, relève d'un parti pris, évidemment légitime comme toute opinion de lecteurs, mais naturellement avec les limites propres à tout parti pris. Au-delà même des considérations religieuses, je note du reste un attachement particulier de Jérôme à la relation père/fils entre J. R. R. Tolkien et Christopher T. : Yyr semble particulièrement touché par cela, sans doute pour des raisons personnelles, quand pour ma part, cela ne me touche pas du tout. Sosryko salue la « louange d'une pensée et d'une œuvre qui nous touchent toujours autant », mais qui est au juste ce « nous », et renvoie-t-il à des lecteurs forcément tous touchés par les mêmes choses chez le même écrivain, a fortiori dans un sens qui ne pourrait être, au fond, que religieux et/ou « familial » ? Quant à se dire « Tolkiendil », pour exprimer un fervent hommage individuel, je comprends bien le sens du propos (que je respecte, évidemment), mais j'avoue me sentir un peu dépassé par une si étroite association faite entre l'attachement à une œuvre — que nous pouvons tous partager au moins sur le principe — et l'attachement semble-t-il identique à l'homme derrière l'œuvre : personnellement, quand il m'arrive de parler moi-même d'amitiés littéraires, c'est à l'égard des œuvres que j'aime que je m'exprime, mais en me gardant bien, notamment, de me prétendre « ami » des auteurs du passé en tant que personnes, largement inconnues de moi, malgré ce que l'on peut savoir d'elles par leurs correspondances ou des biographies, sources d'informations qui, du reste, ne rendent pas toujours forcément les personnes humainement aussi intéressantes et/ou attachantes que leurs œuvres. Mais ce n'est évidemment là que mon point de vue, respectueux par ailleurs de celui des autres lecteurs...
J'ai commencé ce message en évoquant ma grand-mère, qui était très pieuse, et dont la foi m'inspire toujours un profond respect ainsi qu'un souvenir ému par-delà la mort, et j'ai évoqué ce à quoi certains propos de Tolkien à son fils pouvait me faire penser à cette aune. Cela ne veut pas dire que je devrais faire un lien « sentimental » avec une œuvre littéraire que je n'ai notamment jamais abordé comme on lirait une œuvre explicitement prosélyte comme celle de C. S. Lewis. À chacun de faire les liens qu'il veut, sans prétendre avoir trouvé la vérité plus qu'un autre (j'avoue, à cet égard, que j'ai toujours éprouvé une certaine gêne devant la ferveur de certains lecteurs de Tolkien). Le monde, à bien des égards, est contradiction, au moins en apparence, et à force de traquer la cohérence partout, on finirait presque par oublier que ce n'est peut-être pas, au fond, le but de la vie que d'appréhender la « Vérité » — peut-être à jamais cachée, du moins ici-bas — à l'aune d'une cohérence supposée perceptible par nos pauvres esprits (ou nos âmes), y compris à travers les histoires que nous nous racontons, que nous avons besoin de nous raconter, nous êtres humains, si faillibles et si imparfaits. Mon sentiment, j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire, ici ou ailleurs, est que nous marchons, toutes et tous, sur une ligne de crête, entre nature et culture, entre tradition et modernité, mais aussi entre matériel et spirituel, entre visible et invisible... J'ai parlé de cette quête insatiable de la vérité qui, je crois, est et reste la mienne à titre personnel, mais cela ne veut pas dire qu'il faille tomber dans les excès propres à ceux qui tombent d'un côté ou de l'autre de ladite ligne de crête.

Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco de Goya (1746-1828).
El sueño de la razon produce monstruos (Le sommeil de la raison engendre des monstres).
Gravure de la série Los caprichos, 1799.
Eau-forte et aquatinte, 21,6 x 15,2 cm.
Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie.
L'année passée, 2020, a été l'occasion d'observer un phénomène consternant, que j'ai vu évoqué assez récemment à la télévision française, au hasard d'un zapping nocturne pendant la période des fêtes, par Alain Finkielkraut, partant d'une référence artistique ci-dessus reproduite et qui, je l'avoue, me parle : si la Raison endormie, en sommeil, engendre des monstres, comme l'a si bien représenté Goya dans sa célèbre gravure, il s'avère que la Raison éveillée, lorsqu'elle se révèle finalement trop éveillée, lorsqu'elle ne laisse pas de place au hasard, à la contingence, à l'aléa, à l'intempestif, au tragique, elle peut aussi engendrer des monstres. Sans me prendre pour Nostradamus, loin s'en faut, mais me voulant tout de même lucide sur la condition humaine, j'avais « prédit » ailleurs, en mars dernier, qu'avec la plus grande pandémie depuis un siècle qui nous a surpris sur toute la Terre au début de l'année passée, nous allions connaître à nouveau des temps historiques où l'humanité se retrouve confrontée, de plein fouet, à sa propre bêtise. Ce n'était pas une prédiction très difficile à faire, et elle s'est vérifiée sans surprise. Une des plus importantes manifestation de cette bêtise, à mes yeux, a été le nombre incroyable d'imbécillités déversées médiatiquement sur l'humanité, principalement à travers ce Café du Commerce géant que sont trop souvent les « rézosocios » numériques. On a ainsi voulu, à toute force, débusquer la vérité et savoir qui était responsable du virus, quel « complot » cela pouvait-il cacher, quel « mauvais coup » les puissants de ce monde préparaient non seulement avec ce virus, mais aussi avec les masques, les confinements, les vaccins, etc. De mon point de vue de sceptique modéré, faisant généralement raisonnablement confiance à la science, il (m')a été pénible de constater combien le scepticisme érigé en esprit de système est, évidemment, aussi nuisible à l'esprit humain que peuvent l'être, par exemple, le communisme dogmatique prêt à écraser les individus à l'aune d'une lutte des classes érigée en dogme (une critique pertinente d'une société structurée par le rapport de classes ne justifie pas, en aucune manière, une idéologie excluante avec aspiration aveugle à une dictature du prolétariat menant plus ou moins à un régime de caserne), ou le « vrai » christianisme se réclamant de la « Vie » (dont il n'a pourtant pas une connaissance « supérieure » ou même « normale ») pour condamner le droit à l'IVG (un droit à l'IVG fort heureusement désormais enfin inscrit, tout récemment, dans la loi en Argentine, le propre pays du pape actuel : après trente ans de lutte, et quarante-cinq ans après les femmes françaises, les femmes argentines obtiennent enfin le droit de choisir — choix grave, mais ô combien nécessaire — d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant... soit le droit, ni plus, ni moins, d'exercer leur libre arbitre s'agissant d'une question où ledit libre arbitre ne peut qu'occuper une place essentielle ; que des "vrais chrétiens" ne puissent pas comprendre cela me dépasse complètement, mais c'est ainsi et je n'y peux rien). Ainsi devons-nous, toutes et tous, particulièrement dans les sociétés censées être démocratiques, assumer ce qu'implique la vraie liberté, qui est un bienfait autant qu'une blessure (vis-à-vis de ce qu'implique la liberté... des autres, autant que de soi-même)...
Folie, folie, folie que de vouloir, en tout cas, instaurer en principe absolu non seulement ses croyances, mais aussi ses doutes. Le réel est complexe, l'idéal ne peut le soumettre, et le doute lui-même — acte d'engagement si précieux contre la bêtise et que Michel Adam a si bien défendu dans son livre Essai sur la bêtise longuement cité ailleurs —, ne doit pas être subverti face lui, ce réel qui est ce qu'il est, et que nous avons si souvent du mal à appréhender, au delà de tant de discours de façade. Face à ce réel, tout sceptique que l'on peut être, il faut savoir aussi convenir parfois que la Raison ne peut pas toujours tout expliquer, pas plus que la pensée religieuse, la légitime recherche des causes ne devant pas forcément se confondre avec la recherche (de nos jours très à la mode) des responsabilités. En voyant ainsi, le mois dernier, Finkielkraut faire sien le sage propos d'une infectiologue et rappeler in fine à la télé que « le responsable du virus, c'est le virus » tout simplement, je ne pouvais qu'être d'accord avec lui, et la leçon qu'il a retenue de cette pandémie, celle des excès nés de la Raison éveillée ne valant pas mieux que les excès nés de la Raison en sommeil, je la retiens moi-même, comme tout être humain se disant rationnel devrait pouvoir le faire, quelles que soient par ailleurs ses opinions politiques et religieuses.
(Une « parenthèse », au passage)
J'ai appris il y a quelques jours que Finkielkraut s'était fait virer de la télé (est-ce la première fois ? Je ne sais plus...), suite à une chronique certes peut-être en partie un peu « maladroite » sur un sujet sensible (l'intellectuel se voulait subtil : à la télé, de nos jours, c'est devenu risqué) mais qui ne méritait tout de même pas une « expulsion ». Le côté réac' de Finkie n'est pas ma tasse de thé sur le principe, mais c'est tout de même un type intelligent, rationnel, avec certes ses obsessions et son caractère, mais plus cultivé et moins égocentré que bien d'autres intervenants intellectuels médiatiques et autres « polémistes » des plateaux de chaînes d'infos. Même si je n'écoute qu'épisodiquement l'émission de Finkie (« Répliques ») sur France Culture, et que je commençais à peine à suivre ses chroniques hebdomadaires sur la chaîne LCI avant qu'il ne se fasse virer la semaine dernière, j'ai toute de même pu constater qu'il m'arrive d'être d'accord avec lui plus souvent qu'il y a dix ou quinze ans. J'ai lu récemment son livre À la première personne (Gallimard, 2019), dans lequel il retrace son parcours et réplique à ceux qui le disent réactionnaire : je n'avais pas ouvert un livre de lui depuis les années 2000. C'est à la fois bien écrit, concis, et clair : Finkie est peut-être réac' sur certains points, mais il ne l'est pas tant que ça, voire même pas du tout, sur bien d'autres. Certes, il n'aime pas le rap, mais il écoutait (en boucle, ai-je lu ailleurs) l'album Sgt. Pepper's des Beatles en 1967, et au-delà des questions de goûts, il dit dans ce livre, par exemple, des choses intéressantes sur « le pathétique de l'amour » dans le sillage de Lévinas, sur les nouvelles (et redoutables) formes de l'antisémitisme, sur les excès du tourisme contemporain... et ce qu'il écrit sur « l'empire dévastateur de l'esprit de la technique sur tous les domaines de la réalité », sur cet « esprit de la technique » qui notamment « a chassé et supplanté le génie de la langue », me parait dans l'ensemble être juste et pertinent. Finkielkraut ne roule pas pour « la droite » conservatrice ou pour l'antimodernisme que je critique : c'est en fait, à bien des égards, un esprit moderne, mais simplement dramatiquement « inactuel » dans le zeitgeist ambiant, lui qui s'efforce de combattre le fanatisme religieux tout en ne cédant rien à ce qu'il appelle le « nihilisme égalitaire » faisant selon lui disparaître la culture dite classique au nom du « Progrès ». J'avoue que je comprends ses préoccupations, sans doute davantage aujourd'hui que lorsque j'étais plus jeune. Serait-ce donc un précoce signe annonciateur de vieux-conisme me concernant ? ^^' Mmm... je ne crois pas (enfin j'espère !) : quand quelqu'un est perspicace et lucide sur tel ou tel sujet, il m'est simplement naturel de le reconnaître. Le problème, c'est surtout l'époque, qui s'offense de tout, soumise à la tyrannie de l'urgence et des apparences, une époque de facto peu propice à la réflexion, à la pensée et aux discussions rationnelles non biaisées. À croire, parfois, que la noosphère (cette « sphère ou couche humainement pensante » de la planète selon Vernadski et Teilhard de Chardin) aurait un jour vocation à se confondre avec la bêtise humaine (pour ne pas dire autre chose)... Souhaitons évidemment que non. Mais le regretté George Steiner le soulignait déjà, il y a vingt ans : dans un contexte culturel qui était déjà « bruyant », à la question posée (par le journal Libération à l'occasion de l'an 2000) « À quoi pensez-vous ? », il répondait « En premier lieu : à l'extrême difficulté de penser. Au sens sérieux du terme. »
(Fin de la « parenthèse »)
Pourquoi parler de tout cela ? Parce qu'en conclusion, il a été notamment question de Mystère, avec une majuscule théologique, quand pourtant, avec la Raison ni trop endormie, ni trop éveillée, on devrait pouvoir aussi, à mon humble avis, aborder la question autrement qu'en ramenant tout, encore une fois, à la foi d'un J. R. R. Tolkien. La vie est un mystère, quelles que soient les histoires (les mythes) que l'on se raconte pour habiller la chose. Pourquoi ne pas l'assumer, au-delà de toutes les histoires que se content les êtres humains depuis la nuit des temps ? On connait la croyance de Tolkien en un mythe (celui, transmis par les Évangiles, de Jésus-Christ et de la Révélation chrétienne) qu'il estimait être plus « vrai » que les autres, voire même être le seul « mythe vrai », certes, mais seule une lecture très (trop ?) étroite des textes peut, me semble-t-il, éventuellement rendre « évident » un « message » catholique dans la fiction tolkienienne, à condition notamment de placer à peu près sur le même plan toutes sortes d'écrits, pas tous dédiés en soi à la publication, loin s'en faut. Si « message » il y a, il pourra paraître explicite dans des textes comme « Laws and Customs among the Eldar », mais je doute qu'il soit bien évident dans un roman comme le Hobbit, par exemple, malgré la lecture chrétienne que l'on pourra toujours en faire par ailleurs. Faërie, à mes yeux, ne subsume pas à (ou sous) la Vérité chrétienne, ainsi que j'ai déjà pu l'écrire. Et la création, à cette aune, peut ainsi apparaître aussi mystérieuse que la vie elle-même, se faisant à cette mesure le « véhicule » de celle-ci, si l'on veut, et du fascinant mystère qu'est la vie. Mais nul besoin, à mon sens, de théologie pour concevoir cela et pour le comprendre en lisant Tolkien qui, contrairement à Lewis, n'a pas proposé une œuvre (pour ce que j'ai lu de Lewis) si truffée de symboles plus ou moins explicites et explicables qu'il m'est difficile de ne pas voir le prosélytisme chrétien dans sa fantasy, quand ledit prosélytisme me parait bien absent (que cela ait été volontaire ou non) chez Tolkien, catholique auteur et non auteur catholique, pour reprendre la formule de Leo Carruthers. Nous pouvons bien sûr toujours essayer de ne pas nous arrêter aux apparences pour identifier un éventuel « message » chez un auteur comme Tolkien, sachant bien cependant que l'intéressé, à propos de son œuvre littéraire, n'a pas tenu à tous le même discours « identitaire catholique » qu'à Robert Murray dans sa fameuse lettre n°142, mais je ne crois pas qu'il y ait un « message » particulièrement « éclatant » autrement qu'en « faisant parler » l'auteur d'une manière telle que l'on en finit par courir, en quelque sorte, le risque de faire basculer l'œuvre dans un sens qu'elle n'avait pas plus que cela à la base.

Alan Lee (né en 1947).
The Shadow of the Past (esquisse), 1991.
Dessin préparatoire pour l'édition illustrée dite du centenaire (Harper Collins, 1992) de The Lord of the Rings de J. R. R. Tolkien.
Crayon sur papier, dimensions non répertoriées.
Collection privée.
All we have to decide is what to do with the time that is given us.
(Tout ce qu'il nous appartient de décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti.)
J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, I, 2 (“The Shadow of the Past”).
« Tout ce qu'il nous appartient de décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti » : quand Gandalf déclare cela à Frodo, dans le confort du trou de hobbit qu'est la maison de Bag-End, alors qu'il vient de reconnaître l'Anneau Unique dans l'anneau d'invisibilité que ledit Frodo a hérité de Bilbo, avec tous les dangers soudain devenus immédiats que cela comporte, il met en évidence la condition des personnages dans la subcréation tolkienienne, essentielle a minima d'un point de vue narratif : une condition d'êtres disposant d'un libre arbitre, que cela soit ou non dû à Ilúvatar/Eru/Dieu. L'horizon monothéiste de l'univers d'Arda est tributaire d'une tradition textuelle fictive : à cette aune, et même si l'on devait échapper là à quelque intention de l'auteur, il n'y a pas d'injonction à croire que le libre arbitre ne soit pas ici autre chose... que le libre arbitre dans un sens général, celui de faculté à librement vouloir, penser et agir, sens n'ayant pas vocation en soi à être religieux, même en tenant compte de l'identité surnaturelle de Mithrandir. Et le sort que connaîtra l'Anneau à la fin du roman, dans un contexte où le libre arbitre se révèlera ironiquement dépassé par l'aléa, la contingence, le tragique, ou éventuellement « autre chose », rappelle comme pour boucler la boucle ce que représente la libre volonté de l'être humain, source de pouvoir autant que de faiblesse, quel que soit le régime de croyances de l'individu. C'est du moins ainsi que j'ai tendance à voir les choses...
Si j'évoque en particulier, comme assez souvent du reste, cette citation sur « quoi faire du temps qui nous est imparti », citation qui sert d'ailleurs d'épigramme à ce long message, c'est qu'elle est assez révélatrice de la façon dont j'apprécie personnellement Tolkien, c'est-à-dire finalement davantage par petites touches que par appréhension « totalisante » d'un grand ensemble — grand ensemble finalement inachevé, lacunaire, parfois contradictoire, à l'image de nos connaissances face aux incertitudes du Monde dit Primaire —, avec un roman comme Le Hobbit, voire avec des éléments particuliers d'un livre comme le Seigneur des Anneaux — la section bombadilienne, le fragment de l'histoire d'Aragorn et Arwen... —, avec certains poèmes censés être extraits du Livre Rouge, avec certains motifs et récits figurant pour partie notamment dans le Silmarillion ou dans d'autres livres posthumes comme les Enfants de Húrin et Beren et Lúthien... Le monde secondaire, à mes yeux, est finalement surtout une toile de fond, certes minutieusement peinte et fort appréciable pour cela, une toile sur laquelle peut certes prospérer notamment le « vice secret » des langues inventées et une certaine herméneutique chrétienne, mais je crois que, littérairement parlant, l'intérêt principal est ailleurs, avec une subcréation, certes, mais dans le peu qu'elle donne finalement formellement à voir et non dans la totalité de ce que l'on peut croire qu'elle « recouvre ». Autrement dit, l'intérêt de mon point de vue réside dans ce pouvoir de suggestion dont j'ai parlé ailleurs, dans un autre fuseau : https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic. … 213#p89213
J'ai parlé plus haut de ligne de crête : celle-ci peut s'appréhender également comme une ligne entre ensemble et détail d'un ensemble, de même qu'entre le matériel et le spirituel, entre autres, car ni le détail, ni l'ensemble ne constituent sans doute en soi une finalité.
Sur la question du libre arbitre comme sur d'autres, démontrer la pensée chrétienne de l'auteur derrière l'œuvre peut certes aboutir à des résultats, mais si ceux-ci ne font que s'apparenter in fine à une « lewisisation » de la fiction tolkienienne, j'ai bien peur que ce qui n'était censé même apparaître dans l'œuvre que « comme une lampe invisible », ne devienne comme un projecteur aussi aveuglant que dans une salle d'interrogatoire propice à la lumière la plus froide... Du moins est-ce mon point de vue, dont je ne dirais pas qu'il n'est pas empreint d'une certaine tristesse, mais qui est en tout cas sincère. Bien sûr, comme dirait Vincent (F.), « à chacun son Tolkien », et toutes les lectures de l'œuvre sont légitimes... mais dès lors peut-être toutes ses lectures portent-elles forcément en elles des limites difficilement dépassables en matière de partage...
Parce qu'elle permet notamment de « conclure » commodément un propos sans vraiment le faire, citer et invoquer la formule chantée par Bilbo “The road goes ever on” est une tentation permanente, au point de devenir presque une sorte de poncif propre aux commentaires sur Tolkien et son œuvre... C'est que cette expression tolkienienne, « La route se poursuit sans fin », renvoie à une image que la plupart d'entre nous aimons beaucoup : celle du chemin que l'on parcourt, comme lecteur, à travers la Terre du Milieu. C'est une démarche qui, philosophiquement parlant, fait écho à la métaphore de la « route de la vie » ou du « chemin de la vie », que Søren Kierkegaard évoque de façon si édifiante dans ses écrits que les auteurs du livre Le Seigneur des Anneaux. Une aventure philosophique (par Mathieu Amat et Simon Merle, Paris, Ellipses Édition, 2020) ne pouvaient que s'appuyer sur cette évocation par le philosophe danois pour consacrer tout un chapitre (le troisième, p. 37-44) aux cheminements existentiels auxquels le plus célèbre roman de Tolkien peut éventuellement inviter à réfléchir. Pourtant, avec le temps, j'ai tendance à penser que si la notion de cheminement reste belle et pertinente, les métaphores de la route ou du chemin me paraissent moins parlantes que celle de la ligne de crête, qui met davantage en avant le devoir d'équilibre et la difficulté du cheminement, même si celui-ci a heureusement ses agréments. Ainsi sur les routes ou les chemins de la Terre du Milieu, comme dans la vie humaine, malgré les apparences éventuellement rassurantes de la voirie, je pense qu'il faut garder à l'esprit que nous sommes toujours en fait dans une position d'équilibriste ou d'alpiniste sur sa crête, et qu'il y a toujours un risque de tomber dans quelque ravin, voire plutôt quelque gouffre selon les choix que l'on choisira de faire. À cette aune, la lecture d'une « œuvre-monde » comme celle de Tolkien peut s'apparenter à une expérience existentielle... mais qui n'est pas sans danger...
« Et qui brise une chose pour découvrir ce que c'est a quitté la voie de la sagesse » dit encore Gandalf, cette fois-ci à Saruman, dans le Seigneur des Anneaux : je ne pense pas que Jérôme brise quoi que ce soit ici pour révéler la dimension chrétienne de l'œuvre de Tolkien, mais je trouve que l'on court pour le moins un risque qui n'en est pas si éloigné lorsqu'on lit un auteur de manière, disons, aussi... fervente. Disons humblement, que je ne sais pas si, en l'espèce, la ferveur est la condition de la compréhension. Le « Recouvrement » (avec ou sans majuscule), à mes yeux, devrait consister d'abord à nettoyer la buée de la fenêtre pour voir, au-delà des signes (éventuellement religieux) que l'on aura précédemment tracés dans cette buée sur la vitre, notre réel complexe et notre condition incertaine, et non pour éventuellement prétendre percevoir une « Vérité » derrière une « buée du quotidien » qui est de notre fait, y compris à travers les histoires (au mieux ni vraies, ni fausses) que nous nous racontons. D'où mon constat du peu de matière à une poursuite d'une discussion (malgré de réels efforts mutuels, ce qu'il est, du reste, bien juste de rappeler).
Ce constat n'est certes pas nouveau, mais cela valait peut-être la peine que j'explicite... en marge d'une sorte de mélancolie personnelle, sans doute encore perceptible dans tout ce que j'ai écrit, qui de facto n'a pas complètement disparue après le Nouvel An mais qui dépasse évidemment les échanges sur Tolkien en ces lieux, même si on aura peut-être compris que les lectures (trop) religieuses de Tolkien ne m'aident décidément pas, à l'évidence, à apprécier ce qui peut être beau et bon en ce monde... au contraire même peut-être, parfois, dans les moments les plus noirs : que voulez-vous, c'est ainsi, et après tout, ce n'est pas plus mal que cela soit dit (sans animosité mais avec franchise), car il est vrai que ce qui est beau et bon ne renvoie pas toujours exactement à la même chose pour les uns ou pour les autres... quoiqu'il me semble que Jean Jaurès (cité précédemment) avait sans doute raison de penser qu'il y a comme une sorte de déterminisme du « fond humain » (un déterminisme « du bien », préférable à un déterminisme « des choses », ce dernier étant par ailleurs discutable) tendant à nous inciter, toutes et tous, à apprécier et faire nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre, ce qui est bien, beau et bon, quel que soit les options métaphysiques (plus ou moins choisies) et le nécessaire rapport (mesuré) au doute.
Dans son étude L'espoir et l'absurde dans l'œuvre de Franz Kafka, publié en appendice de l'édition courante de poche du Mythe de Sisyphe (« Folio essais » Gallimard), Albert Camus a écrit cette dernière phrase dans une ultime note de bas de page : « C'est le destin, et peut-être la grandeur, de cette œuvre que de tout offrir et de ne rien confirmer. » Il m'arrive de me demander si cette formule pourrait s'appliquer à l'œuvre de Tolkien. Il y a encore quelques années, j'aurai peut-être répondu « oui » assez spontanément. Aujourd'hui, notamment à constatant les lectures que l'on peut faire de ladite œuvre, parfois je ne sais plus trop. Si tout ce que cette œuvre a, au fond, à offrir est la Vérité chrétienne, alors dans ce cas, elle n'offre pas « tout », sinon la prétention d'une religion à être universelle et à dire la « Vérité ». Cependant, si c'est là tout, on peut bien toujours dire qu'en fait, elle ne confirme rien, si l'on s'en tient bien à l'œuvre, et en particulier à la part achevée de l'œuvre de l'auteur. À chacun sans doute de trouver, dans cette situation, en fonction de ce qu'il croit qu'il sait, de ce qu'il sait qu'il croit, sa part de consolation...
Je terminerai ce long message en partageant un passage d'un conte de Pierre Louÿs, un de mes auteurs de prédilection, qui se disait « catholique de naissance, très sincèrement païen de foi », et que J. R. R. Tolkien aurait par ailleurs certainement détesté lire mais peu importe.
Sur le conte en question, Gaston Bachelard, dans L'Eau et les Rêves (1942), a écrit des lignes assez sévères et assez décevantes de sa part, même si le philosophe, adepte des lois de l'imagination matérielle et d'une psychanalyse de la connaissance d'inspiration jungienne, prétendait toutefois ne juger le texte que d'un point de vue psychologique et non littéraire. Mais là encore peu importe, et s'agissant de Pierre Louÿs, je préfère retenir ce qu'à écrit à son propos son grand ami Paul Valéry :
« La plupart ne lisaient dans ces beaux livres que des apologies de la chair et de ses plaisirs. Ni les peines que demande un langage si admirable, ni les connaissances que supposent ces peintures, ni l'amertume et la désespérance qui s'y mêlent, n'éclairaient à leurs yeux le vrai visage de l'auteur... Quand on a mis tant d'énergie et de désir, tant de patience et tant de réflexions dans la préparation de son œuvre, on peut exiger après soi d'être longuement et studieusement regardé. L'heure viendra de ce regard pieux. »
Paul Valéry à propos de Pierre Louÿs, cité in Laffont-Bompiani, Dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les pays, collection Bouquins, Paris, Robert Laffont, 1990, Tome III, p. 181-182.

Antoine Calbet (1860-1942).
« ... et comme elle ouvrait les yeux, elle vit le dieu du fleuve couronné d'herbes vertes... »
Illustration pour Lêda, conte de Pierre Louÿs.
Édition de la Librairie Borel, Paris, 1898 (Collection Lotus Alba).
D'autres illustrations de Calbet pour Lêda sont (pour le moment encore) visibles à cette adresse (d'un blog riche de nombreuses merveilles) : http://book-graphics.blogspot.com/2014/08/leda.html
Au crépuscule d'une journée de l'Antiquité grecque, aux jeunes femmes allongées dans l'herbe à qui il vient de conter l'histoire de Lêda et du Cygne, et qui lui demandent diverses explications, notamment sur la vraisemblance de son récit mythique, Mélandryon finit par répondre à l'une d'elle puis à toutes :
- N'as-tu pas entendu les paroles du Fleuve ? Il ne faut jamais expliquer les symboles. Il ne faut jamais les pénétrer. Ayez confiance. Ah ! ne doutez pas. Celui qui a figuré le symbole y a caché une vérité, mais il ne faut pas qu'il la manifeste, ou alors pourquoi la symboliser ?
« Il ne faut pas déchirer les Formes, car elles ne cachent que l'Invisible. Nous savons qu'il y a dans ces arbres d'adorables nymphes enfermées, et pourtant quand le bûcheron les ouvre, l'hamadryade est déjà morte. Nous savons qu'il y a derrière nous des satyres dansants et des nudités divines, mais il ne faut pas nous retourner : tout aurait déjà disparu.
« C'est le reflet onduleux des sources qui est la vérité de la naïade. C'est le bouc debout au milieu des chèvres qui est la vérité du satyre. C'est l'une ou l'autre de vous toutes qui est la vérité d'Aphrodite. Mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas le savoir, il ne faut pas chercher à l'apprendre. Telle est la condition de l'amour et de la joie. C'est à la louange des bienheureuses ténèbres. »
Pierre Louÿs, Lêda (Lêda ou La louange des bienheureuses ténèbres), Paris, Librairie Borel, Collection Lotus Alba, 1898 (première parution : 1893), p. 48-50.
Bonne année 2021 à toutes et à tous : qu'elle vous apporte autant qu'il est possible la joie d'aimer et d'être aimé, la volonté de penser, d'agir, de choisir « quoi faire du temps qui nous est imparti », et qu'elle apporte notamment à ce monde un peu moins de guerres et de guéguerres stupides.
Peace and Love,
Benjamin.
P.S.: même si j'estime ma mise en retrait toujours préférable en ce début d'année (a fortiori après avoir écrit tout cela), je vais tout de même tâcher de tenir prochainement quelques engagements JRRVFiens, évoqués dans un autre fuseau (promesse faite à Cédric) et aussi ici durant les années passées.
Hors ligne
#132 21-01-2021 17:29
- Elendil
- Lieu : Velaux
- Inscription : 2008
- Messages : 1 200
Re : La question du Libre Arbitre
S'agissant du libre arbitre — ce pouvoir de choisir, cette faculté à librement vouloir, penser et agir, ce pouvoir créateur de la volonté se déterminant elle-même en tant que commencement premier —, sans vouloir rivaliser avec l'avalanche d'érudition des nombreux messages précédents du présent fuseau, je dirais d'emblée simplement que, dans ce monde plein d'incertitudes, nous avons des choix à faire, à partir des histoires que nous choisissons de nous raconter, que ces histoires soient le fruit direct d'un héritage ou le fruit de sa propre idiosyncrasie, ou bien d'un peu de tout cela à la fois, ce dont témoigne sans doute notamment, au moins en partie, ce que Tolkien a pu concevoir s'agissant de Faërie.
S'il est bien un passage qui m'a fait sourire, c'est en premier lieu celui-là.  J'ai l'impression qu'on franchit là les bornes de la modestie (mais pas celles de la malséance, comme tu semblais le craindre ailleurs).
J'ai l'impression qu'on franchit là les bornes de la modestie (mais pas celles de la malséance, comme tu semblais le craindre ailleurs).
Il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans ton message, d'autant que tu sembles plus familier de la pensée de Foucault et même de St Augustin que je ne pourrais le prétendre.
Il y a bien quelques points avec lesquels je suis en désaccord et d'autres pour lesquels il me semble que nous avons des points de vue très proches, mais je ne chercherais pas à t'ôter ta tentative de conclure le présent fuseau, car répondre sur l'ensemble des points nécessiterait un temps que je n'ai tout simplement pas en ce moment, comme ton incipit me le rappelle fort à propos. D'ailleurs, à ce stade de la discussion, il me semble qu'il serait bien plus pratique et agréable d'en discuter de visu (et autour d'un bon verre), à la Male-Selve ou dans tout autre lieu propre à ce genre d'échanges. Dommage que la distance repousse aux calendes grecques cette idée.
E.
Hors ligne
#133 21-01-2021 19:59
- sosryko
- Lieu : Burdigala
- Inscription : 2002
- Messages : 2 058
Re : La question du Libre Arbitre
Tout pareil qu'Elendil.
Bonne année Hyarion !
S.
Hors ligne
Pages : Précédent 1 2 haut de page